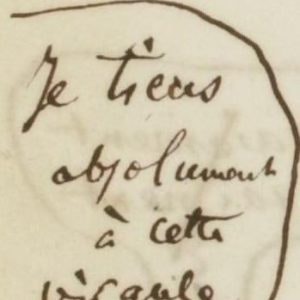Dans le septième épisode de son podcast « Je tiens absolument à cette virgule »,que vous pouvez aussi retrouver sur la plupart desplates-formes de diffusion, Hervé Weil a reçu Paul Sanda, auteur depuis la fin des années 80 de recueils de poésie, d’essais ou de portraits d’artistes, éditeur de la maison d’édition Rafael de Surtis, mais aussi homme de scène déclamant ses œuvres lors de nombreuses performances. Lors de cet entretien, il revient sur ce qu’il a appelé « la poésie de la béance », ainsi que sur la place de l’enfance dans son œuvre, ou enfin sur l’influence du surréalisme tant dans son écriture que dans sa vie.
Dans votre livreSept Fragments immanents pour une alchimie poétique, vous utilisez l’expression de « poésie de la béance ». Comment définir cette poésie de la béance et comment la caractériseriez-vous ?
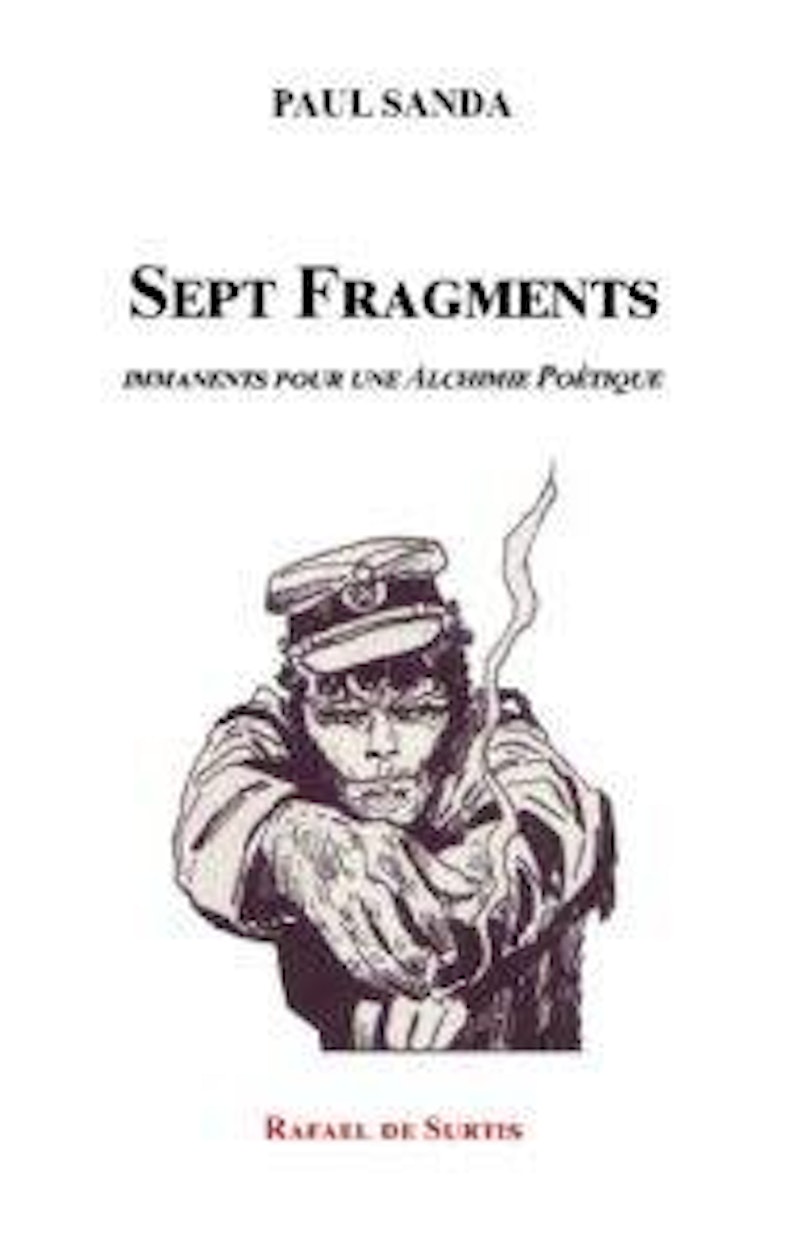
Vous parlez aussi d’ « images ouvertes ». Est-ce que cette notion d’ouverture dans l’image correspond à cette irrésolution intérieure que vous évoquez ?
Je n’ai absolument pas envie, en tout cas dans les recueils de poésie, d’enfermer le lecteur dans quoi que ce soit, et surtout pas de lui donner une clé à ce que j’écris. Je pense, au contraire, que la beauté doit se suffire à elle-même et que les manières dont on la reçoit, dont on l’interprète, dont on l’intègre, dont on s’en sert, sont totalement personnelles et ne peuvent pas être dogmatiques. Je laisse donc l’image ouverte afin que celui qui me lit puisse se l’approprier et s’en emparer de manière totalement autonome et indépendante. C’est l’inverse des romans, qui nous guident dans une histoire déjà ficelée, avec un dénouement. Je considère l’irrésolution comme une caractéristique fondamentale de la poésie, en tout cas de ma poésie et de tous les gens que j’admire en poésie.
Vous décrivez le passé, dans un de vos livres, comme « un chaos informe où la mémoire se perd ». Cela, je vous cite, vaut « pour l’immensité de l’univers, pour la terre entière, mais aussi pour le passé de chacun, pour l’histoire personnelle ». Et de fait, vous avez écrit plusieurs fois sur votre enfance, notamment dans votre ouvrage Auberge de la tête noire. Quelle place cette enfance occupe-t-elle dans votre poésie ?
J’ai donc entrepris toute une démarche afin de m’affranchir, de m’élever, de créer des moyens pour mettre de l’ordre dans ce chaos.
Elle occupe une place fondamentale. Il a été nécessaire pour moi de totalement revisiter cette enfance, jusqu’à repasser dans certains endroits, cinquante ans plus tard. J’ai tenté alors de comprendre ce qui s’était produit pour, justement, échapper au chaos. Les choses sont d’abord vécues, en fait, en ce qui me concerne du moins, dans un univers totalement incohérent, sans aucune raison d’être et sans aucune raison d’avenir. Un présent totalement irrationnel et désincarné, qui a pu être éprouvé chez moi intensément, avec des hauts et des bas et parfois de grosses difficultés parentales et familiales. Je considère ça sous le prisme d’une métaphore de la création du monde : quel que soit le démiurge qui a eu l’idée de créer notre univers, il est parti d’une origine totalement chaotique. Ainsi la terre émerge, inhabitable. C’est l’enfance de la terre. Une enfance que je retrouve chez moi. C’est-à-dire que dans mon enfance, le monde est inhabitable, mon monde intérieur est inhabitable. Et de là est né mon besoin, à un moment, de me réapproprier mon passé. J’ai donc entrepris toute une démarche afin de m’affranchir, de m’élever, de créer des moyens pour mettre de l’ordre dans ce chaos. Démarche qui va être fondamentale. Fondamentale, d’abord dans ma vie et ensuite fondamentale dans mon écriture. On peut même dire que mon écriture a servi d’amplificateur à cette transformation.
Vous allez donc avoir un chaos initial, qui va créer une béance, un déséquilibre, auquel par l’écriture vous allez essayer de donner un ordre ?
Oui, mais donner un ordre, ça ne veut pas dire enfermement. Ça ne veut pas dire boucher la béance, ce qui est, toute façon, totalement impossible. Donner un ordre, ça veut dire donner un sens à la béance. Cette béance, ces manques, tout ce qui est chaotique, ça équivaut au Vésuve ou à l’Etna, qui sont des témoins encore vivants d’une terre primitive ; il existe toujours des volcans en éruption ou susceptibles d’être en éruption et de détruire de l’intérieur les choses. On ne peut pas boucher ça. La présence du chaos est toujours là. En revanche, on peut travailler à ce qu’elle ne gouverne plus rien dans une vie. En ce sens, la poésie va servir à ressaisir tout ça, dans un ordre ouvert peut-être, mais en tout cas cautérisé, si on veut parler en termes de blessure.
Je souhaiterais m’attarder maintenant sur l’influence du mouvement surréaliste sur votre œuvre poétique. Vous avez publié des poètes surréalistes, publié aussi des livres sur le surréalisme et vous dirigez à Cordes-sur-Ciel, une maison du surréalisme. D’abord, est-ce que vous pouvez retracer l’histoire du surréalisme après la mort de Breton et nous en livrer les différentes étapes ?
Les surréalistes ont réussi surtout à faire sortir des choses qui se situent dans l’inconscient collectif, dans l’invariant de l’inconscient collectif, mais aussi dans l’inconscient personnel.
Alors, je ne dirige pas une maison du surréalisme, mais une maison des surréalistes. Je fais référence à une phrase de Gérard le Grand, qui était lui-même un surréaliste et qui a dit : « aujourd’hui le surréalisme est là où sont les surréalistes ». C’est une phrase que je prends comme drapeau. Si on devait découper le surréalisme en périodes, je dirais qu’il y a trois grands mouvements. Il y a la période avant 1924, donc avant le premier manifeste, ce qu’on appelle « le surréalisme des grands anciens ». Là-dedans, on peut mettre, par exemple, Huysmans, le marquis de Sade, Lautréamont, Saint-Pol-Roux. On peut mettre énormément de gens. Après, deuxième phase, il y a le groupe surréaliste historique, période qui s’étend de 1924 jusqu’en 1969, c’est à dire peu après la mort de Breton. En effet, Breton est mort en 1966 et en 1969 Jean Schuster a voulu dissoudre le groupe. C’est pourquoi après 1969, on parle de « surréalisme éternel », avec tous les gens apparentés au surréalisme, qui en ont tiré quelque chose. Il y a plein de personnes aujourd’hui encore qui sont dans cette optique-là : ils reviennent sur leur travail intérieur, avec des fondements qu’on va trouver dans le manifeste du surréalisme. Pour moi, par exemple, c’est « le merveilleux » : c’est un concept qui fait partie de cet univers, même s’il appartient aussi de nombreux autres domaines, tel que l’ésotérisme.
Que reste-t-il aujourd’hui du surréalisme ?
L’enjeu, pour répondre à cette question, serait de déterminer les fondamentaux du surréalisme. Or, à mon sens, ce qui me paraît d’abord fondamental, c’est la mise en commun de la pensée, par une longue confrontation avec des gens qui eux-mêmes étaient dans cette mouvance, qui m’ont marqué et qui m’ont permis d’avancer. En fait, c’est toujours ça, le surréalisme, c’est ouvrir des perspectives.
Si je devais citer des noms de gens qui ont participé pour moi à cette mise en commun de la pensée, il me vient à l’esprit Jean Rollin, cinéaste, à partir duquel j’ai écrit un livre Le Sanctuaire de la peur. Il m’a beaucoup apporté sur l’image et le collage dans l’image. Je parlerais aussi d’Alain-Pierre Pillet, qui a été pour moi un grand ami et un expert du surréalisme. Je lui dois beaucoup de réflexions sur la question de la phrase courte, avec ce principe : tout ce que tu dois dire en une phrase, tu essaies de le dire en une moitié de phrase et puis après tu le résumes à trois mots. C’est la manière aussi d’André Pieyre de Mandiargues : arriver à dire les choses en trois ou en cinq mots, et qui va tordre le cou à toute une forme de pensée. Pas la peine d’en faire des tonnes.
Est-ce possible de dresser aujourd’hui un bilan de ce que fut le mouvement surréaliste historique ?
Les surréalistes n’ont rien inventé, mais en même temps tout inventé. Ils ont inventé la manière dont on exprimerait des choses qu’ils n’ont pas inventé. Ils réussissent surtout à faire sortir des choses qui se situent dans l’inconscient collectif, dans l’invariant de l’inconscient collectif, mais aussi dans l’inconscient personnel. C’était tout le but des jeux surréalistes, qui restent fondamentaux, à mes yeux. Avec l’idée que, de toute façon, la démarche ou la voie ne peut être que personnelle, épurant au maximum cette mise en commun de la pensée dont je viens de parler.
Donc il nous faut aller vers l’invariant pour trouver ce qui nous est le plus singulier ?
Exactement, c’est la seule solution. Si on ne parvient pas à nous différencier de ce qui est de l’ordre de la culture, du conditionnement, de l’éducation, de l’endoctrinement, comment peut-on trouver une voie propre ? C’est peut-être le problème, d’ailleurs, de beaucoup de gens aujourd’hui qui se laissent porter par la vie. Les surréalistes, au contraire, sont des gens qui luttent contre le fait d’être emportés par la vie, qui luttent contre tout ce qui dans la vie se joue de nous. En ce sens, d’une manière générale, la politique est l’antithèse du surréalisme ou de la créativité, puisqu’elle est sans arrêt en train de poser des dogmes. Je dirais que c’est le cas aussi des grandes religions constituées : créer des dogmes pour enfermer tout le monde dans le même panier.
Bien entendu, qu’on soit dans une institution parce que, matériellement, il faut manger, il faut vivre, il faut faire fonctionner une société, je le comprends aussi très bien. Je ne le critique pas du tout d’ailleurs, au contraire. Mais je pense qu’il y a une élégance fondamentale à retrouver, à l’intérieur de soi, sa voix propre. On en revient toujours à cette recherche du merveilleux, à la recherche du diamant à tailler et qu’on finira par tailler dans notre histoire, qui reste trop souvent, en grande partie, un chaos.