
L’ouvrage Nom de Constance Debré publié aux éditions Flammarion, est considéré par notre rédactrice comme une littérature de la pensée anarchiste en acte, caractérisée par une forme de subversion non consensuelle et idiosyncrasique. Cet article s’efforce notamment de montrer en quoi l’écriture de Debré, par la revalorisation qu’elle opère du libre-arbitre et du jugement rationnel, exhibe les écueils et les limites inhérentes à la discipline psychanalytique.
« Quel est le problème avec ce qui est vrai, quel problème ils ont avec la vérité, je me demande tout le temps. »
Constance Debré, Nom
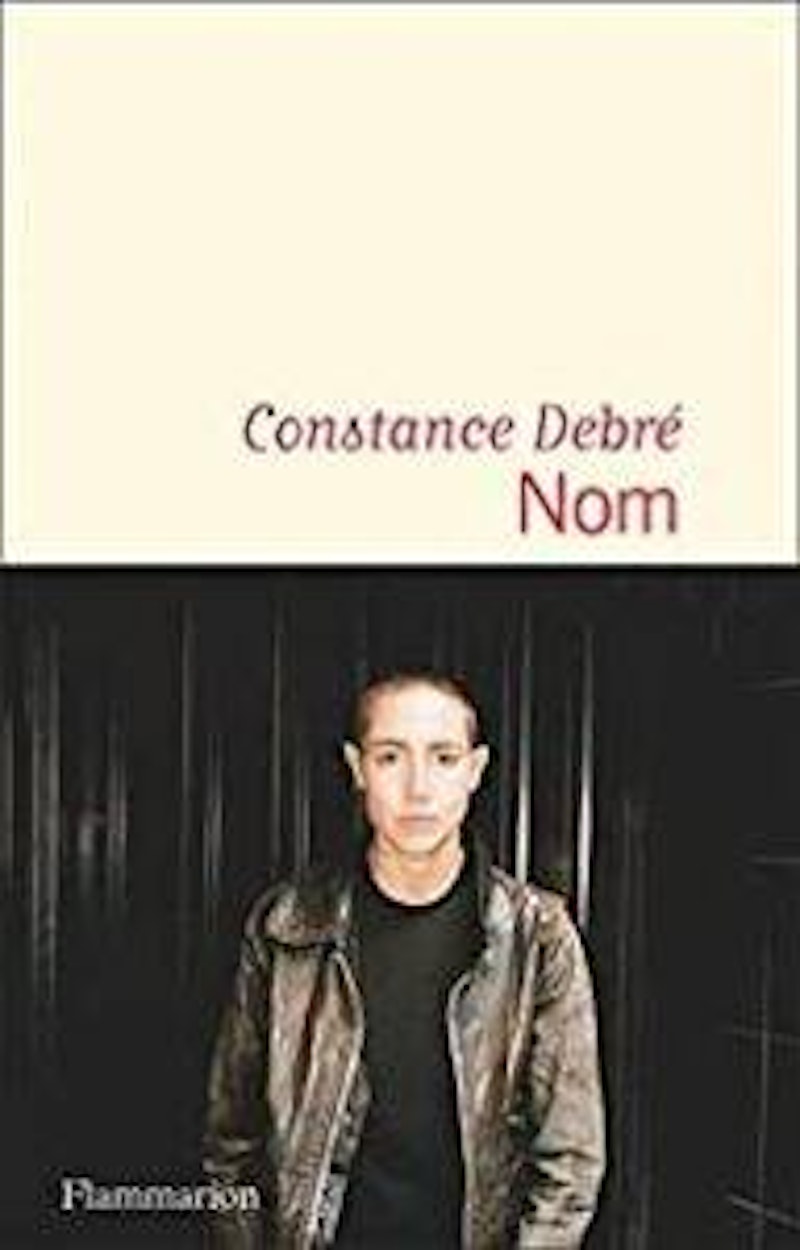
On trouve là déjà plusieurs thèmes structurant l’écriture de Constance Debré : la trahison (de l’origine), le soi créé et connu par « expérimentation » plutôt que déterminé et retrouvé par anamnèse et procédé interprétatif analytique. Le soi passe singulièrement par une capacité à s’incarner : « Aujourd’hui j’ai un corps. Il a fallu des années. Ce n’est pas une idée, ce n’est pas un discours, c’est un fait vérifiable dans la glace. […] Concrètement, dans mes muscles et mes tendons, dans mon visage et les os de mon crâne. Ce n’est pas mon nom, c’est mon corps qui m’intéresse. »
Le corps de l’écrivain
Ce corps – donnée empirique tangible, comme les os deviennent sensibles à l’anorexique – « est apparu quand je suis devenue écrivain, quand je suis devenue homosexuelle, quand je me suis débarrassée de beaucoup de choses et que j’ai perdu le reste ». Pour autant qu’il cesse d’être une entité naturelle, ou même sociale, le corps auto-constitué apparaît premièrement sans genèse, ou sans généalogie ; il n’entretient pas de rapport avec l’origine, il ne découle pas linéairement ni même de manière discontinue de l’histoire familiale. Il a au contraire a une dimension performative : il est à lui-même son propre commencement – ou recommencement, dans les termes finaux du livre. Plus exactement, on pourrait dire que le corps advient dans et par l’écriture, comme chez Kafka corps et visage pourraient « enfin » apparaître, et s’inscrire dans le temps, avec les progrès de l’œuvre littéraire :
« On peut parfaitement discerner en moi une concentration au profit de la littérature. Quand il fut devenu évident dans mon organisme que l’orientation de ma nature vers la création littéraire était la plus productive, tout se pressa dans ce sens et laissa inoccupés ceux de mes talents qui se tournaient vers les joies du sexe, du boire, du manger, de la réflexion philosophique et, en tout premier lieu, de la musique. […] ce qui compense tout cela apparaît en toute clarté. Puisque aussi bien mon développement est achevé et que, pour autant que je puisse le savoir, je n’ai plus rien à sacrifier, il ne me reste qu’à chasser mon travail de bureau de cette vie commune pour commencer ma vraie vie, dans laquelle mon visage pourra enfin vieillir naturellement avec les progrès de mon œuvre. » (Journal, 3 Janvier 1912, je souligne)
Le corps est contemporain de l’œuvre, et celle-ci conditionne strictement l’accès à soi-même et au sentiment d’être réel. Le sujet s’incarne en écrivant parce que l’écriture, pour être même formellement réussie, réclame une disponibilité et une désinhibition totales du soi. Philip Roth confiait à David Remnick que pour écrire, il fallait avoir le courage de supporter le caractère « cru » de son écriture dans sa forme la plus spontanée :
« Probably any work where you start with nothing on a page and you have to fill the page is accompanied by a lot of anxiety and a lot of fear. Fear that simply you can’t do it. And frustration as you’re doing it because what comes is very crude. But over the years I think what you develop is a tolerance for your very crudeness. And patience, patience with your own crap, really. And a kind of belief in your crap, which is: just stay with your crap and it’ll get better if you just stay with it. »*
L’écriture ne peut venir d’un soi déguisé, pudiquement dissimulé à lui-même ; elle ne surgit que du soi profond et honteux, dont elle exige sans cesse qu’il se débarrasse de sa gêne pour devenir expressif. .
L’écriture ne peut venir d’un soi déguisé, pudiquement dissimulé à lui-même ; elle ne surgit que du soi profond et honteux, dont elle exige sans cesse qu’il se débarrasse de sa gêne pour devenir expressif. L’exercice littéraire réussi est la preuve a posteriori que le soi n’est pas si mauvais puisqu’il détient, seul, les clefs de la création. Aucune autre situation que l’écriture ne peut ainsi donner à l’écrivain un sentiment comparable de gratitude pour ce qu’il est. Le corps est l’aboutissement du processus : sculpté par l’œuvre, il devient corps propre. Le corps « sans organes » existe donc par le truchement de l’écriture. Il est plus largement le produit du choix dont un sujet est capable à des degrés variables – dans une perspective bergsonienne. Constance Debré s’assimile à un « héros » : elle choisit une existence dont la norme ne lui préexiste pas, alors qu’elle pouvait se complaire dans une vie « lamentable » mais assurée : « J’aurais pu être comme eux, j’aurais pu accepter. (…) Bien sûr que l’héritier c’est moi, bien sûr que je les déshérite. »
Le choix procède du libre-arbitre et celui-ci est à son tour, écrit Debré, un certain « rapport avec le vide », le vide étant lui-même dans un antagonisme perpétuel avec l’origine. Dans l’ascèse de l’anorexique, il en va bien d’un refus simultané de la nourriture et de l’emprise maternelles. L’anorexique cherche à se libérer de l’incorporat maternel : elle veut un corps séparé de celui de sa mère. Le facteur de la séparation, c’est le vide.
Le rapport au vide : condition nécessaire du libre-arbitre
Le vide a plusieurs fonctions chez Constance Debré : il est primitivement un mécanisme de coupure de l’environnement immédiat – comme dans les phénomènes de dissociation autistique précoce – qui permet de se protéger des intrusions et des menaces de désintégration ; il est le signe le plus manifeste d’un tempérament philosophique et d’une disposition à la créativité – l’acte philosophique inaugural consistant à appliquer « à vide » sa raison aux objets –, le vide est enfin ce que Debré décrira comme un lieu en elle-même où elle n’éprouve rien. Le rien est dans ce dernier sens un facteur de délivrance par rapport à son élément opposé : le déchirement ou le tragique.
« Il faut que je me surveille tellement j’aime ça la solitude, tellement je pourrais vivre seule, tellement je vis toujours seule, même quand je suis avec quelqu’un. »
Dans la tentation du vide, et la tendance solidaire à pouvoir se détacher de tout, vivre sans possessions durables, si ce n’est peut-être celle d’une absolue souveraineté, il y a une certaine parenté avec l’existence végétale à laquelle aspire Jed Martin dans La Carte et le Territoire de Michel Houellebecq – existence végétale et paradoxalement artistiquement féconde. L’enjeu est surtout de ne pas se forcer à éprouver certaines affections pour se relier aux autres quand le sujet dispose en lui-même de ressources suffisantes pour exister, même si cette existence devait être entièrement dépouillée de ce avec quoi les gens la remplissent habituellement. Parce que le sujet n’est pas vide, il s’emploie à organiser régulièrement le vide dans sa vie pour exploiter au mieux sa substance propre. Là où Jed Martin – ou Houellebecq lui-même – vit ainsi sans s’en expliquer outre mesure, avec un flegme caractéristique, Constance Debré fait de cette décision initiale un acte héroïque. Sans doute y a-t-il un coût plus grand et un surcroît de violence dans l’accomplissement de ce détachement lorsque l’on est une femme. Comprenons d’emblée qu’il s’agit moins d’une froideur psychopathique que d’une autonomie constitutive de la personnalité : « Il faut que je me surveille tellement j’aime ça la solitude, tellement je pourrais vivre seule, tellement je vis toujours seule, même quand je suis avec quelqu’un. »
La psychanalyse à l’épreuve du sujet
« (…) J’aurais pu aller voir un psy deux fois par semaine, j’aurais pu lui demander de m’aider à me faire vouloir tout ce dont je ne veux pas, j’aurais pu lui demander de me guérir. Je vis sans propriété sans famille sans enfance. »
Constance Debré, Nom
J’ai reçu le livre de Debré comme une critique des écueils de la psychanalyse, quoique relativement involontaire de la part de l’auteure sans doute, même s’il est fait mention deux fois de la psychanalyse – une fois dans l’épigraphe, l’autre pour la décrire comme un « système » inopérant. Ce que le livre met en évidence, ce sont deux points sur lesquels la psychanalyse échoue à reconnaître ses limites, et qui engagent un seul et même problème méthodologique : comment savoir ce qui, de la parole de l’analysant, doit être soumis à une recherche étiologique, et ce qui fait au contraire exception à la science freudienne, en ceci que c’est la manifestation d’une liberté subjective irréductible à toute causalité inconsciente ? L’analyste compétent doit être en mesure de distinguer entre des croyances qui méritent d’être déconstruites ou réélaborées, et des affirmations du sujet qui ne peuvent pas être impunément soumises à l’exercice du scepticisme analytique – sauf à vouloir semer le chaos.
Certainement, cette difficulté motive les critiques les plus vigoureuses mais aussi les plus justifiées à l’endroit de la psychanalyse : où s’arrête le soupçon de l’analyste ? Quel refus ou désaccord ne prendra-t-il pas aisément pour une dénégation ? Son ironie peut-elle indéfiniment et indifféremment s’appliquer à tout le matériel que lui soumet le patient ? La réponse, évidemment, est non ; sans quoi d’ailleurs on est impuissant à envisager qu’il existe une fin possible de l’analyse ; sans quoi l’analyse devient un mode de vie, ce que Winnicott déplorait comme l’une des formes de l’échec thérapeutique. L’analyse interminable est celle qui n’a jamais vraiment commencé pour lui : elle prend appui sur le faux self du patient. Mais nous pourrions affirmer que c’est également l’analyse qui refuse d’admettre comme sa limite et comme sa fin temporelle ce qui, du sujet, résiste principiellement à l’investigation – l’homosexualité d’un patient, par exemple, appelle-t-elle une interprétation ? Il s’agit donc moins d’une résistance de l’analysant que d’une entièreté du sujet. C’est cette entièreté, je crois, qui est au cœur de l’écriture de Constance Debré.
De l’entièreté du sujet face au déterminisme de l’inconscient
Le sujet peut oublier, mais des forces sociales – des forces essentiellement conservatrices du tissu familial, dont la psychanalyse fait partie –, luttent contre cette réalité
Concrètement, la psychanalyse a du mal à admettre la réalité, d’une part, de la sensibilité philosophique – métaphysique – du patient, sans y voir la cristallisation d’un vécu archaïque, d’un rapport avec la mère qui aurait déterminé la coloration affective du sujet et partant, ses orientations théoriques (ce qui revient fondamentalement à déprécier la philosophie comme science) ; Viktor Frankl a sans doute le mieux évité ce piège. D’autre part, le psychanalyste peut se montrer incapable, à certains moments décisifs, de voir qu’une idée du patient, ou un choix qu’il fait, n’a pas à trouver une intelligibilité, mais doit simplement exister comme tel, comme expression de l’autonomie du sujet et, à ce titre, témoin tout à la fois de la réussite de l’entreprise analytique et de la santé mentale du patient. La psychanalyse peine en fait à reconnaître deux éléments irréductibles à sa pratique : la raison et le libre-arbitre.
Si tout, dans la vie psychique, a une cause inconsciente, si le déterminisme est intégral, comme Freud l’écrit au chapitre 12 de la Psychopathologie de la vie quotidienne, lorsqu’il se distingue du superstitieux – qui croit de son côté au déterminisme de la réalité extérieure…
« Ce qui me distingue d’un homme superstitieux, c’est donc ceci : je ne crois pas qu’un événement, à la production duquel ma vie psychique n’a pas pris part, soit capable de m’apprendre des choses cachées concernant l’état à venir de la réalité ; […]je crois au hasard extérieur (réel), mais je ne crois pas au hasard intérieur (psychique). » (Je souligne)
… Si le hasard intérieur n’existe pas, alors certes des choses contingentes peuvent se produire dans le réel qui ne doivent pas être ramenées à une projection fantasmatique du patient – ce qui permet de déjouer bien des accusations paranoïaques à l’endroit de la psychanalyse – ; cependant, les productions idéelles et plus largement les données intrapsychiques sont toujours susceptibles de « cacher » un motif secret, qui se trouve derrière elles. Un exemple saisissant parmi ceux que rapporte Constance Debré, en conflit patent avec cette thèse, est celui de l’étonnement qu’elle éprouve au moment où elle retrouve de manière fortuite le visage de sa mère à l’écran, plusieurs années après la mort de celle-ci :
« C’est ma mère, j’ai dû le dire quatre ou cinq fois. Je ne disais rien d’autre. Qu’est-ce que ça te fait, m’a demandé la fille. Qu’est-ce que ça me faisait, je n’arrivais pas à savoir. Ça m’étonnait, c’est tout ce que je pouvais dire. J’étais étonnée. C’était étonnant. De la voir. Ou bien de me souvenir que ça avait existé. Elle. Elle et moi. Elle pour moi. Tellement d’importance. Et puis rien. J’ai essayé de trouver autre chose que l’étonnement, je n’ai pas trouvé. Ni ce jour ni les suivants. Il n’y avait plus rien derrière. »
Ce « rien » m’intéresse à plusieurs niveaux. Il rappelle le « rapport au vide », définitionnel de la liberté, pour Constance Debré. De ce point de vue, il est désirable. À force de détachement, il y a une abrasion des sentiments, et le « rien » éprouvé est moins le signe d’une dureté que d’une plasticité de la vie psychique : tandis que certaines choses disparaissent, d’autres peuvent se mettre à exister : « Nager, écrire, l’amour, c’est des techniques pour faire exister des choses et faire disparaître le reste. »
Dans l’exemple du visage de la mère, revu après des années d’oubli, l’étonnement n’est pas le sentiment apparent qui dissimulerait une émotion abyssale, terrible, nécessairement hors d’accès car dangereuse pour l’intégrité du sujet : c’est pourtant le rapport à soi auquel la psychanalyse tend à soumettre systématiquement le patient. Le rien n’est jamais rien, il fait signe vers autre chose. La force du passage cité est de reconnaître le rien comme tel – ou la surface comme le tout. Il n’y a que de l’étonnement devant le fait qu’une relation si intime ait pu devenir entièrement étrangère au sujet, au point qu’un accident de l’existence la ramène inopinément à la mémoire. C’est dire que le sujet peut oublier, mais que les forces sociales – des forces essentiellement conservatrices du tissu familial, dont la psychanalyse fait partie –, luttent contre cette réalité : « Si les choses étaient bien faites, à dix-huit ans on oublierait tout, on ne reverrait jamais ses parents, et on changerait de nom. »
Le lien à la mère est-il toujours indéfectible ? La normativité psychanalytique
La psychanalyse s’attend naturellement à ce que le lien à la mère – lien sacré par excellence, qu’elle peine à attaquer aussi facilement qu’elle s’en prend au Nom-du-père, père qu’il faut bien « tuer » – ne soit jamais neutre. Mais il peut l’être, il existe en soi un espace où ce lien est virtuellement mort ; où, chez certains sujets, il l’est de fait. La question des mères tueuses n’est-elle pas le point aveugle de la pensée de Winnicott ? Mais il n’est même pas besoin, ici, de mère tueuse, ni de mauvaise mère. Il en va simplement d’une aptitude du sujet à se défaire de ce qui est fini – fini comme un amour fini. Constance Debré évoque souvent les sentiments conventionnels, ceux auxquels nous adhérons par habitude, irréflexion ou surmoi, ceux qui sont socialement attendus et retardent voire empêchent le contact avec les émotions réelles, parmi lesquelles le rien. Ne plus se sentir structuré par l’amour pour la mère ? Cela menace trop l’ordre social pour exister ; aussi quantité de bonnes âmes viendront bénévolement (ou non, dans le cas de l’analyste) vous rappeler qu’il y a quelque chose là-derrière l’étonnement.
« Parfois il me semble que je pourrais oublier la femme que j’aime, oublier qu’elle existe, qu’il suffirait d’une infime distraction, que je pourrais l’oublier comme je peux oublier mes clés sur une porte ou des billets dans un distributeur. Je fais attention, ça n’arrive pas mais ça pourrait arriver, il y a un endroit comme ça en moi. »
La raison pure de l’enfance devant l’arbitraire de l’usage et le dérèglement des passions
L’écriture de Constance Debré vise, non pas l’absence d’émotion, mais le dépouillement maximal, peut-être à la manière stoïcienne.
Sauf à vouloir inlassablement se mystifier soi-même, on s’aperçoit qu’il existe en soi moins de pathos qu’on ne le croit. L’écriture de Constance Debré vise, non pas l’absence d’émotion, mais le dépouillement maximal, peut-être à la manière stoïcienne. Elle se dit ainsi « héros » ou « soldat », et la « discipline » est son mode opératoire. La possibilité de la distance s’enracine en fait dans l’enfance, où elle est encore la réaction la plus spontanée :
« La démence partout, le délire tout le temps. Il n’y a qu’à voir la logorrhée, l’obscène logorrhée des adultes, et le silence des enfants gênés par les adultes, les enfants gênés par leur mère, gênés par leur père, par tous les autres. Il suffit de sortir, d’aller dans des parcs, à la sortie des écoles, de traîner dans les rues, ça pullule de parents hystériques et d’enfants gênés. »
L’enfant n’adhère pas à la norme, il a même un mouvement de honte devant des comportements censément normaux, que lui perçoit comme autant de manifestations d’hystérie. Je ne sais pas s’il faut prêter à tous les enfants cette distance, car elle est le propre de ceux qui ont vocation à devenir, comme l’écrit Winnicott à propos d’un jeune patient, des penseurs. Ceux-l�à sont atypiques : « la sagesse de ses remarques prouve que parfois les enfants pensent », écrit Winnicott à propos de Tom, au chapitre XV de L’enfant, la psyché et le corps. Sont « penseurs » en puissance les enfants qui voient nettement qu’une coutume ne repose pas nécessairement sur un fondement rationnel, voire est bête et arbitraire. La distance de Constance Debré est de nature philosophique, c’est la même qui la pousse à ne pas croire à la noblesse, à tous les mécanismes qui visent à naturaliser des constructions d’essence sociale, et à prêter aux individus d’une classe des qualités intrinsèques, qu’ils possèderaient ontologiquement : « L’aristocratie rend fou. Pas à cause de la consanguinité. À cause de la croyance que ça existe, ça, être noble. »
Seule issue devant un tel constat : « partir, recommencer » : « C’est ça que je fais, quand je fais du vélo, quand je construis des cabanes, quand j’apprends l’anglais, quand je lis des histoires de héros, toute l’enfance je m’entraîne et j’attends. »
Dernier (ou premier) mythe à déconstruire : l’enfance. C’est la période de l’existence où l’individu ne choisit rien et doit s’accommoder constamment de la folie ambiante. La même raison qui nous rend conventionnellement nostalgiques de l’enfance – l’heureuse insouciance, l’irresponsabilité –, est ce qui en constitue le caractère oppressant pour Constance Debré qui l’assimile à une réclusion : « Papa-maman est un cri d’esclave. Dix-huit ans pour en sortir. Dix-huit ans c’est les peines qu’on prend quand on assassine. »
Une misogynie féministe ?
Je voudrais finir par un commentaire sur ce que j’appellerai le féminisme atypique de Constance Debré. Dans sa construction narcissique – entendons par là la simple référence au « moi » –, elle est étonnamment proche de son père. Il y a, sinon une identification, du moins une similitude avec la figure masculine taiseuse et peu démonstrative de ses émotions qu’est le père : « On parle. Même pas longtemps. Même de rien. C’est facile. On a un peu la même vie lui et moi, on se comprend. Une vie dans laquelle on fait ce qu’on veut, une vie dans laquelle on se fout de beaucoup de choses, forcément. » D’où une connivence jusque dans l’aptitude à faire face à la mort : « On peut faire ça, lui et moi. On peut parler de la mort, lui et moi. Peu de phrases. Pas de larmes. Pas de commentaires. »
La sœur de Constance, elle, ne peut pas. Elle est toujours associée au plus grand conformisme : « C’est plein de cadavres la vie de héros. Tout le monde ne peut pas. Ma sœur ne peut pas, c’est pour ça qu’elle s’est mariée et qu’elle a trois enfants et un chien. La plupart des gens ne peuvent pas. Moi je peux. »
Tout se passe comme si la femme, plus que les hommes dans le livre, était dans l’effusion sentimentale et la logorrhée ; ou plus sobrement « l’hystérie »
Avec son père, Constance Debré ne parle pas beaucoup – elle est mimétique du laconisme de son père qui hausse plus souvent les épaules qu’il ne se paie de mots. Tout se passe comme si la femme, plus que les hommes dans le livre, était dans l’effusion sentimentale et la logorrhée ; ou plus sobrement « l’hystérie » – « hystérique comme les autres », écrit Debré à propos de l’une de ses tantes. Debré part de sa mère et étend la folie à l’ensemble des femmes : « Maintenant, quand je pense à elle, je me dis qu’elle était folle. C’est depuis quelques années que je pense ça. Depuis que je sors avec des femmes. Depuis que j’ai compris que c’était fou à lier une femme. »
À distance de cette condition féminine, Constance Debré veut «faire du sport, nager, courir, se raser la tête, se tatouer le corps, séduire, être séduit, quitter, être quitté, s’entraîner, s’améliorer, recommencer, risquer, vouloir, faire, ne pas pleurer, être beau, être un héros ». Ailleurs, décrivant son enfance et son adolescence, elle écrit : « je suis la seule fille au milieu des garçons, tout le monde est habitué », ou encore : « je suis une fille à ma façon », « ce que je raconte ce ne sont pas mes émotions, ce ne sont pas mes sentiments – les émotions et les sentiments sont des choses répugnantes –, ce sont mes idées », « je serai un garçon », « je ne suis pas vraiment une fille », « c’est ça qui vous répugne, les indignations, les chagrins, les plaintes, les pleurs », « je suis beau comme les taulards qui font des pompes, pour l’honneur ».
La mère, les tantes, la sœur de Constance, chacune est folle ou faible à sa manière ; le père est quant à lui égoïste, peu enclin à parler de sa propre intériorité ou à s’intéresser à celle des autres ; ni introspectif ni bavard, relativement équanime et indifférent. Je ne prête pas à ces descriptions un caractère normatif : je les considère comme des descriptions, à cet égard contingentes, sans prétention d’essentialisation. Néanmoins, il est impossible de ne pas voir que l’identification au masculin, ou plus exactement le trajet d’une féminité atypique au discours de soi au masculin, traduit un genre peu consensuel de féminisme. Une respiration par ces temps étouffants d’injonction à la sororité.
Le féminisme de Debré procède paradoxalement d’une certaine misogynie, d’une tendance nette à voir dans la psychologie féminine une aliénation structurelle, un débordement permanent des émotions, une incapacité foncière à se tenir froidement devant les choses.
Le féminisme de Debré procède paradoxalement d’une certaine misogynie, d’une tendance nette à voir dans la psychologie féminine une aliénation structurelle, un débordement permanent des émotions, une incapacité foncière à se tenir froidement devant les choses. Que cette psychologie féminine soit affaire de construction sociale pure ou de continuité, dans l’ordre social, de déterminismes physiologiques : ceci n’est pas l’affaire du livre. Cette psychologie existe positivement, c’est suffisant pour s’en défaire et se construire contre ou indépendamment d’elle – cette attitude découlant plutôt de la personnalité de l’auteure qu’elle ne relève d’une posture idéologique ou d’une forme quelconque de militantisme. Là est d’ailleurs l’un des intérêts de la pensée que j’ai dite « anarchiste » de Constance Debré : elle se fout « profondément » de tout et probablement même d’être féministe. Si elle l’est, c’est incidemment, dans la mesure où elle ne se reconnaît pas dans les attributs féminins depuis l’enfance, depuis ses quatre ans.
Revenons pour conclure à Deleuze et Guattari : l’organisme est un assujettissement pour l’anorexique qui veut n’être pas soumise à ses fonctions biologiques de femme ; le conditionnement psychologique des femmes en est un autre. Il faut détourner le corps biologique – c’est sans doute le rôle du sport dans l’existence de Debré – ; corrélativement, il faut se défaire des émotions qu’une femme ressent parce qu’elle est femme – est-ce par complaisance envers sa physiologie qui la rendrait plus encline à la détresse – Madeleine Delbrêl parlait bien après tout des « solitudes physiologiques » de la femme ? Est-ce par obéissance ? Il ne s’agit en tout cas pas de communier avec les autres femmes ni d’exalter le féminin. Ne nous hâtons pas cependant de conclure que le masculin est un idéal – le père dans le livre est relativement exemplaire mais c’est une contingence biographique, Constance Debré le décrit d’ailleurs comme le seul de sa fratrie à n’avoir pas été le « fils de son père ». Le masculin n’est ici que la meilleure approximation de ce qu’est une femme indépendante, qui a la tête sur les épaules, une faible propension à reconnaître inconditionnellement l’autorité et peu d’appétence pour l’enfermement.
BIBLIOGRAPHIE
- Constance Debré, Nom, Flammarion, Paris, 2022
- Sigmund Freud, Psychopathologie de la vie quotidienne, Payot & Rivages, Paris, [1923] 2011
- Donald W. Winnicott, L’enfant, la psyché et le corps, Payot & Rivages, Paris, [1999] 2013
- Franz Kafka, Journal, Grasset & Fasquelle, Paris, 1954
- Michel Houellebecq, La Carte et le Territoire, Flammarion, Paris, [2010] 2016
- Gilles Deleuze & Claire Parnet, Dialogues, Flammarion, Paris, 1977
- Madeleine Delbrêl, La femme, le prêtre et Dieu, Nouvelle Cité, 2011
* « N’importe quel travail où on commence avec une page blanche s’accompagne probablement d’une grande anxiété et d’une grande peur. La peur de ne simplement pas y arriver. Et d’une frustration parce que ce qui sort est très cru. Mais avec les années ce qu’on développe est une certaine tolérance pour sa crudité. Et de la patience, de la patience avec ses conneries, vraiment. Et une certaine confiance dans ses conneries, c’est-à-dire l’assurance que si on parvient à les supporter, on en fera quelque chose. »
Crédit photo : Pierre-Ange Carlotti © Flammarion






































