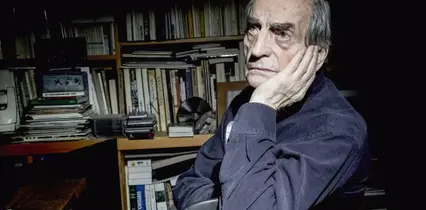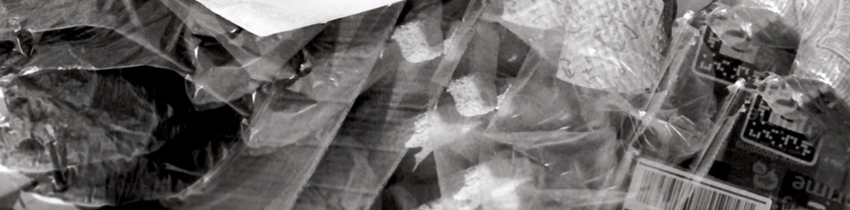Fin de cavale pour Nagui Zinet : ses vacances se terminent au tribunal. Bancs de bois, néons blafards, robes noires qui claquent comme des vagues. Il y plaide à demi-mot, juge ses propres fantômes, mesure la sentence d’un été passé à trier ses épaves intérieures. L’ironie reste son greffier ; la prose, son ultime réquisitoire.
J’ai la flemme de la remettre cette ceinture, devant tous ces flics, alors je la mets autour de mon cou.
Je me dirige vers le tribunal de Paris où j’ai rendez-vous avec un délégué du procureur ; c’est du sérieux. Dans mes oreilles, la Symphonie Alpestre de Strauss. J’en suis arrivé là à cause d’une soirée de solitude qui avait mal fini au début de ce mois de juillet. J’en suis arrivé là, surtout, à en croire l’équipe de psychiatres et de psychanalystes qui s’occupent de moi à plein temps, à cause de mon impulsivité délirante. En avance, je m’arrête à une boulangerie où j’achète un pain au chocolat et un café tous deux aussi insipides. J’en fais la remarque à la vendeuse qui hausse les épaules puis je lui dis que ce n’est pas pratique, ces tabourets, que moi j’ai le vertige. Mes yeux pleurent un peu, c’est l’effet de mon antidépresseur. Je pense que je pourrais m’en servir devant le magistrat et je demande un verre d’eau afin de prendre ma deuxième salve d’anxiolytiques de la journée. Dans le lot, il y a le même médicament qui est censé me faire dormir. C’est mauvais signe, ça, quand on vous donne le jour ce qui est censé vous faire bavoter sur l’oreiller. En langage psychiatrique cela veut dire : COUCHE LA BETE ! Je me remets en route et une pluie fine mais désagréable vient tambouriner mon genou nu (j’ai mis mon plus beau jean troué pour les convaincre de mon insolvabilité). Soudain l’immense bâtisse est devant moi. Je vis peut-être mes dernières heures d’homme libre, pensé-je, avec ce sens de la mesure qui me caractérise. Je me dis surtout, qu’autrefois, j’aurais été dans les locaux où déambulait la massive silhouette du vieux Maigret. Mais le 36 comme le reste, c’est fini. Des vigiles me demandent de montrer pattes blanches. Je dépose toutes mes affaires dans un casier mais je sonne tout de même au portique. Ils me demandent alors d’enlever ma ceinture – les emmerdes commencent. Je m’exécute et je ne sonne plus au portique. J’ai la flemme de la remettre cette ceinture, devant tous ces flics, alors je la mets autour de mon cou. C’est une mode à lancer dans le onzième arrondissement, à coup sûr. Je me perds dans le tribunal jusqu’au moment où un agent me montre la salle d’attente où je vais végéter quelques longues minutes avant que l’on statue sur mon sort. Il regarde ma ceinture d’un drôle d’air puis son œil descend jusqu’à l’énorme trou de mon jean. Il fronce les sourcils et me laisse à Strauss et à mes pensées. La Symphonie achevée, je passe sur Pierre Billon, l’auteur de l’inconceptualisable Bamba Triste, de Pierre Billon :
J’me sens
Définitivement
Comme une bamba triste
Définitivement
Comme une bamba triste. J’me sens
Comme un accord yougoslave auquel on aurait cruellement interdit l’entrée de la Belle Ferronnière
J’me sens
Comme Pierre le preneur de son qui rit sans envie parce que le client lui dit “écoutons hydrophilement

Ouais, voilà comment je me sens, me dis-je alors qu’une femme vient me chercher. C’est la déléguée du procureur. Plus de Bamba triste, juste la panique de finir au trou. Après un petit remontage de bretelles de vingt minutes, elle me laisse libre, sans sanction. Je dois simplement leur prouver que je ...