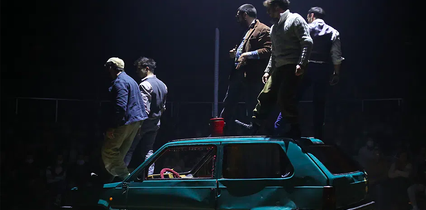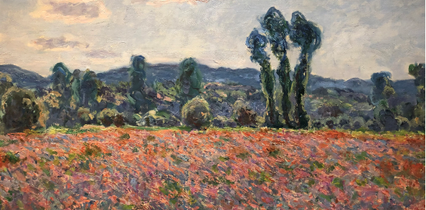Dans Les Silences de Pietrasecca, Alexandre Bertin signe un roman fort, d’une cohérence rare, qui explore les méandres de la mémoire individuelle et collective, à travers le destin de Lorena, une jeune femme en quête de vérité sur ses origines. Inspiré par une page méconnue de l’histoire italienne–les violences sexuelles commises lors de la Libération –, l’auteur tisse un récit profondément politique sans jamais sacrifier la justesse psychologique de ses personnages. Dans cet entretien, il revient sur la genèse du roman, l’importance des luttes féministes, la question du silence comme héritage et résistance, ainsi que sur sa conviction que la littérature peut, à sa manière, contribuer à combler les vides de l’Histoire.
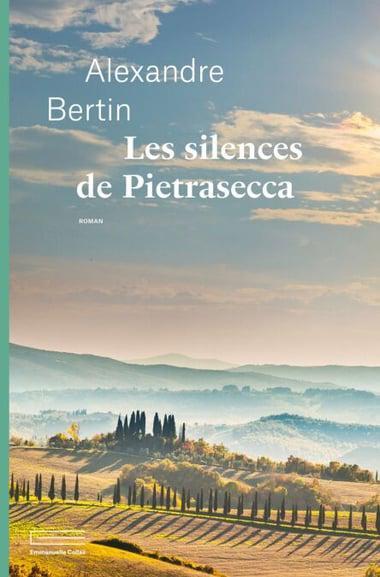
Velimir Mladenović : Qu’est-ce qui vous a inspiré pour écrire un prologue aussi percutant et bouleversant ?
Alexandre Bertin : Ah ! Ce fameux prologue ! Il fait couler beaucoup d’encre ! Ce prologue est le nœud dramatique du roman. Sans cette scène, le roman ne tient pas. Même si à première vue, il peut paraître déconnecté de la suite, de n’être que de la violence gratuite, il joue un rôle essentiel et est nécessaire au développement de l’intrigue. Il plane sur toute l’histoire, en filigrane, jusqu’au dénouement. Ce passage a été bien évidemment le plus compliqué à écrire. Il doit en exister une dizaine de versions différentes. Je l’ai travaillé encore et encore pour obtenir une scène la plus dépouillée possible, concentrée au maximum sur l’action. J’ai essayé d’éviter tout pathos ou tout voyeurisme, j’ai cherché à objectiver au maximum ce qui s’y passe, à gommer l’auteur qui est derrière le clavier. Mais plutôt que trop en dire, je laisse le soin aux lectrices et aux lecteurs de le découvrir.
VM : Dans quelle mesure l’affaire Gigliola Pierobon a-t-elle influencé la construction du roman ?
AB : Pour que tout le monde comprenne de quoi l’on parle, je voudrais, avant de répondre à votre question, expliquer ce qu’est cette « affaire » et quelle importance elle revêt pour la société italienne de l’époque. Nous sommes en 1973, à Padoue et le procès de Gigliola Pierobon a fait grand bruit. Pierobon est née en 1950 et, à 17 ans, elle se tomberetrouve enceinte. Abandonnée par le père de l’enfant et craignant la réaction de ses parents, elle a recours à un avortement clandestin pratiqué par une mammana (l’équivalent des faiseuses d’anges). Réalisée avec des instruments rudimentaires et sans anesthésie, l’intervention a failli lui coûter la vie. À l’époque, l’avortement était totalement illégal et les femmes, comme les praticiens risquaient la prison. Des années plus tard, son nom ressort lors d’une enquête, et elle reconnaît les faits. Son procès débute en juin 1973 et devient vite un symbole : des féministes se mobilisent, son avocate, Bianca Guidetti Serra, transforme l’audience en coup de projecteur sur les milliers de femmes dans la même situation. Son objectif est le même que celui de Gisèle Halimi lors du Procès de Bobigny, huit mois plus tôt en France : mobiliser l’opinion publique afin de faire adopter une loi en faveur de la légalisation de l’avortement. Il faudra attendre 1978 pour que l’Italie vote une loi qui dépénalise partiellement le recours à l’avortement. Pierobon, elle, a été jugée coupable, mais a bénéficié d’un « pardon judiciaire » parce qu’au moment du procès elle est mariée et mère de famille. Une situation totalement hypocrite dénoncée à l’époque.
Pour répondre maintenant à votre question, je ne peux pas dire que ce procès a influencé la construction du roman. Je l’ai plutôt considéré comme l’arène de départ nécessaire pour situer mon personnage principal, Lorena, et lancer l’intrigue. Lorena est une jeune femme de vingt-huit ans, infirmière en gynécologie le jour, militante féministe la nuit, très engagée dans la lutte des femmes pour le droit à disposer de leurs corps. J’ai donc effectué des recherches sur ce mouvement en Italie, des lectures historiques et j’ai conclu qu’elle ne pouvait pas ne pas être à Padoue devant les marches du Palais de Justice, au cœur d’une manifestation de soutien à Gigliola Pierobon. Je suis parti de mon personnage principal et de sa caractérisation pour trouver l’événement qui lui correspondrait le mieux. Ce procès était l’idéal pour les enjeux et pour le développement de mon intrigue.
VM : Quelle était votre intention en termes de message autour du droit des femmes à disposer de leur corps ?
AB : Cette question est essentielle pour moi. Je vis, au quotidien, dans un bain féministe assez bouillonnant. Entre ma femme et l’éducation qu’elle a reçue et mes deux filles, de 20 et 16 ans, très investies dans la défense de leurs libertés, je suis donc très sensibilisé à ces problématiques et à tous les combats qu’il reste encore malheureusement à mener. Il était donc important pour moi de traiter cette question dans un roman. Mais je ne voulais pas en faire le sujet central, plutôt une sorte de motif qui me permettrait de donner une certaine épaisseur à mon histoire et à mes personnages. Je suis admiratif de cette jeunesse qui jour après jour se mobilise pour faire bouger les lignes, faire reculer le machisme et le patriarcat et avancer les droits des femmes et des minorités. Même si Lorena est le produit de son époque (elle aussi bouillonnante), je voulais à travers elle rendre hommage aux femmes des années 2020. Malgré le mouvement #metoo, on est encore très loin du compte et mon roman est une modeste contribution au combat.
VM : Pourquoi avoir choisi l’Italie des années 1970 comme toile de fond de votre récit ?
AB : Parce que c’est une décennie fascinante, celle de tous les dangers, de toutes les violences, mais aussi de toutes les avancées sociales. L’Italie est en ébullition. Le pays, à la fin des années 1960, est encore très fragmenté. La République n’a qu’une quinzaine d’années et les années de fascisme ont laissé des traces profondes. La société est divisée : économiquement (entre un Nord industriel riche et un Sud agricole très pauvre), socialement, géographiquement, religieusement (les forces conservatrices ont encore le monopole, mais les progressistes ne cessent de gagner du terrain dans l’opinion publique). Là-bas, contrairement à la France, les événements de mai 1968 se sont prolongés dans ce qui est devenu l’autunno caldo l’autonno caldo(ou l’automne chaud) à savoir les grands mouvements de convergence des revendications ouvrières et étudiantes. Mais un événement va tout changer en 1969, l’attentat de la Piazza Fontana à Milan qui fera 16 morts et de nombreux blessés et traumatisera tout un peuple. Pendant longtemps, cet attentat sera attribué à l’extrême gauche alors qu’on découvrira plus tard, à la faveur des enquêtes et des révélations qu’il a été commis par des groupuscules d’extrême droite avec l’assentiment de l’État italien (et de la CIA) dans ce qu’on nommera la Stratégie de la tension à savoir la manipulation par le régime en place de l’extrême droite afin d’entretenir un climat de peur facilitant l’arrivée au pouvoir d’un régime autoritaire. Si cette théorie est remise en cause, il n’en reste pas moins qu’elle a permis également la cristallisation à l’extrême gauche d’un mouvement de réaction (et qui s’inscrit dans la continuité des grandes luttes syndicales des années 60) caractérisé par l’apparition de groupuscules révolutionnaires armés (comme les Brigades rouges ou Lotta Continua) spécialisés dans les enlèvements, les attentats ou les assassinats (on pense bien sûr à Aldo Moro, enlevé puis assassiné par les Brigades Rouges en 1978). Les Années de plombs marqueront alors cette décennie d’affrontements, d’attentats et d’assassinats qui feront des centaines de victimes et des milliards de lires de dégâts.
Mais cette décennie est aussi celle de tous les espoirs, notamment à travers les luttes sociales qui prennent de l’ampleur. Les luttes féministes, nous l’avons déjà dit, qui permettront de gagner le droit au divorce en 1974, puis la réforme du droit de la famille l’année suivante, et enfin la légalisation partielle de l’avortement en 1978. Les luttes ouvrières ensuite, intenses dans les grandes usines du Nord pour de meilleures conditions de travail et la poursuite des luttes étudiantes. Les années 1970 sont aussi celles de libertés nouvelles, comme celle des mœurs malgré l’importance des traditions et de la religion.
L’Italie est un pays en crise, mais en mouvement qui connaîtra la désillusion des années 1980, celle du clientélisme, de la corruption et de la toute-puissance de la culture consumériste et médiatique (incarnée par Berlusconi).
VM : Votre roman explore avec acuité les zones d’ombre de la mémoire familiale et collective, en particulier à travers le personnage de Lorena. Avez-vous cherché à interroger le silence comme une forme de complicité, de survie ou de résistance ?
AB : La mémoire a cela de particulier qu’elle est sélective, malléable. Vous comme moi trions nos souvenirs afin de construire notre roman personnel, celui de notre histoire. Bien sûr, certains événements s’imposent à nous et même si nous cherchons à les gommer, ils sont tellement puissants qu’ils restent imprimés quelque part dans notre inconscient. Lorena, l’héroïne du roman, se dépatouille avec tout ça : entre les silences de ses parents et ce qu’elle découvre de leur passé à l’adolescence, elle compose sa vie comme un récit personnel chaotique qu’elle n’assume pas. Si elle ment à ses proches, notamment à Elio, son meilleur ami, elle ne peut se mentir à elle-même. Elle n’arrive pas à se défaire des oripeaux de son passé pour construire son présent, jusqu’à sa rencontre avec le notaire, qui va tout bouleverser. Mise à nue, elle pourra enfin entamer un travail de réhabilitation de sa propre histoire, loin des mensonges et des silences qui l’enveloppent. Et commencer, enfin, sa quête d’identité.
<...