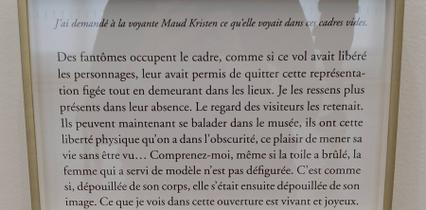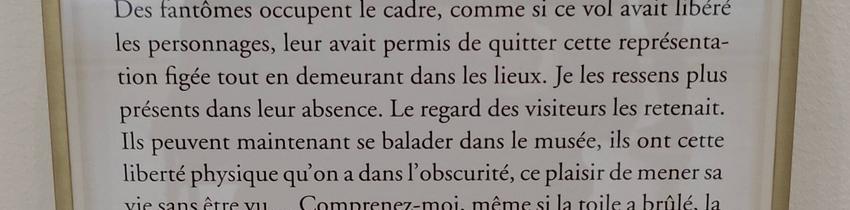Isabelle Goncalves, membre du comité de lecture des Cahiers Sade et autrice d’une thèse sur le Divin Marquis, rend hommage à Annie Le Brun en racontant sa rencontre difficile et éblouissante avec elle, un mois avant sa mort.
L’aura se mesure parfois au chagrin éprouvé et autour de moi les hommes sont tristes. Ils ressentent un « je-ne-sais-quoi » de l’ordre du manque. Sans doute est-ce cela qu’Annie Le Brun appelait «aimer, comme l’ombre hurle en plein été » (Ouverture-éclair). Pour certains, « tour de passe-passe, tour de main » (Janvier), la disparition s’avale mal. Pour d’autres, par synecdoque, ouvrir le catalogue de l’exposition Sade. Attaquer le soleil, choisir les œuvres, sélectionner, aide à détourner le marasme, d’autres encore relisent compulsivement ses œuvres.
Pour moi je porte Attaquer le soleil. Marquis de Sade, d’un « nez » qui aima Sade à travers elle.
Je devais la voir. Je devais voir Annie Le Brun. Comment concevoir autrement un volume consacré à Sade sous l’égide du « mauvais genre », et des femmes ? Sans elle ? Non. Inenvisageable.
L’approche fut lente et irrégulière, menée par autrui et facilitée par une commune connaissance.
Lorsque, pressée de conclure cet entretien avant l’été, persuadée d’une urgence, je m’aventurai davantage, jusqu’à l’appeler fin juin, je déchantai vite. La grande dame saillante et vigilante (« Je décidai de n’être ni exclue, ni esclave », Neuvième cerne) me doucha. Personne n’est assez sadien à ses yeux. Comme rien n’est jamais assez pour Sade.
A bout de ressources et toute honte bue, il ne me restait que Sade. Une force irréductible. « Mais moi, je suis sadienne », lui dis-je. « J’ai fait ma thèse sur le rire de Sade ». Il y eut un silence mais pouvais-je être encore plus mal mangée ? J’argumentais maladroitement sur le rire noir de mon auteur, sur ce qui fait pouffer chez lui, l’outrance grotesque aussi. « Sade est très drôle » m’interrompit-elle au bout d’un moment. Tout à coup, tout s’arrêtait, l’entretien s’oublia. Ce n’était pas la consécration ultime mais l’approbation, l’approbation de qui a lu, de qui connaît, de qui a compris.
Or, un sujet de thèse qui repose sur un ressenti de lecture (« Sade me fait rire »), de qui ne connaît pas Sade, n’a rien lu, de première ou de seconde main avant ce premier moment, une femme qui plus est, excusatio propter feminitatem, est bien difficile à défendre, à légitimer, à imposer.
Et désormais que la bataille était finie, les lauriers déposés, les diplômes rangés, et sans y avoir jamais songé une seconde durant trente ans (« Que penserait Annie Le Brun ??), le jugement était rendu et mon sujet validé pour l’éternité. Je veux dire par là : tout peut arriver désormais à partir du moment ou ça était arrivé. Ce moment intime, hors toute académie, sorbonnarde ou sorbonnophile.
Soudain, alors, tout fut fluide et la conversation roula, sur Sade, sa pensée, l’énergie de sa langue, si proche du latin, la méconnaissance qu’on en a aujourd’hui et les textes. Le langage, un moment, fut commun entre nous.
Que dire ? Mon étonnement universitaire qu’aucune thèse ne lui ait réellement été consacrée : « On ne (me) comprend pas » me dit-elle en substance. Sauf le préfacier de son anthologie chez Bouquins, précisa-t-elle. Elle cita également un article au très beau titre : « Appels d’air. Annie le Brun ou l’invention de l’écologie passionnelle. » dont elle n’avait pas rencontré l’autrice.
Plus tard, je renonçai à passer sous les fourches caudines, cela m’apparut trop difficile. En revanche, loin des essais mais proche de Sade (« Un doigt perpendiculairement enfoui dans mon sexe, il m’apprend la transe en danse. Ma tête est prompte à s’échauffer, je deviens philosophe. », Troisième cerne) sa poésie me prit, et j’avais décidé de mener un entretien indépendant, avec elle, sans Sade, dans un autre media, sur le rire surtout qui accompagne tout (« Mes dents ont arraché des cubes de rire », Des Fêtes) et sur la puissance et la singularité de l’érotisme et de la liberté (« La délicatesse est sauvage ou n’est pas. » Onzième cerne).
Il y a quinze ans, je m’en souviens maintenant, lors d’une conférence à la Halle Saint Pierre, j’avais sollicité une dédicace. « Je ne fais pas ça d’habitude, m’avait-elle dit », me fusillant du regard, ce sans métaphore abusive. Mais il me reste mieux, ce moment précieux, cette lecture poétique, conférence donnée en Sorbonne il y a quelques mois, pour Ombre pour Ombre, et l’accueil sympathique qu’elle nous fit, pour « Sade mauvais genres ? »
Depuis je reste plongée dans Ombre pour Ombre. La poésie est toujours puissante face au chagrin.
A Rome, un genre littéraire est dédié aux émotions du deuil, la consolatio. Écrire console. Et rire aussi, dernier mot que j’ai noté, de son ami, sur leurs échanges, le rire partagé entre eux.
« Qui est encore capable de rire en faisant l’amour ? » (Janvier)