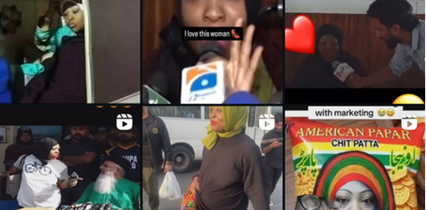Plasticienne et romancière, Claudie Hunzinger a rapproché, comme une évidence, le verbe et la matière organique. De ses premières oeuvres qui condamnaient le mauvais traitement fait à l’objet livre, à ses lettres géantes constituées d’herbe, l’artiste consacre une quarantaine d’années de création à la défense d’une nature et d’une culture bafouées et mésestimées. Publié aux Éditions Grasset, son dernier roman, prix Femina 2022, explore toujours cette porosité entre l’Homme et le vivant. Sorte de manifeste du désastre écologique, Un chien à ma table est aussi le corollaire d’une civilisation qui a oublié sa part d’humanité.

Vivre en ermite
Ce que raconte l’ « écri-vaine », c’est d’abord l’histoire d’un couple, Sophie et Grieg. Ils n’en sont pas vraiment un puisque pour épouser les poncifs du couple, il faut épouser ceux des phénomènes sociaux. Aucun groupe humain n’est possible pour l’un comme pour l’autre, pour ces deux personnes qui n’avaient « jamais vécu en communauté, encore moins en famille ». Alors, pour essayer de faire couple, il faut vivre loin de tout, dans une « bizarre maison », « une maison oubliée » qui garde encore les traces de souvenirs passés, d’une vie humaine qui les a précédés. Et cet espace choisi se place au centre d’un autre, plus vaste, un environnement encore épargné, « un fragment d’holocène négligé par le capitalisme ». Pour vivre quelque part, il faut trouver un endroit où les vestiges des civilisations antérieures semblent encore hanter les lieux mais où la société actuelle n’aurait pas élu domicile. Ce sera au « Bois-Bannis », ce lieu-dit où l’herbe est encore fraiche, où l’on invente d’autres modes d’existence. Le couple sait qu’il est en marge, presque au bord de la Terre, se qualifiant de « personne[s] déplacée[s] ». La femme a grandi dans la forêt. Elle s’est très vite isolée dans la nature, avec Grieg. Loin de tout, proches de rien. Rien, vraiment ? Tout, au contraire. La Nature et l’Animal, voilà ce qu’ont choisi ces héros rabougris. Selon eux, le monde des Hommes ne dialogue pas avec le monde naturel. Placée là presque par accident, la civilisation ne semble pas la bienvenue dans cet environnement riche et vivace. On a l’impression d’entendre la mousse, l’écorce, la sève, quand les humains parleraient pour ne rien dire, occuperaient le paysage uniquement pour le détruire. Dans ce roman, les moments d’échanges entre humains sont rares. Souvent brutaux ou non partagés, ils sont davantage des conférences auxquelles la protagoniste principale, romancière aussi dans la fiction, est invitée. Les Hommes parlent trop ou pas assez. Les animaux, eux, essaient de s’exprimer. Dans cette société ultra contemporaine s’est substituée l’humanité au profit d’un bestiaire varié et sympathique. L’animal se fait roi en adoptant les modes de vie des protagonistes qui, eux, ne savent plus comment faire avec le monde terrestre. Sophie est « quelqu’un qui venait de la forêt » et dont la mission est de « parler pour les arbres ». Mais son langage est peut-être insuffisant, elle doit trouver un médiateur. Ce sera une médiatrice, une chienne, sorte d’alter-ego de Sophie.
Nature carnassière et féminine
À mi-chemin entre le journal intime et la fable, ce roman est une expérience littéraire composée de questions existentielles nichées dans un univers hostile et presque dystopique.
L’animal du livre, c’est Yes. Une chienne qui apparaît un soir, par hasard, chez le couple. Elle a subi quelque chose de violent, quelque chose fait par les humains. Un viol, probablement. Elle portera ce « oui » en guise de prénom. En anglais, comme s’il fallait encore affirmer la langue des Hommes. Une langue qu’on choisit dans une autre, pour appuyer la civilité présumée, la culture. Mais la langue n’est pas que symbolique chez Hunzinger. Elle fait le lien entre la femme et l’animal, littéralement et par la bouche. La chienne scrute la bouche de Sophie, elle est attirée par cette fente qui ressemble à la sienne, cet endroit où l’on goûte et où l’on crie, où l’on peut prendre du plaisir et exprimer sa colère. Lorsque Sophie mange une pomme, elle en mâche quelques bouts pour les donner à Yes, « bouche ouverte, de gueule à gueule ». Le lien entre les deux est évident, plus tard nécessaire. Elles sont « toutes les deux réunies par hasard sur Terre » et le lecteur y comprend le besoin impérieux pour l’une et l’autre. La chienne est « domestiquée » tandis que la femme est « ensauvagée ». Sophie l’affirmera : elles « se complète[nt] ». Faire face au réel est devenu trop dur. Grieg, lui, n’y croit plus. Il sent que la Terre périt. Sophie, elle, y croit parce qu’elle a choisi la Nature, plus précisément, le dialogue. Il y a quelque chose de civilisé dans le naturel et accueillir l’animal c’est en donner la dernière preuve d’humanité. Alors la chienne, Yes, y répond. Elle serait presque la caution humaine de Sophie qui doit « cacher la renarde au fond » d’elle. Depuis toujours, elle le sait, elle porte en elle l’animal mais aussi la forêt. Dans la dernière partie du roman, la vieille femme explore chaque jour son territoire. Des moraines aux frondaisons, Sophie se crée des passages, des espaces. Elle observe, cachée, les passants, les randonneurs, avant de rentrer tard le soir, « trempée comme un torrent (…) avec un visage de faucon ». Et ainsi se dessine une géographie personnifiée. La nature ressemble peu à peu à une femme. Les Alpes exhibent leur « mâchoire », l’aube a « des dents gâtées », la Jungfrau possède des « dents pointues ». Doucement s’affirme une Terre aux contours sauvages mais humains. Et l’héroïne, après s’être retrouvée au travers de sa fidèle camarade animale, retrouve un environnement familier et rassurant. La colère, quant à elle, s’apaise parfois, au gré des saisons. Par exemple quand le printemps arrive, « la douceur revenue » et que Sophie serre moins les dents. Cette « écri-vaine des brousailles qui ne savait pas observer les humains » apprend alors à vivre dans son milieu naturel, grâce à l’autre, la bête. Elle appréhende paisiblement la nature humaine, protégée par les arbres, dans l’espoir d’accueillir un autre monde. Attendre qu’advienne « le temps où tout aura fini de finir », le temps de faire société avec les bêtes.
Crédit photo : Claudie Hunzinger © Marc Guénard