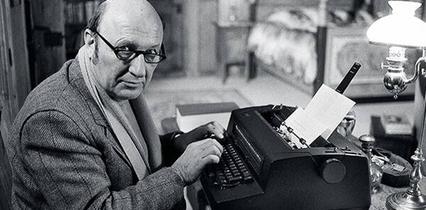Quels sont les mots qui s’échangent dans l’enceinte de l’hôpital psychiatrique ? La poésie peut-elle retranscrire d’autre part le langage intérieur avec justesse, celui que chacun porte derrière les échanges ? Dans son recueil Feu Mange Forêt, Clémentine Pons peint une fresque de l’hôpital psychiatrique, un univers où la parole vacille, où les mots se heurtent à la frontière de la folie. L’hôpital devient ce lieu étrange où les phrases échangées semblent à la fois dérisoires et lourdes de sens, où le banal côtoie l’abîme. « Pourquoi vous voulez mourir ? » demandent les professionnels dans cet espace, comme si la question pouvait avoir une réponse simple, comme si elle ne faisait que passer sous silence le gouffre qu’elle laisse béant.

Mais comment la poésie, avec ses contraintes et son esthétique, peut-elle espérer capturer ces instants fugaces et bruts qui rythment la vie derrière les murs ? Peut-elle véritablement prétendre à dire l’indicible, à traduire la violence intérieure des âmes tourmentées ? Pons, en entrechoquant les mots, en jouant avec leurs failles, parvient à faire entendre sa voix et son histoire.
Les dialogues semblent anodins, mais ils résonnent d’une profondeur tragique : « On joue à action ou vérité comme si on était en colonie de vacances », écrit-elle, réduisant l’horreur d’un espace de détention psychique à une mascarade enfantine. Les rires, les anniversaires fêtés, les blagues partagées : tout cela résonne d’une mélancolie irrépressible, celle d’une tentative désespérée de retrouver une normalité disparue. Dans ce lieu où l’on « mange des raviolis » et où « il y a du café gratuit et de la conversation » les jours où la bibliothèque est ouverte, Pons ébauche une poésie de l’ordinaire, faite de répétitions mécaniques et de gestes quotidiens, qui dessinent en filigrane la véritable tragédie. De fait, au milieu de cette violence, elle dépeint des instants de tendresse partagée, d’amitié fragile, comme cette scène où les patientes rient ensemble, où les répliques de films les rattachent au monde social, presque inaccessible : « On rigole beaucoup d’ailleurs / ce sont des répliques de films qui nous font rire ou des histoires drôles qui nous sont arrivées ». Derrière ces rires, le lecteur perçoit le désarroi, la tentative de recréer un semblant de quotidien dans un lieu qui dissout les identités.
C’est là que la poésie trouve son pouvoir : dans sa capacité à capter ces fragments épars, à redonner du poids à ces mots en apparence anodins.
L’Hôpital psychiatrique : Espace du dedans tourné vers l’Autre
Cette œuvre est un monde à elle seule, car ce qu’on associerait à la « folie » s’y déploie en une série de scènes à la fois cruelles et ordinaires, pour finalement rendre compte de la transformation des corps et des esprits,sous l’effet des médicaments, des traitements et des interactions humaines réduites à des simulacres. Notons que la liste des médicaments, égrenée avec une précision clinique, devient un poème en soi, caché derrière l’interminable inventaire des substances qui modifient la perception, qui altèrent l’âme. « La liste des effets secondaires est plus longue que mon avenir », déclare la narratrice, soulignant l’étirement douloureux d’une existence marquée par les substances chimiques.
Pons transforme cet espace de désintégration en une arène de l’extrême. Les cris des patientes, les pleurs, les silences lourds de sens deviennent autant de points d’ancrage pour une poésie du désastre, une poésie qui refuse de détourner le regard.
Pons y convoque également le souvenir de son...