Montevideo (éditions Actes Sud, 2023), le dernier livre d’Enrique Vila-Matas, présente, dans la continuité de ses précédents ouvrages, une réflexion toujours plus fouillée et approfondie sur la littérature et part à la recherche inlassable de la clef de l’écriture qui lui permettra de comprendre ce qui l’empêche d’écrire. Après être parti à la quête de ce Graal dans l’histoire de la littérature (Abrégé d’histoire de la littérature portative), dans la fuite du réel (Loin de Veracruz), dans l’œuvre posthume (Mac et son contretemps) et dans les citations (Cette Brume insensée), Vila-Matas poursuit cette fois son périple dans le voyage aux quatre coins du monde entre Montevideo et Paris, Reykjavik et Bogota ou Saint-Gall, d’une exposition d’art contemporain de Beaubourg à la chambre d’hôtel 205 de l’hôtel Cervantés.

Zone Critique : Si votre dernier ouvrage, Montevideo, n’est pas résumable car il n’a pas de trame narrative linéaire, nous pouvons néanmoins dire qu’il s’agit de la recherche, par l’écrivain narrateur (peut-être vous ? peut-être un autre ?), des raisons qui l’empêchent d’écrire. Peut-on vous retourner la question que pose, dans votre ouvrage, Miles Davis à Mallarmé : « Ne serait-ce pas parce que vous écrivez sur ce qui vous empêche d’écrire ? ». En d’autres termes, le plus important pour un écrivain n’est-il pas la recherche qui doit aboutir à l’œuvre ?
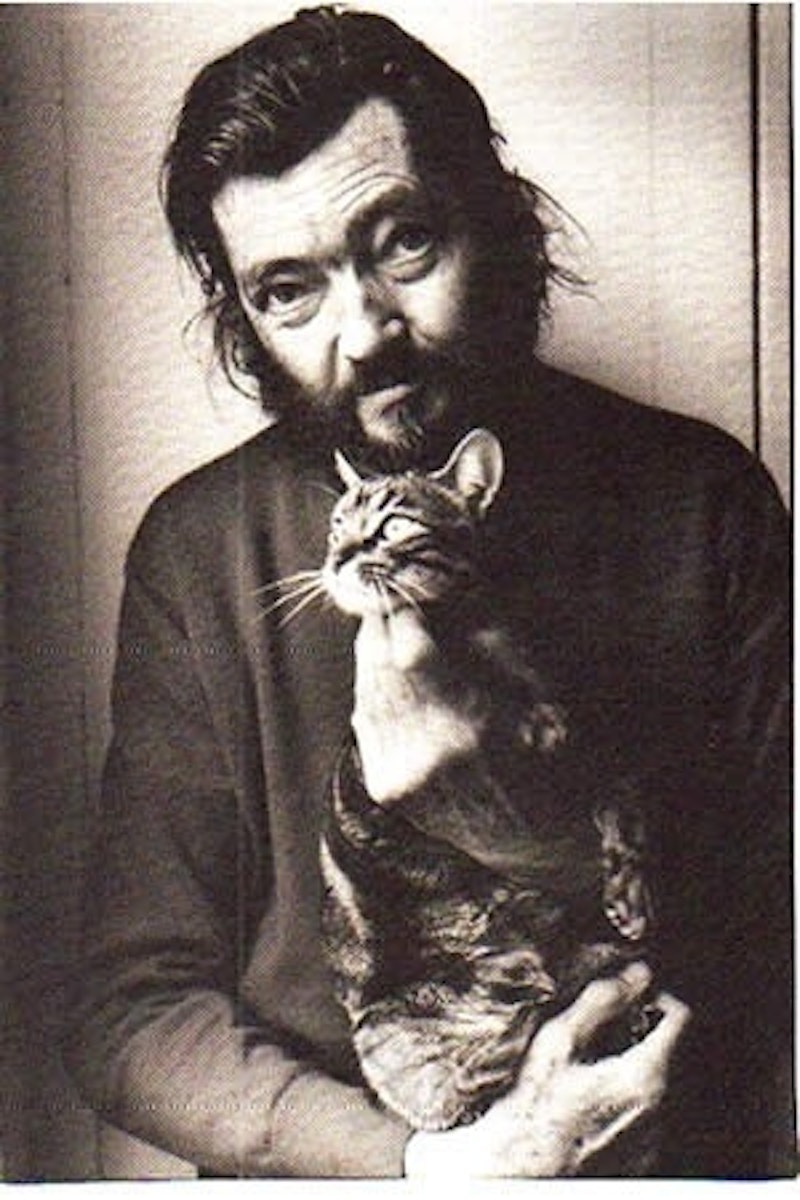
Enrique Vila-Matas : Oui, en effet, c’est le plus important. La recherche qui a abouti à Montevideo a commencé au siècle dernier, lors d’un voyage à Buenos Aires. A l’occasion d’une rencontre avec l’écrivain argentine Vlady Kociancich, amie de Borges, cette dernière m’informe qu’il existe une nouvelle de Julio Cortázar, intitulée la Porte condamnée, très similaire à une autre nouvelle d’Adolfo Bioy Casares, écrite par un grand hasard la même année. Les deux histoires à la trame quasi identique et comportant de nombreux éléments communs (dans les personnages, les descriptions…) se déroulent toutes deux dans l’hôtel Cervantès de Montevideo [pour rappeler le contexte, le héros de la nouvelle, Petrone, est réveillé toutes les nuits dans sa petite chambre d’un très vieil hôtel par les pleurs d’un enfant qu’il entend à travers la porte qui communiquait jadis avec la chambre voisine. Pourtant le gérant lui assure qu’il n’y a pas d’enfant à l’étage, ni même dans l’hôtel…]. C’est ce qui a constitué le point de départ de mon ouvrage : en partant du résumé assez bref de la nouvelle de Cortázar, j’aboutis à ce qui est le véritable objectif de mon narrateur, à savoir enquêter sur un lieu précis qui est la chambre d’hôtel où se déroule cette histoire. J’avais déjà repéré l’endroit. Aujourd’hui, l’hôtel Cervantès est devenu l’Esplendor. Mon narrateur s’y rend, avec l’espoir de retrouver cette petite chambre et la porte condamnée derrière l’armoire.
ZC : Votre ouvrage serait-il un nouveau volume de la série des « pathologies de l’écriture » (composée de Bartleby, du Mal de Montano et du Docteur Pasavento) ? Peut-on dire qu’il s’agit d’une œuvre métalittéraire ou d’une métafiction ?
E V-M : Je dirais que les concepts « méta » (métafiction, autofiction…) me dérangent quelque peu. En Espagne, ils sont constamment utilisés pour qualifier ou disqualifier mon travail. La soi-disant méta-littérature est un non-sens. Oui, bien sûr, Don Quichotte est méta-littéraire, mais il n’est jamais fondamentalement « méta ». Il s’agit avant tout d’une histoire fictive. On pourrait également dire que la Bible est une métafiction : quelqu’un l’a écrite, elle n’est pas sortie de nulle part. Je précise que le terme « autofiction » est français ; il est apparu pour la première fois dans le roman Fils de Serge Doubrovsky en 1977.
Ce terme est toujours mal utilisé en Espagne. A titre d’exemple, on m’a dans un premier temps défendu de prononcer ce mot, alors que je devais donner une conférence devant un public assez conservateur, dans une province espagnole quelconque. Je me suis alors demandé pourquoi ils ne comprenaient pas ce terme. Eh bien maintenant, il s’avère que c’est l’inverse : tout le monde comprend de quoi il s’agit quand on parle d’autofiction et tout le monde pense en faire, mais ce n’est évidemment pas le cas… En effet, il y a une marge entre d’un côté raconter les problèmes relationnels qu’a rencontrés un auteur dans sa jeunesse avec son père et « l’autofictionnaliser » un peu, pénétrer un tant soit peu dans ce qu’est la littérature à travers l’autofiction, jouer avec ce procédé et d’un autre côté faire croire tout simplement au lecteur que ce que vous racontez vous est arrivé personnellement (ou est arrivé au narrateur) alors que ce n’est pas le cas et que c’est un pur travail d’imagination.
Le problème qui résulte de cette confusion, je l’ai résolu récemment dans une émission de la télévision catalane pour ménagères de moins de cinquante ans qui sont en général des aides à domicile pour retraités, un programme de fin de journée pour lequel il n’est pas nécessaire de compliquer les choses avec des concepts littéraires et analytiques, comme on peut le faire dans votre revue Zone Critique par exemple. Au cours de cette émission, on m’a demandé pourquoi je n’aimais pas ce terme d’autofiction. J’ai alors répondu : « Ce n’est pas tant que je ne l’aime pas, c’est simplement que le mot « fiction » est plus court, cela fait gagner du temps », d’autant plus que nous savons pertinemment qu’en définitive, tout auteur, quand il écrit, transforme la réalité des faits, les interprète à sa manière, change en quelque sorte de personnalité.
Un autre problème, éternel, consiste dans le fait de savoir si la vie et l’œuvre vont de pair ou s’ils doivent être séparés. Pour ma part, je pense que c’est l’œuvre qui compte pour un écrivain. C’est elle qui renseigne sur sa personnalité, même s’il n’écrit pas spécifiquement sur lui-même, non les détails. En ce qui me concerne, on me dit souvent que je ressemble à mon œuvre. Et cela représente un vrai problème, car dans la vraie vie je préfère parler de football plutôt que de grands débats métaphysiques ou littéraires… Et c’est ce que je réponds à chaque fois à mes interlocuteurs, qui pensent bien faire.
ZC : Montevideo se présente comme un voyage dans l’espace (à travers Montevideo, Paris, Saint-Gall…), dans le temps (on assiste à une rencontre fantasmée entre Miles Davis et Mallarmé) mais aussi dans différents styles : le rêve, le souvenir, la fiction, le réel, le fantastique. Le voyage est-il pour vous une matérialisation de la littérature, dans le sens où l’on part à la découverte de son monde intérieur et où l’on se perd, d’où l’aspect labyrinthique de votre ouvrage ? Ou est-ce plutôt un moyen de se sauver soi-même de l’impossibilité d’écrire ?
E V-M : L’Odyssée est le récit de fiction fondateur de l’Occident, et c’est justement, à mon avis, parce qu’il s’agit d’un récit de voyage. Quand vous commencez un voyage, vous le menez nécessairement à son terme ; ensuite, vous le racontez : cela constitue donc déjà un récit. C’est également le format idéal pour faire le récit d’une quête : vous partez à la recherche de quelque chose (de matériel ou une idée) et vous le trouvez (ou non), c’est un concept vieux comme le monde. Le voyage de Don Quichotte, par exemple, est un aller-retour avec la mort. Il s’agit donc toujours de la manière d’élaborer un procédé qui vous permette d’aller d’un point A à un point B, qui est votre but ultime.
Pour moi, le roman est un voyage mental et à l’intérieur de ce roman, je décris un voyage réel, qui emmène le lecteur dans des endroits qui ne sont pas imaginaires. Cela ne signifie pas pour autant que je connaisse forcément tous les lieux cités. Dans le cas de Montevideo, je les connais à peu près tous, hormis Reykjavik.
Tout dépend ensuite du moyen auquel vous avez recours pour narrer ce voyage ; quand j’en fais le récit à mon interlocuteur, et que je le détaille tel qu’il s’est déroulé, c’est la première fois que je raconte ce voyage, et sans m’en rendre compte, presque inconsciemment, j’ai déjà décidé de ce qu’il s’est passé. N’ayant pas parcouru le monde dans sa totalité, je ne peux pas faire entrer dans ce récit des éléments dont je n’aurais forcément pas connaissance, mais je structure mon histoire de telle sorte que j’y inclus des choses inventées, y compris des choses que j’aurai oubliées.
ZC : L’intrigue, la trame du récit ne comptent pas vraiment, c’est le langage et le rythme du récit qui sont plus intéressants. Est-ce parce qu’ils sont plus personnels et révélateurs de l’identité d’un écrivain, de « son esprit » pour reprendre les termes de Paul Valéry ?
E V-M : Cette figure d’écrivain, je l’ai pensée comme une fin de parcours, comme si je devais mourir après ma greffe de rein en laissant un brouillon de roman et non la version finale, comme si j’avais voulu laisser un message. Je vais dire une vérité, j’aime vraiment la littérature et je voulais montrer ce que j’aurais aimé faire et quelle direction j’aurais aimé prendre. En me préparant pour l’opération, j’ai commencé à me dire : « plus de fioritures, fais ce que tu aimes réellement ». Je suis alors entré dans un labyrinthe, qui commence à Paris en 1974 avec un narrateur qui se veut écrivain et qui m’a conduit finalement à Paul Valéry et, à partir de là, j’ai continué à cheminer. Mais je ne voulais pas faire du Paul Valéry. Je me suis rendu compte, en effet, que j’avais encore du chemin à faire pour être un essayiste. Et c’est la raison pour laquelle la première des cinq tendances narratives que j’ai identifiées, celle de ceux qui n’ont rien à raconter, et qui me caractérisait tant que j’étais à Paris, m’a semblé être une impasse.
Ce qui est curieux avec ces trois années durant lesquelles j’ai arrêté d’écrire, c’est que j’ai commencé à vivre des choses vraies.
Trois ans ont passé pendant lesquels je n’ai pas écrit, précisément parce que j’étais arrivé à un point mort. On me dit souvent que je traite beaucoup trop du thème de l’arrêt de l’écriture, parce que j’en parle déjà dans Bartleby et compagnie et d’autres romans. Mais il ne s’agit pas de me répéter, ; c’est surtout parce que je suis obligé de recommencer, sans arrêt. Je l’avais déjà fait dans le Mal de Montano, mon livre écrit en 2003, pour dire que tout ce que j’avais raconté jusqu’à présent n’était pas vrai. Maintenant, je commence à dire la vérité. Ce qui est curieux avec ces trois années durant lesquelles j’ai arrêté d’écrire, c’est que j’ai commencé à vivre des choses vraies, que je me suis senti obligé de raconter dans le livre (et c’est la partie du roman qui m’a sans doute le plus intéressé) parce que je les trouve toutes racontables. Je dirais qu’à ce moment-là, et c’est encore trop tôt dans le livre pour s’en rendre vraiment compte, l’aspirant essayiste que j’ai toujours été et voulu être en écrivant du point de vue d’un essayiste, devient ce qu’il est vraiment, c’est-à-dire un narrateur. Je suis très à l’aise quand je raconte en tant que narrateur, mais pas en tant qu’essayiste, car ce n’est pas tout à fait la même chose. J’ai du mal à mélanger pensée et fiction. Javier Marias a dit une fois qu’il n’y a pas beaucoup de mystère dans le fait de raconter ; je trouve très étrange qu’il dise cela car pour moi, au contraire, il est très difficile de raconter. A chacun sa spécialité…
ZC : Pour le narrateur, la littérature représente un espace de liberté tellement immense qu’elle autorise toutes les contradictions et cette autonomie absolue est particulièrement vraie dans le cas des écrivains français, vous écrivez que tous les vrais écrivains sont français, même s’ils ne sont pas de nationalité française. Comment expliquez-vous cette spécificité ? Pourquoi l’écrivain doit-il être français ?
Pour moi, la littérature a toujours été française.
E V-M : Je ne saurais pas vraiment dire, on ne m’a encore jamais posé cette question. Je pense que c’est en raison de mon bagage culturel, de mon séjour à Paris de quelques années, à partir de 1974, de mon rapport avec Marguerite Duras. Et aussi parce que, pour moi, la littérature a toujours été française, ce qui n’enlève rien aux mérites des autres : l’anglaise, l’allemande et toute la littérature occidentale en général. Mais c’est la française que je pratique le mieux, celle où la figure de l’écrivain s’épanouit le mieux jusqu’à présent, jusqu’à récemment en tout cas. Et pour moi, la littérature, c’est la France. Je ne l’affirme pas catégoriquement mais j’ai déjà dit, sous forme de plaisanterie, que Dieu ne peut pas écrire puisqu’il n’est pas français.
La littérature est un espace de paradoxes et de contradictions, elle permet de jouer avec des phrases que je ne comprends pas moi-même mais qui pourtant sont là, écrites. Après mon opération, quand je me suis rendu compte que je vivrais alors que je n’étais pas encore tout à fait guéri, je me suis laissé aller à une écriture totalement libre. L’écriture m’a fait me sentir tellement libre que je me suis permis d’écrire des phrases sorties de mon esprit sans que je les pense. Et cela m’a paru tellement curieux que je les ai laissées telles quelles, sur le papier. Tout le livre, on s’en rend compte à la fin, est finalement la recherche d’une chambre à soi, pour reprendre l’expression de Virginia Woolf.
Je crois m’être adonné dans ce livre à une liberté d’écrire que je n’avais jamais expérimentée auparavant. C’est un choix personnel assumé qui me pousse à suivre ma propre logique, à faire ce que je veux. Je sais que d’aucuns verront cela d’un mauvais œil, mais ils feront avec, car c’est ma manière de raisonner.
La liberté est le maître-mot et se met perpétuellement au service de l’écrivain.
En parallèle de la rédaction de mon livre (je n’avais pas encore commencé sa version définitive), je lisais le dernier ouvrage de Martin Amis et, bien que je ne l’aie pas terminé, j’ai été frappé de voir qu’il écrivait à la manière de Nabokov, à savoir sans se préoccuper de quoi que ce soit tout en bâtissant une sorte de structure au sein de laquelle la liberté est le maître-mot et se met perpétuellement au service de l’écrivain. J’ai malgré tout procédé à de nombreuses corrections, des suppressions de passages entiers, qui étaient pourtant bons, comme s’il s’agissait des rouages inutiles d’une grosse machine dont on se débarrasse pour des raisons pratiques. Ici, cela m’a permis d’effectuer des sauts d’un endroit à l’autre, d’une ville à l’autre. A un moment donné, dans mon livre, le narrateur se trouve dans trois endroits différents : dans une chambre à Paris, mais aussi à Shanghai et à Bogota et tout cela constitue un voyage mental dans lequel je maîtrise complètement l’espace et où je peux me rendre d’un lieu à un autre avec facilité car c’est moi qui ai assemblé cette machine, cette sorte de boîte qui me permet d’aller où je veux. J’ai à l’esprit un exemple, celui du film de Mike Leigh sur Turner. On voit ce dernier à l’exposition de la Royal Academy, au milieu de ses confrères peintres qui apportent la touche finale à leurs tableaux. Il les observe et se rend compte que son propre tableau, intitulé Helvoetsluys, qui est pourtant terminé, ne se démarque pas des autres ; en effet, ils représentent tous des paysages marins. Il prend alors son pinceau et peint une bouée de sauvetage rouge au beau milieu de la mer. Cela me fascine et me plaît beaucoup car cela me fait penser à ce que j’essaye de faire moi-même, à savoir organiser suffisamment d’espace pour me permettre d’aller et venir où je veux dans mon œuvre, de « repeindre mon tableau », et de disposer de tout l’arsenal suffisant pour apporter des petites touches de-ci de-là et revenir sur le travail prétendument fini. C’est très amusant pour l’écrivain. Je ne me suis pas toujours amusé en écrivant, il a fallu apprendre à le faire. D’un autre côté, je veille à ne pas lâcher complètement la bride à mon imagination au beau milieu du livre, car si je n’obéis plus à mon plan, je succomberai à une liberté totalement débridée.
ZC : Le narrateur définit cinq tendances narratives. Il s’inclut dans la première, celle de ceux qui n’ont rien à raconter, quand il n’y a pas encore de littérature, par opposition à la quatrième, celle de ceux qui veulent tout raconter, quand il n’y a plus de littérature car, par ce côté totalitaire, elle devient impossible et ennuyeuse. La littérature n’est-elle pas plutôt dans l’entre-deux, la tendance de ceux qui ne racontent pas tout en alliant le minimalisme de Tabucchi au grandiose de Melville ?
E V-M : Justement, hasard du calendrier, j’ai été convié à une conférence en novembre à Barcelone sur Moby Dick et Femme de Porto Pim de Tabucchi, avec Rodrigo Fresán, qui est un spécialiste de Melville. Voltaire a écrit : « Le secret d’ennuyer serait de tout dire » et je pense qu’il a raison ; de toute façon, personne n’a jamais tout dit. Chez Kafka, c’est le contraire ; ainsi, dans Le Procès, quelqu’un s’écrie à l’adresse de K., lors de son interrogatoire : « Dis-moi tout, je veux tout savoir ! Je veux connaître toute la vérité, jusqu’à la dernière extrémité. » Cela reflète l’ambition kafkaïenne de la totalité. Il s’oppose donc totalement à l’idée de Voltaire.
Je pense que le privilège de la littérature est d’être le réceptacle de toutes sortes d’opinions et de points de vue, certains étant tout à fait recevables, d’autres n’étant que la continuation ou la répétition d’idées déjà formulées. C’est pourquoi je m’intéresse aux écrivains singuliers, qui essaient de se démarquer des autres par une nouvelle théorie ou une nouvelle idée sur ce qu’est la littérature. Si je prends mon cas personnel, je suis très démocrate, dans le sens où j’accepte tous types de points de vue quand ils sont bien formulés, étayés et argumentés ; cela ne veut pas dire pour autant que je n’en déteste pas certains, mais à partir du moment où ils sont bien présentés, je les prends en compte, je les étudie et dans ce cas, je tire mon chapeau. Il faut accepter le fait que la littérature est un ensemble extraordinaire d’opinions et de points de vue.
ZC : La littérature qui n’est pas et ne peut pas être tout : c’est peut-être de là que vient votre intérêt pour les livres inachevés, inachevables, posthumes, comme vous l’écrivez dans Mac et son contretemps.
E V-M : Oui, Mac et son contretemps est une fantaisie sur les livres posthumes. En effet, à l’époque, étaient publiés de nombreux livres posthumes d’écrivains célèbres, comme Roberto Bolaño, José Saramago etc., c’était une mode dans le monde entier. C’est d’ailleurs toujours le cas aujourd’hui, en Espagne du moins où les agences littéraires sortent des oubliettes des textes inédits d’écrivains qui avaient été rejetés en leur temps par les éditeurs ; je pense par exemple à Jack el Decorador de Vásquez Montalbán, qui était son premier livre et qui a été publié après sa mort. Comme il était à la mode de parler de livre posthume, j’ai eu cette idée selon laquelle 53 Jours, le livre inachevé de Perec (publié après sa mort en 1989) ne l’était pas, en réalité ; je suggère qu’il avait tout calculé, même son interruption finale, pour faire une œuvre dont l’inachèvement fasse partie de l’achèvement.
Tous les écrivains laissent une œuvre posthume, car personne n’a réussi à aboutir à une œuvre parfaite et achevée.
Tous les écrivains laissent une œuvre posthume, car personne n’a réussi à aboutir à une œuvre parfaite et achevée. J’ai interviewé Salvador Dalí quand j’étais très jeune ; je lui ai rendu visite à son domicile de Cadaqués et lui ai posé de nombreuses questions inhabituelles sur Lacan, Freud et Raymond Roussel pour le magazine Destino. Il me regardait l’air de dire : allez, allez, passons… Je lui ai alors demandé : « L’œuvre parfaite existe-t-elle ? » et il m’a répondu : « Non, car si vous réalisez une œuvre parfaite, cela signifie que vous êtes déjà mort. »
ZC : Après avoir écrit son fragment sur Paris, le narrateur se retrouve dans l’impossibilité d’écrire, en proie au syndrome de Rimbaud. Il part à Montevideo, sur les lieux de la nouvelle de Cortázar, La Porte condamnée. Cet épisode est le prétexte du livre, son noyau central à partir duquel la recherche du sentier perdu de l’écriture commence mais aussi celui du brouillage entre fiction et réalité : la chambre 205 et la chambre contiguë sont-elles fiction ou réalité ? Peut-on voir dans le symbole de la porte la frontière entre les deux ? Le fait que la 206 disparaisse montre-t-il le brouillage entre réalité et fiction ?
E V-M : Quand je me suis rendu à Nancy en septembre pour un salon du livre, la chambre d’hôtel qu’on m’a attribuée était la 206 (j’ai une photo de la clef au cas où l’on ne me croirait pas). C’est un pur hasard, car personne, parmi le personnel de l’hôtel, n’avait lu mon livre et n’aurait compris l’allusion si je l’avais fait remarquer, mais le brouillage se trouvait là. D’autre part, l’objectif très clair de mon livre consistait à réaliser une enquête sur Montevideo. Il y a un détective dans quasi tous mes romans, qui enquête, qui veut savoir quelle sorte de vie on mène dans tel ou tel endroit. Montevideo s’est formé dans mon esprit lorsque j’ai lu que la critique argentine Beatriz Sarlo, parlant de La Porte condamnée de Cortázar, avait remarqué que la porte du titre était précisément « l’endroit exact où le fantastique fait irruption dans l’histoire. » Pensant qu’elle suggérait que la fiction et la réalité coexistaient parfaitement dans ce « lieu exact » qui se trouvait à la porte 205, j’ai conduit mon narrateur dans cette ville pour enquêter sur ce qui se passe lorsqu’on se trouve devant une porte condamnée où la réalité et la fiction coexistent. Cette enquête vise à trouver ce qui se cache derrière l’armoire, à savoir la porte de la 206, où il suppose que la fiction et la réalité se rejoignent. C’est un objectif peut-être absurde, en tout cas il est assurément très étrange mais j’ai néanmoins voulu m’en assurer par moi-même. J’ai donc voyagé à Montevideo avec l’idée de trouver ce point de jonction en louant cette chambre 205 pour une nuit, la chambre exacte louée par Cortázar en 1954 lors de son voyage à Montevideo. Dans une interview qu’il a donnée à ce moment-là, alors que le conte n’était même pas encore publié, il indique que c’était une très petite chambre, très sombre. Et j’ai voulu moi aussi me retrouver dans cette pièce. De fait, le roman commence véritablement quand mon narrateur se trouve dans cette chambre et qu’il regarde derrière l’armoire, comme dans le conte, et qui serait en quelque sorte la porte menant vers une dimension fantastique. Je n’avais jusqu’à présent jamais pratiqué le genre fantastique. On a dit que j’y étais entré en ouvrant cette porte. A quoi m’attendais-je en passant « à côté » ? Je n’en savais rien mais il fallait que je fasse ce geste pour savoir ce que mon imagination en ressortirait. Je me sentais comme obligé de traverser ce passage, cet entre-deux.
ZC : L’irruption du fantastique, après l’ouverture de la porte et l’entrée dans un autre monde, se traduit, comme dans un film de David Lynch, par des éléments horrifiques, comme l’araignée géante, ou inquiétants, comme l’étrange rituel de l’ami écrivain du narrateur, assis avec une grenouille morte sur les genoux, et qui se transfigure en une tout autre personnalité. Le fantastique est-il pour vous indissociable de cet aspect effrayant ?
E V-M : Oui, je place le fantastique sous le signe de la terreur, car c’est le sentiment que j’ai ressenti au moment d’écrire ce passage. En effet, je ne savais pas ce que j’allais trouver et j’ai supposé que le moment où l’on ouvre la porte pouvait être terrifiant.
Avant d’écrire mon livre, j’ai souhaité consulter un livre de l’Autrichien Alfred Kubin, intitulé L’Autre Côté. Il s’agit d’un délire onirique sur un royaume situé dans un autre monde. D’après le titre du livre et son intrigue, je me disais que cet « autre côté » serait similaire à celui que je cherchais. Mais finalement, je n’ai pas pu mettre la main dessus et c’est un mal pour un bien car je n’ai pas été influencé et j’ai pu raconter ma propre histoire. Il se trouve que j’ai imaginé que se trouvait derrière la porte un animal, une espèce d’araignée géante, que je croyais morte mais qui ne l’était pas du tout. Cortázar a écrit beaucoup d’histoires impliquant des animaux, notamment des araignées de toutes sortes, géantes etc. J’ai découvert, en lisant une courte lettre que lui a adressée Elena Poniatowska, que c’était quelque chose de très commun chez lui. On pourrait même interpréter ce voyage comme une tentative d’entrer en contact avec lui et avec son univers particulier. Et nous finissons par découvrir qui il était vraiment.
ZC : Malgré tout, votre ouvrage est aussi rempli d’épisodes humoristiques, pensons par exemple au narrateur qui, après avoir été empêché de dormir à cause des éclats de rire de son voisin de chambrée Jean-Pierre Léaud, doit sortir de sa chambre d’hôtel en pyjama vert car l’alarme incendie vient de retentir. Est-ce une manière de mettre le réel à distance pour mieux le supporter ou l’apprivoiser ?
Pour ma part, je ne prends pas la vie au sérieux, pas plus que la littérature, j’ai besoin d’en rire un peu.
E V-M : C’est possible. Et également pour rire de moi-même ou de ce que j’ai écrit. Il m’arrive souvent de relire mes textes et de me dire : « c’est bien mais là, je voudrais inclure un élément comique. » C’est une manière de ne pas me prendre au sérieux, de relativiser et de prendre du recul, pour montrer que je ne suis pas dupe et que je n’y crois pas tout à fait, tout comme le lecteur qui peut aussi se moquer de moi. Je n’aime pas les gens qui ont trop l’esprit de sérieux et qui assènent de grandes vérités générales. Rire de moi-même me permet de rire des autres. Avec la relecture, je vois d’un autre œil ce que j’ai écrit la veille et, en retirant tel passage ou tel autre que je trouve insuffisant ou trop exagéré, je donne un tour inattendu au manuscrit ; ce faisant, je progresse dans la narration. Il y a beaucoup de choses que je fais sans savoir pourquoi je les fais. Quand je parle en public, j’ai besoin qu’il rie au bout de cinq ou dix minutes, avec un commentaire contradictoire ou enfantin ou autre. J’ai néanmoins l’impression que la vie réelle est trop sérieuse. Pour ma part, je ne prends pas la vie au sérieux, pas plus que la littérature, j’ai besoin d’en rire un peu.
ZC : Il y a beaucoup d’interprétations possibles pour Montevideo. Mais le trop grand nombre d’interprétations peut conduire à une abondance de sens qui empêche, non d’écrire, mais de lire. C’est ce qui arrive à Simon dans Cette Brume insensée (Esta bruma insensata), qui devient un « artiste citeur », un pourvoyeur de citations.
E V-M : Cette notion d’artiste citeur est un peu sophistiquée, en effet, c’est délicat. Malheureusement, ce roman a été moins bien accueilli par le lectorat espagnol que Montevideo, c’est peut-être ma faute ou alors est-ce dû à un événement extérieur (la pandémie, une crise littéraire…). Il reste malgré tout, pour moi, un bon roman, que j’ai beaucoup travaillé et pour lequel j’ai pris des risques ; en effet, il est très étrange d’avoir pour personnage principal un homme qui vit de citations. Cet intérêt pour la citation remonte à mon ouvrage, Abrégé d’histoire de la littérature portative, écrit en 1985, dans lequel j’ai rassemblé des écrivains dans une société littéraire secrète que j’ai appelée Shandy ; ces écrivains citaient des phrases que j’avais trouvées au hasard dans tel ou tel livre et que je leur attribuais. Tabucchi m’a dit un jour que je rencontrerais beaucoup de problèmes avec les traducteurs, qui me demanderaient les noms des vrais auteurs de ces phrases avec les références pour les retranscrire dans leur langue, avec la formulation originale. C’est ce qui est arrivé et je leur ai répondu qu’il n’était pas possible pour moi de retrouver les sources car je ne me souvenais pas d’où elles sortaient. J’ai repris ce système de citations dans d’autres livres, en les modifiant jusqu’à les inventer et de fausses citations ont commencé à faire leur apparition, pour finir par constituer la moitié de l’ensemble des citations. Pour la petite histoire, mon traducteur français habituel, André Gabastou, qui maintenant connaît bien mon travail, n’y a vu que du feu la première fois qu’il a dû traduire un de mes livres. Il était tombé sur une phrase de Paul Valéry et, pour la retrouver, l’authentifier et la restituer telle qu’elle est formulée en français, il a dû se rendre sous la pluie à la Bibliothèque nationale de France. Il a fait la queue plus d’une heure pour entrer, et, quand il est entré, a passé deux autres heures à chercher la phrase, pour finalement se rendre compte que la première moitié de la phrase était de Paul Valéry et la seconde de moi. Il m’a maudit et m’a dit qu’il ne perdrait plus jamais trois heures à chercher l’origine d’une phrase.
Ce jeu sur les citations est très édifiant. Concrètement, dans ce livre, Montevideo, je cite soixante-huit auteurs. Ce qui change aujourd’hui, par rapport à mes débuts, c’est que les auteurs que je cite sont devenus au fil du temps, et pour moitié d’entre eux, totalement oubliés ou presque, et cela veut tout dire, c’est très significatif. On peut mettre cela sur le compte de la vitesse qui caractérise notre société moderne à l’heure des nouvelles technologies : tout doit être fait très vite, tout passe à la vitesse de la lumière, et cela est particulièrement vrai dans le monde de l’édition. Il se trouve qu’un auteur de la fin du XXe et du début du XXIe siècle, Roberto Bolaño, n’est plus aussi connu qu’avant. En citant ces auteurs, je leur donne une autre vie, je les ressuscite en les sauvant de l’oubli. Cela fonctionne pour certains, pour d’autres moins. Mais dans tous les cas, le rapport au temps est très important et même édifiant.
ZC : En lisant Montevideo et en échangeant avec vous, on se remémore le livre-hommage d’Anne Serre, Voyage avec Vila-Matas, où vous apparaissez vous-même en tant qu’auteur, narrateur et personnage de fiction. Dans son livre, vous (ou votre double) la croisez dans un train, en route pour un festival littéraire, puis vous vous retrouvez voisins de chambre dans un hôtel.
E V-M : J’ai lu le livre en me demandant si son personnage, censé être moi, finirait par entrer dans sa chambre ou non. Je regarde ce personnage comme mon enfant illégitime, un enfant non déclaré dont on ne sait pas s’il existe vraiment. Et pour l’anecdote, j’ai rencontré Anne Serre « dans la vraie vie » au Collège de France, nous nous sommes dit bonjour, nous nous sommes souri et puis… rien, nous n’avions rien à nous dire. Tout s’est passé très vite, il y avait beaucoup de monde… C’est assez drôle, a posteriori. Elle a d’ailleurs écrit sur ce moment et je suis d’accord avec elle sur le fait que je ne savais pas quoi dire.
Je suis apparu, sous la forme d’un personnage, dans vingt-cinq livres environ, d’après ce qu’on m’a dit. Sur le moment, je n’y crois pas, je me dis que ce n’est pas sérieux et puis un autre livre sort dans lequel j’apparais encore une fois. Et ainsi de suite. Récemment, j’ai acheté Nocturne à Gibraltar de Gennario Serio, un jeune auteur italien, dont c’est le premier roman. Il a remporté le prix Italo Calvino en 2019. Dans ce livre, je suis accusé d’avoir tué un journaliste qui m’a interviewé dans un hôtel de Barcelone. Je disparais et un enquêteur se lance à ma poursuite. On m’a demandé une postface pour l’édition française. Ce que j’ai fait ; et dans cette postface, je demande à l’auteur pourquoi il en est arrivé à imaginer une telle chose, à savoir tuer un journaliste ; d’où cela sort-il ? J’aimerais bien savoir, car il ne me connaissait pas personnellement.
ZC : Le lecteur n’est jamais sûr de pouvoir démêler le faux du vrai mais, s’il adhère à votre pacte de lecture, il y prend du plaisir. La littérature consiste-t-elle aussi en un rapport de force entre l’auteur qui impose et le lecteur qui se soumet ?
E V-M : L’auteur doit séduire le lecteur pour que ce dernier poursuive sa lecture. Les jeunes auteurs mettent parfois du temps à s’en rendre compte ; ainsi, pour ma part, j’ai commencé à écrire en tournant le dos au lecteur. Il y a longtemps, je me suis rendu à un concert de Miles Davis à Barcelone, au Palau de la Musica, c’était en 1973 sous Franco. L’ambiance était très collet monté, nous n’avions même pas le droit de danser. Miles Davis est arrivé et, comme il le faisait souvent, il a joué dos au public. Il s’est fait huer et a été traité de prétentieux par le public. Pourtant, il s’agissait d’amateurs de jazz avertis mais issus de la classe moyenne. Ils le voulaient aussi sympathique et divertissant que Louis Armstrong. C’était sa façon de jouer, de se concentrer sans se soucier du public, cela m’a beaucoup impressionné.
Dans La Lecture assassine, qui est le deuxième ouvrage que j’ai publié, j’ai eu l’idée, en m’inspirant d’Unamuno, d’écrire un livre qui causerait la mort de son lecteur. J’ai suivi la méthode de Davis et j’ai écrit en tournant le dos au public, puis j’ai réfléchi et me suis dit qu’il fallait que j’attire le lecteur pour qu’il me suive. C’était une découverte fondamentale que je garde maintenant toujours à l’esprit pour retenir le lecteur, l’empêcher de quitter le livre. J’ai appliqué ce raisonnement pour Montevideo également, en ayant recours à des événements qui se sont réellement produits, et qui peuvent donc susciter la curiosité du lecteur, tout en les modifiant à la marge. Mais tout est réel, je pense par exemple à l’exposition du Centre Pompidou, à la fin du roman, qui a vraiment eu lieu et qui a vraiment mis en scène une chambre d’hôtel avec une clef unique, comme je le raconte. On a pensé qu’il s’agissait d’une invention mais ce n’était pas le cas.
ZC : Justement, et pour conclure, le narrateur dit ne pas croire en un monde intérieur. Il est pourtant poussé à s’y confronter dans la fausse chambre 19, créée dans le cadre de cette exposition à Beaubourg, et c’est par l’introspection, l’exploration de sa « chambre à soi » et l’ouverture de la porte qu’il revivra une expérience traumatisante et qu’il parviendra à retrouver le goût de l’écriture. L’écriture est-elle finalement une catharsis ?
E V-M : Oui, tout à fait. On me demande toujours, quand je termine un livre : « Que vas-tu faire maintenant que tu as poussé les choses à une telle extrémité ? Que peux-tu faire de plus ? ».
Alors je cherche une issue, si petite soit-elle, qu’il s’agisse par exemple de cette petite chambre d’hôtel de Bogota répliquée dans l’exposition de Beaubourg, pour, justement, m’échapper du piège. Un sage a dit un jour (et c’est ce que mon père me répétait) : l’intelligence est un moyen qui permet de s’échapper de ce qui nous a piégés. Cela s’applique à tout le monde. Nous avons tous les moyens de nous échapper, même si c’est par le plus petit trou possible. Cet épisode de la chambre d’hôtel de l’exposition est bien réel, comme je le disais. La commissaire de l’exposition m’a donné la clef de cette chambre et je me suis rendu à Beaubourg, c’était quelques jours avant les attentats de Paris en 2015. Je suis entré et j’ai vu une valise rouge à l’intérieur. J’ai alors pensé qu’il y avait une autre sortie, une autre porte, mais ce n’était pas le cas. Je suis rentré à Barcelone et deux semaines après, j’ai voulu y retourner pour vérifier si un autre élément avait pris place entre-temps dans cette petite chambre mais les attentats ont interrompu mes allers-retours à Paris.
Nos remerciements à José Rubio

- Entretien réalisé et traduit de l’espagnol par Guillaume Narguet
***
Enrique Vila-Matas : « La novela es un viaje mental »
Montevideo (publicado por Actes Sud, 2023), el último libro de Enrique Vila-Matas, sigue la estela de sus obras anteriores, con una reflexión cada vez más detallada y profunda sobre la literatura y una búsqueda incansable de la clave de la escritura que le permita comprender lo que le impide escribir. Tras buscar el Santo Grial en la historia de la literatura (Historia abreviada de la literatura portátil), en la huida de la realidad (Lejos de Veracruz), en la obra póstuma (Mac y su contratiempo) y en las citas (Esta bruma insensata), esta vez, Vila-Matas prosigue su viaje por los cuatro puntos cardinales, entre Montevideo y París, Reikiavik y Bogotá o St. Gallen, desde una exposición de arte contemporáneo en Beaubourg hasta la habitación 205 del Hotel Cervantés.
El lector, como un nuevo Dante guiado (¿o extraviado?) por un autor-narrador Virgilio, se pierde con deleite en una narración entretejida como muñecas rusas, un laberinto en el que se entremezclan varias “tendencias narrativas” y en el que los puntos de referencia temporales y espaciales se difuminan con mise en abyme, citas, digresiones, autorreferencialidad y referencias a Cortázar, Melville o Valéry. Montevideo crea un universo en el que vemos personajes tan diferentes como Miles Davis y Mallarmé conversando o Jean-Pierre-Léaud riendo en una habitación de hotel, y nos invita a adentrarnos en el corazón mismo de las obras literarias, en lo que las convierte en lo que son, en una palabra, ficción.
Aunque su última obra, Montevideo, no se puede resumir en pocas palabras porque no tiene una narración lineal, sí podemos decir que es una búsqueda por parte del escritor-narrador (¿quizá usted? ¿quizá otra persona?) de las razones que le impiden escribir. En su libro, Miles Davis le pregunta a Mallarmé: “¿No es porque usted escribe sobre lo que le impide escribir? En otras palabras, ¿no es lo más importante para un escritor la investigación que conduce a la obra?
Sí, efectivamente, eso es lo más importante. La investigación que me llevó a Montevideo comenzó en el siglo pasado, durante un viaje a Buenos Aires. Durante un encuentro con la escritora argentina Vlady Kociancich, amiga de Borges, me informó de que había un cuento de Julio Cortázar, titulado La puerta condenada, que era muy parecido a otro cuento de Adolfo Bioy Casares, escrito casualmente en el mismo año. Los dos relatos tienen una trama casi idéntica y muchos elementos comunes (en los personajes, las descripciones…) y ambos transcurren en el Hotel Cervantes de Montevideo [para situarnos, el héroe de la historia, Petrone, es despertado cada noche en su pequeña habitación de un hotel muy antiguo por los llantos de un niño que oye a través de la puerta que antes comunicaba con la habitación de al lado. Sin embargo, el gerente le asegura que no hay niños arriba, ni siquiera en el hotel…]. Este fue el punto de partida de mi libro: partiendo del resumen bastante breve del cuento de Cortázar, llegué al verdadero objetivo de mi narrador, que era investigar un lugar concreto, la habitación del hotel donde transcurre la historia. Ya había localizado el lugar. Hoy, el Hotel Cervantes se ha convertido en el Esplendor. Mi narrador va allí con la esperanza de encontrar esa pequeña habitación y la puerta cerrada tras el armario.
¿Es su libro un nuevo volumen de la serie “patologías de la escritura” (compuesta por Bartleby, El mal de Montano y Doctor Pasavento)? ¿Es metaliterario o metaficción?
Diría que los conceptos “meta” (metaficción, autoficción…) me molestan un poco. En España se utilizan constantemente para calificar o descalificar mi obra. La llamada meta-literatura es un disparate. Sí, claro, el Quijote es meta-literario, pero nunca es fundamentalmente “meta”. Es, ante todo, una historia de ficción. También se podría decir que la Biblia es metaficción: alguien la escribió, no surgió de la nada.
Debo señalar que el término “autoficción” es francés; apareció por primera vez en la novela Fils, de Serge Doubrovsky, en 1977.
En España todavía se utiliza mal. Por ejemplo, al principio me prohibieron utilizar la palabra cuando tenía que dar una charla ante un público bastante conservador en alguna provincia española. Me preguntaba por qué no entendían el término. Pues bien, ahora resulta que es al revés: todo el mundo entiende lo que es la autoficción y todo el mundo cree que lo hace, pero obviamente no es así… En efecto, hay una línea muy fina entre, por un lado, contar los problemas de relación que un autor tuvo con su padre cuando era joven y “autoficcionalizarlo” un poco, penetrar un poco en lo que es la literatura a través de la autoficción, jugar con este proceso y, por otro lado, simplemente hacer creer al lector que lo que estás contando te ha pasado a ti personalmente (o al narrador) cuando no es así y es puramente una obra de la imaginación.
El problema que resulta de esta confusión lo resolví hace poco en un programa de la televisión catalana para amas de casa menores de cincuenta años, que generalmente son las ayudas a domicilio de los jubilados, un programa de fin de jornada para el que no hace falta complicar las cosas con conceptos literarios y analíticos, como se puede hacer en su revista Zone Critique, por ejemplo. Durante este programa, me preguntaron por qué no me gustaba el término autoficción. Respondí: “No es tanto que no me guste, es simplemente que la palabra ‘ficción’ es más corta, ahorra tiempo”, sobre todo porque sabemos muy bien que, en definitiva, todo autor, cuando escribe, transforma la realidad de los hechos, los interpreta a su manera, cambia en cierto modo su personalidad.
Otro eterno problema es si vida y obra van de la mano o si deben separarse. Personalmente, creo que es la obra lo que cuenta para un escritor. Es la obra la que nos habla de su personalidad, aunque no escriba específicamente sobre sí mismo, no los detalles. En lo que a mí respecta, a menudo me dicen que me parezco a mi obra. Y eso es un verdadero problema, porque en la vida real prefiero hablar de fútbol que de grandes debates metafísicos o literarios… Y eso es lo que siempre digo a mis interlocutores, que creen hacer lo correcto.
Montevideo es un viaje a través del espacio (por Montevideo, París, St. Gallen…), a través del tiempo (asistimos a un encuentro fantástico entre Miles Davis y Mallarmé) y a través de diferentes estilos: sueño, memoria, ficción, realidad, fantasía. ¿Considera el viaje como una forma de materializar la literatura, en el sentido de que parte para descubrir su mundo interior y perderse en él, de ahí el aspecto laberíntico de su obra? ¿O es más bien una forma de salvarse de la imposibilidad de escribir?
La Odisea es la ficción fundacional de Occidente, y creo que eso se debe precisamente a que es una historia de viajes. Cuando inicias un viaje, necesariamente lo terminas; luego cuentas la historia: así que eso ya es una historia. También es el formato ideal para contar la historia de una búsqueda: vas en busca de algo (material o una idea) y lo encuentras (o no), es un concepto tan antiguo como el tiempo mismo. El viaje de Don Quijote, por ejemplo, es un viaje de ida y vuelta a la muerte. Así que siempre se trata de cómo desarrollas un proceso que te lleva del punto A al punto B, que es tu objetivo final.
Para mí, la novela es un viaje mental, y dentro de la novela describo un viaje real que lleva al lector a lugares que no son imaginarios. Pero eso no significa que necesariamente conozca todos los lugares mencionados. En el caso de Montevideo, los conozco casi todos, aparte de Reikiavik.
Entonces, todo depende de cómo cuente el viaje; cuando le cuento la historia a la persona con la que estoy hablando, y la describo tal como sucedió, es la primera vez que cuento la historia, y sin darme cuenta, casi inconscientemente, ya he decidido lo que sucedió. Como no he recorrido el mundo en su totalidad, no puedo incluir en esta historia elementos de los que no necesariamente seré consciente, pero estructuro mi relato de tal manera que incluyo cosas inventadas, incluso cosas que habré olvidado.
El argumento, la trama no cuentan realmente; son el lenguaje y el ritmo de la historia los que resultan más interesantes. ¿Será porque son más personales y revelan la identidad del escritor, “su espíritu”, en términos de Paul Valéry?
Pensaba en esta figura de escritor como en el final del camino, como si fuera a morir después de mi trasplante de riñón, dejando atrás un borrador de mi novela en lugar de la versión final, como si quisiera dejar un mensaje. La verdad es que me gusta mucho la literatura y quería mostrar lo que me hubiera gustado hacer y la dirección que hubiera querido tomar. Mientras me preparaba para la operación, empecé a decirme: “Basta de florituras, haz lo que realmente te gusta”. Así que entré en un laberinto, que empezó en París en 1974 con un narrador que se hacía pasar por escritor, y que acabó conduciéndome a Paul Valéry. Pero no quería hacer un Paul Valéry. Me di cuenta de que aún me quedaba mucho camino por recorrer para convertirme en ensayista. Y por eso la primera de las cinco tendencias narrativas que identifiqué, la de los que no tienen nada que decir, que me caracterizó durante mi estancia en París, me pareció un callejón sin salida. Pasaron tres años durante los cuales no escribí, precisamente porque había llegado a un callejón sin salida. A menudo me dicen que trato demasiado el tema de dejar de escribir, porque ya he hablado de ello en Bartleby y compañía y en otras novelas. Pero no es que me repita; es sobre todo porque tengo que volver a empezar, una y otra vez. Ya lo había hecho en El mal de Montano, mi libro escrito en 2003, para decir que todo lo que había dicho hasta entonces no era cierto. Ahora empiezo a decir la verdad. Lo curioso de los tres años en los que dejé de escribir es que empecé a vivir cosas reales, que me sentí obligado a contar en el libro (y esta es la parte de la novela que probablemente más me interesaba) porque todas me parecen relatables. Diría que en este punto, y todavía es demasiado pronto en el libro para darme cuenta realmente de ello, el aspirante a ensayista que siempre he sido y que quería ser al escribir desde el punto de vista de un ensayista, se convierte en lo que realmente es, es decir, en un narrador. Me siento muy cómodo contando historias como narrador, pero no como ensayista, porque no es exactamente lo mismo. Me cuesta mezclar pensamiento y ficción. Javier Marías dijo una vez que narrar no tiene mucho misterio; me parece muy extraño que diga eso, porque para mí, al contrario, es muy difícil narrar. Cada cual como quiera…
Para el narrador, la literatura representa un espacio de libertad tan inmenso que autoriza todo tipo de contradicciones, y esta autonomía absoluta es particularmente cierta en el caso de los escritores franceses. Usted escribe que todos los verdaderos escritores son franceses, aunque no sean de nacionalidad francesa. ¿Cómo explica esta especificidad? ¿Por qué un escritor tiene que ser francés?
No sabría decirlo, porque nunca me habían hecho esa pregunta. Creo que se debe a mi formación cultural, a mi estancia en París durante algunos años a partir de 1974, a mi relación con Marguerite Duras. Y también porque, para mí, la literatura siempre ha sido francesa, lo que no quita méritos a las demás: inglesa, alemana y toda la literatura occidental en general. Pero es la literatura francesa la que mejor practico, aquella en la que la figura del escritor ha florecido más hasta ahora, al menos hasta hace poco. Y para mí, la literatura es Francia. No lo digo categóricamente, pero una vez bromeé diciendo que Dios no puede escribir porque no es francés. La literatura es un espacio de paradojas y contradicciones, me permite jugar con frases que yo mismo no entiendo, pero que sin embargo están ahí, escritas. Después de mi operación, cuando me di cuenta de que iba a vivir aunque todavía no me había recuperado de todo, me permití escribir con total libertad. Escribir me hizo sentir tan libre que me permití escribir frases que salían de mi mente sin que yo las pensara. Y me pareció tan curioso que las dejé tal cual, sobre el papel. Todo el libro, como te das cuenta al final, es en última instancia una búsqueda de una habitación propia, por utilizar la expresión de Virginia Woolf.
En este libro, creo que me he permitido una libertad de escritura que nunca antes había experimentado. Es una elección personal consciente que me empuja a seguir mi propia lógica, a hacer lo que quiero. Sé que algunas personas lo verán con malos ojos, pero vivirán con ello porque así es como pienso.
Mientras escribía mi libro (ni siquiera había empezado la versión definitiva), leía la última obra de Martin Amis y, aunque no la terminé, me llamó la atención que escribiera al estilo de Nabokov, es decir, sin preocuparse de nada y construyendo una especie de estructura en la que la libertad es la palabra clave y está perpetuamente al servicio del escritor. A pesar de todo, hice muchas correcciones, suprimiendo pasajes enteros que, sin embargo, eran buenos, como si fueran engranajes inútiles de una gran máquina de los que uno se deshace por razones de eficacia. Aquí me permitió saltar de un lugar a otro, de una ciudad a otra. En un momento de mi libro, el narrador se encuentra en tres lugares diferentes: en una habitación de París, pero también en Shangai y en Bogotá, y todo ello conforma un viaje mental en el que yo tengo el control total del espacio y puedo ir de un sitio a otro con facilidad, porque soy yo quien ha montado esta máquina, esta especie de caja que me permite ir donde quiera. Tengo en mente un ejemplo, el de la película de Mike Leigh sobre Turner. Vemos a Turner en la exposición de la Royal Academy, entre sus colegas pintores que dan los últimos retoques a sus cuadros. Los observa y se da cuenta de que su propio cuadro, Helvoetsluys, que ya está terminado, no destaca entre los demás; todos son paisajes marinos. Así que coge el pincel y pinta un salvavidas rojo en medio del mar. Me fascina y me gusta mucho porque me recuerda lo que intento hacer yo mismo, que es organizar el espacio suficiente para permitirme ir y venir a mi antojo en mi trabajo, “pintar mi cuadro”, y disponer de todo el arsenal necesario para añadir pequeños toques aquí y allá y volver a la obra supuestamente terminada. Es muy divertido para el escritor. No siempre me divertí escribiendo, tuve que aprender a hacerlo. Por otro lado, tengo cuidado de no dejar volar mi imaginación en mitad del libro, porque si dejo de seguir mi plan, sucumbiré a una libertad desenfrenada.
El narrador define cinco tendencias narrativas. Se incluye en la primera, la de los que no tienen nada que contar, cuando aún no hay literatura, frente a la cuarta, la de los que quieren contarlo todo, cuando ya no hay literatura porque, por ese aspecto totalitario, se vuelve imposible y aburrida. ¿No es la literatura más bien el término medio, la tendencia de los que no lo cuentan todo combinando el minimalismo de Tabucchi con la grandiosidad de Melville?
Precisamente, me han invitado a una conferencia en Barcelona en noviembre sobre Moby Dick y Dama de Porto Pim de Tabucchi, con Rodrigo Fresán, un especialista en Melville. Voltaire escribió: “El secreto de aburrir sería decirlo todo” y creo que tiene razón; en cualquier caso, nadie lo ha dicho nunca todo. En la obra de Kafka ocurre lo contrario: en El proceso, por ejemplo, alguien le grita a K. durante su interrogatorio: “¡Dímelo todo, quiero saberlo todo! Quiero saber toda la verdad, hasta el último extremo”. Esto refleja la ambición de totalidad de Kafka. Por tanto, se opone totalmente a la idea de Voltaire. Creo que el privilegio de la literatura es ser el receptáculo de todo tipo de opiniones y puntos de vista, algunos perfectamente admisibles, otros que no son más que la continuación o la repetición de ideas ya formuladas. Por eso me interesan los escritores singulares que intentan desmarcarse de la masa con una nueva teoría o una nueva idea de lo que es la literatura. Eso no quiere decir que no odie a algunos, pero siempre que estén bien presentados, los tengo en cuenta, los estudio y, en ese caso, me quito el sombrero ante ellos. Hay que aceptar que la literatura es una extraordinaria colección de opiniones y puntos de vista.
Hablamos de la literatura que no puedes hacerlo todo, quizás de ahí venga su interés por los libros inacabados o inatrapables o póstumos, como escribe en Mac y su contratiempo.
Sí, Mac y su contratiempo es una fantasía sobre libros póstumos. En aquella época se publicaban en todo el mundo libros póstumos de escritores famosos como Roberto Bolaño y José Saramago. Esto sigue ocurriendo hoy en día, al menos en España, donde las agencias literarias sacan a la luz textos inéditos de escritores que en su día fueron rechazados por las editoriales; pienso, por ejemplo, en Jack el decorador, de Vásquez Montalbán, que fue su primer libro y se publicó después de su muerte. Como estaba de moda hablar de libros póstumos, se me ocurrió la idea de que 53 Jours, el libro inacabado de Perec (publicado después de su muerte, en 1989), no estaba, de hecho, inacabado; estoy sugiriendo que lo había planeado todo, incluso su interrupción final, para crear una obra cuya incompletud formaba parte de su finalización. Todos los escritores dejan una obra póstuma, porque nadie ha logrado producir una obra perfecta, acabada. Entrevisté a Salvador Dalí cuando era muy joven; le visité en su casa de Cadaqués y le hice muchas preguntas nada normales sobre Lacan, Freud y Raymond Roussel para la revista Destino. Me miró como diciendo : vaya, vaya… Le pregunté: “¿Existe la obra perfecta?” y me contestó: “No, porque si haces una obra perfecta es que ya estás muerto”.
Tras escribir su fragmento sobre París, el narrador se ve incapaz de escribir, aquejado del síndrome de Rimbaud. Parte hacia Montevideo, donde se desarolla la trama del cuento de Cortázar La puerta condenada. Este episodio es el pretexto del libro, el punto central desde el que se inicia la búsqueda del camino perdido de la escritura, pero también el punto de partida de la difuminación de los límites entre ficción y realidad: ¿la habitación 205 y la contigua son ficción o realidad? ¿Marca el símbolo de la puerta la frontera entre ambas? ¿El hecho de que la 206 desaparezca muestra la difuminación entre realidad y ficción?
Cuando fui a Nancy en septiembre para una feria del libro, la habitación de hotel que me asignaron era la 206 (tengo una foto de la llave por si alguien no me cree). Fue pura casualidad, porque ninguno de los empleados del hotel había leído mi libro y no habría captado la indirecta si se lo hubiera indicado, pero ahí estuvo la confusión. Por otra parte, el objetivo muy claro de mi libro era investigar Montevideo. En casi todas mis novelas hay un detective que investiga, que quiere saber qué tipo de vida lleva la gente en tal o cual lugar. Montevideo me vino a la mente cuando leí que la crítica argentina Beatriz Sarlo, hablando de La puerta condenada, de Cortázar, había comentado que la puerta del título era precisamente “el lugar exacto donde lo fantástico irrumpe en el relato”. Pensando que ella estaba sugiriendo que ficción y realidad convivían perfectamente en ese “lugar exacto” que era la puerta 205, llevé a mi narrador a la ciudad para investigar qué ocurre cuando uno se encuentra frente a una puerta condenada en la que conviven realidad y ficción. El objetivo de esta investigación es averiguar qué hay detrás del armario, es decir, de la puerta 206, donde él supone que se encuentran la ficción y la realidad.
Puede que sea un objetivo absurdo, o al menos muy extraño, pero quería averiguarlo por mí mismo. Así que viajé a Montevideo con la idea de encontrar ese cruce alquilando por una noche esta habitación 205, la misma que alquiló Cortázar en 1954 durante su viaje a Montevideo. En una entrevista que dio en esa época, cuando todavía no se había publicado el cuento, dice que era una habitación muy pequeña, muy oscura. Y yo también quería encontrarme en esa habitación. De hecho, la novela empieza realmente cuando mi narrador se encuentra en esa habitación y mira detrás del armario, como en el cuento de hadas, que sería una especie de puerta que conduce a una dimensión fantástica. Hasta ahora, nunca había trabajado en el género fantástico. Se ha dicho que entré en él abriendo esta puerta. ¿Qué esperaba cuando la atravesé? No lo sabía, pero tenía que hacerlo para descubrir qué se le ocurriría a mi imaginación. Me sentí obligado a cruzar este pasaje, este punto intermedio.
Una vez que se ha abierto la puerta y hemos entrado en otro mundo, la fantasía irrumpe, como en una película de David Lynch, en forma de elementos terroríficos, como la araña gigante, o perturbadores, como el extraño ritual del amigo escritor del narrador, que se sienta con una rana muerta en el regazo, transfigurado en una personalidad completamente distinta. Para usted, ¿es la fantasía inseparable de este aspecto aterrador?
Sí, coloco la fantasía bajo el signo del terror, porque ésa es la sensación que tenía cuando escribía este pasaje. No sabía lo que me iba a encontrar y supuse que el momento en que se abriera la puerta sería terrorífico. Antes de escribir mi libro, quise consultar una obra del austriaco Alfred Kubin, titulada El otro lado. Es un delirio onírico sobre un reino en otro mundo. Por el título del libro y su argumento, pensé que ese “otro lado” se parecería al que yo buscaba. Pero al final no pude hacerme con él, y eso es una bendición, porque no me dejé influenciar y pude contar mi propia historia. Resulta que me imaginé que detrás de la puerta había un animal, una especie de araña gigante, que yo creía muerta pero que no lo estaba en absoluto. Cortázar escribió muchos cuentos con animales, sobre todo arañas de todo tipo, gigantes, etcétera. Descubrí, cuando leí una breve carta que le escribió Elena Poniatowska, que esto era algo muy habitual en él. Incluso se podría interpretar este viaje como un intento de entrar en contacto con él y con su mundo particular. Y acabamos descubriendo quién era realmente.
A pesar de todo, su obra también está llena de episodios humorísticos, como el del narrador que, tras no poder dormir por las risas de su compañero de habitación Jean-Pierre Léaud, tiene que salir de su habitación de hotel en pijama verde porque acaba de sonar la alarma de incendios. ¿Es una forma de distanciar la realidad para afrontarla mejor o domarla?
Puedo serlo. Y también reírme de mí mismo o de lo que he escrito. A menudo releo mis textos y me digo: “Está bien, pero me gustaría incluir aquí un elemento cómico”. Es una forma de no tomarme demasiado en serio, de relativizar y dar un paso atrás, para demostrar que no me engaño y que no me lo creo del todo, igual que el lector, que también puede reírse de mí. No me gusta la gente demasiado seria que afirma verdades generales. Reírme de mí mismo me permite reírme de los demás. La corrección me permite volver a ver lo que escribí la víspera y, al suprimir uno u otro pasaje que me parece insuficiente o demasiado exagerado, doy al manuscrito un giro inesperado; al hacerlo, avanzo en la narración. Hay muchas cosas que hago sin saber por qué las hago. Cuando hablo en público, necesito que se ría a los cinco o diez minutos, con un comentario contradictorio, infantil o lo que sea. Sin embargo, tengo la impresión de que la vida real es demasiado seria. Personalmente, no me tomo la vida en serio, como tampoco me tomo en serio la literatura, necesito reírme un poco.
Por otra parte, demasiadas interpretaciones diferentes pueden conducir a una abundancia de significados que impida no escribir, sino leer. Es lo que le ocurre a Simon en Esta bruma insensata, que le lleva a convertirse en un “artista citor”, un proveedor de citas.
Esta noción del artista como escritor es un poco sofisticada, de hecho, es tramposa. Desgraciadamente, esta novela no ha sido tan bien recibida por los lectores españoles como Montevideo, lo cual puede ser culpa mía, o puede deberse a un acontecimiento externo (la pandemia, una crisis literaria…). A pesar de todo, sigo pensando que es una buena novela, en la que he trabajado mucho y me he arriesgado, porque es muy extraño tener como protagonista a un hombre que vive de las citas. Este interés por las citas se remonta a mi libro Historia abreviada de la literatura portátil, escrito en 1985, en el que reunía a escritores en una sociedad literaria secreta que yo llamaba Shandy; estos escritores citaban frases que yo había encontrado al azar en tal o cual libro y que les atribuía. Tabucchi me dijo una vez que me encontraría con muchos problemas con los traductores, que me pedirían los nombres de los verdaderos autores de esas frases y las referencias para poder transcribirlas a su propio idioma, con la redacción original. Eso es lo que pasaba, y yo les decía que no me era posible encontrar las fuentes porque no recordaba de dónde venían. Utilicé este sistema de citas en otros libros, modificándolas hasta el punto de inventarlas, y empezaron a aparecer citas falsas, que llegaron a constituir la mitad de todas las citas.
Como anécdota, mi traductor francés habitual, André Gabastou, que ahora conoce bien mi obra, no se dio cuenta de nada la primera vez que tuvo que traducir uno de mis libros. Se había topado con una frase de Paul Valéry y, para encontrarla, autentificarla y restituirla tal como está escrita en francés, tuvo que ir a la Bibliothèque nationale de France bajo la lluvia. Hizo cola durante más de una hora para entrar y, cuando lo consiguió, se pasó otras dos horas buscando la frase, sólo para darse cuenta de que la primera mitad de la frase era de Paul Valéry y la segunda mía. Me maldijo y me dijo que nunca volvería a perder tres horas buscando el origen de una frase. Este juego de citas es muy edificante. De hecho, en este libro, Montevideo, cito a sesenta y ocho autores. Lo que es diferente ahora, en comparación con cuando empecé, es que los autores que cito se han convertido, con el tiempo, y para la mitad de ellos, en totalmente olvidados o casi olvidados, y eso es mucho decir, es muy significativo. Esto se debe a la velocidad que caracteriza a nuestra sociedad moderna en la era de las nuevas tecnologías: todo tiene que hacerse muy deprisa, todo se mueve a la velocidad de la luz, y esto es particularmente cierto en el mundo editorial. Resulta que un autor de finales del siglo XX y principios del XXI, Roberto Bolaño, ya no es tan conocido como antes. Al citar a estos autores, les doy otra vida, los resucito del olvido. A algunos les funciona, a otros no tanto. Pero en todos los casos, la relación con el tiempo es muy importante e incluso edificante.
Leer Montevideo y hablar con usted me recuerda el libro homenaje de Anne Serre, Viaje con Vila-Matas, en el que usted mismo aparece como autor, narrador y personaje de ficción. En su libro, usted (o su doble) se encuentra con ella en un tren, de camino a un festival literario, y luego son compañeros de habitación en un hotel.
Leí el libro preguntándome si su personaje, que se supone que soy yo, acabaría en su habitación o no. Veo a este personaje como mi hijo ilegítimo, un hijo no declarado que no sabemos si existe realmente. Y en cuanto a la anécdota, conocí a Anne Serre “en la vida real” en el Collège de France, nos saludamos, nos sonreímos y luego… nada, no teníamos nada que decirnos. Todo sucedió muy deprisa, había mucha gente… Es bastante gracioso, en retrospectiva. De hecho, escribió sobre ese momento y estoy de acuerdo con ella en que no sabía qué decir. He aparecido, en forma de personaje, en unos veinticinco libros, según me han contado. En ese momento, no me lo creo, me digo que no es serio, y luego sale otro libro en el que vuelvo a aparecer. Y así sucesivamente. Hace poco compré Nocturno a Gibraltar, de Gennario Serio, un joven autor italiano, que es su primera novela. Ganó el Premio Italo Calvino en 2019. En este libro, me acusan de matar a un periodista que me entrevistó en un hotel de Barcelona. Desaparezco y un investigador me persigue. Me pidieron que escribiera un epílogo para la edición francesa. Así que lo hice, y en el epílogo le pregunto al autor por qué se le ocurrió eso de matar a un periodista. Me gustaría saberlo, porque él no me conocía personalmente.
Los lectores nunca pueden estar seguros de poder distinguir lo falso de lo verdadero, pero si se adhieren a su pacto de lectura, se complacen en ello. ¿Es también la literatura una lucha de poder entre el autor que impone y el lector que se somete?
El autor tiene que seducir al lector para que siga leyendo. Los autores jóvenes a veces tardan en darse cuenta de esto; por ejemplo, yo empecé a escribir de espaldas al lector. Hace mucho tiempo, fui a un concierto de Miles Davis en Barcelona, en el Palau de la Música, en 1973, bajo el franquismo. El ambiente era muy tenso, ni siquiera nos dejaban bailar. Miles Davis llegó y, como hacía a menudo, tocó de espaldas al público. El público le abucheó y le llamó pretencioso. Sin embargo, se trataba de aficionados al jazz bien informados y de clase media. Querían que fuera tan simpático y divertido como Louis Armstrong. Lo que realmente me impresionó fue su forma de tocar, de concentrarse sin preocuparse por el público. En La asesina ilustrada, que es el segundo libro que publico, tuve la idea, inspirándome en Unamuno, de escribir un libro que provocara la muerte de su lector. Seguí el método de Davis y escribí de espaldas al público, luego reflexioné y me dije que tenía que atraer al lector para que me siguiera. Fue un descubrimiento fundamental que ahora tengo siempre presente cuando escribo. Fue un descubrimiento fundamental que ahora tengo siempre presente para retener al lector, para evitar que abandone el libro. Apliqué este razonamiento también a Montevideo, utilizando acontecimientos que sucedieron realmente y que, por tanto, pueden despertar la curiosidad del lector, modificándolos al margen. Pienso, por ejemplo, en la exposición en el Centro Pompidou al final de la novela, que ocurrió de verdad y que realmente tenía que ver con una habitación de hotel con una llave única, según cuento. La gente pensaba que era una invención, pero no lo era.
Para concluir, el narrador dice que no cree en un mundo interior. Sin embargo, se ve obligado a enfrentarse a él en la falsa Habitación 19, creada en el marco de esta exposición en Beaubourg, y es a través de la introspección, la exploración de su “habitación privada” y la apertura de la puerta como revive una experiencia traumática y redescubre el gusto por la escritura. ¿Escribir es, en definitiva, una catarsis?
Sí, lo es. La gente siempre me pregunta cuando acabo un libro: “¿Qué vas a hacer ahora que has llevado las cosas tan al extremo? ¿Qué más puedes hacer? Así que busco una salida, por pequeña que sea, ya sea esa pequeña habitación de hotel en Bogotá reproducida en la exposición del Beaubourg, para escapar de la trampa. Un sabio dijo una vez (y es lo que mi padre me repetía): la inteligencia es un medio para escapar de lo que nos ha atrapado. Eso se aplica a todos. Todos tenemos medios para escapar, aunque sea por el agujero más pequeño posible. Este episodio en la sala del hotel de la exposición es muy real, como decía. El comisario de la exposición me dio la llave de esa habitación y fui a Beaubourg, fue unos días antes de los atentados de París de 2015. Entré y vi una maleta roja dentro. Pensé que había otra salida, otra puerta, pero no era el caso. Regresé a Barcelona y dos semanas después quise volver para ver si había ocurrido algo más en aquella pequeña habitación mientras tanto, pero los atentados terroristas interrumpieron mis idas y venidas a París.

















