
Cormac McCarthy, né en 1933 à Providence (Rhode Island), est un écrivain américain auteur de plus d’une dizaine de romans, dont La route en 2006 (Prix Pulitzer), Suttree en 1979, Méridien de sang en 1985 et plus récemment Le passager et Stella Maris, publiés en français en 2023. Ce dernier et peut-être ultime roman de McCarthy est l’occasion pour nous de sonder à nouveau son œuvre immense, et notamment les correspondances qu’elle entretient avec celle du poète anglais T.S. Eliot.
« Dans l’obscurité morte, l’air mort se moule à la terre morte. Au-delà de la vue, il se moule à la terre morte. »
Tandis que j’agonise,William Faulkner
« […] nous demeurons. »
Vers le phare, Virginia Woolf

L’étrange et méconnue vitalité romanesque du Sud a légué au monde une série d’écrivains terrifiants — dont, au premier chef William Faulkner — qui ont su prendre et surtout reprendre le southern gothic pour l’élancer à l’assaut des gouffres nouveaux. Du bayou à ses cauchemars, de la ville moderne à la fièvre solitaire — et retour. À l’instar du Yoknapatawpha de Faulkner, McCarthy hissera ainsi à hauteur baptismale les lanières déchirées de Knoxville dans Suttree ou la Sierra Madre Mexicaine à seuil de pyrolyse dans Méridien de sang. McCarthy un héritier américain donc, mais marqué par le sceau biblique du deep south — lui-même sauvagement dépositaire de cetteAmérique pastorale « bornée au nord par le Pôle, au Sud par l’Antarctique, à l’Est par le premier chapitre de la Génèse et à l’Ouest par le jour du Jugement dernier » (Arthur Bird). Outrepassant le régionalisme de ses romans, McCarthy ne réduit jamais leurs ramures à la seule Amérique, puisqu’il fait indéniablement partie au côté de Roberto Bolaño, des derniers émissaires mondiaux de la littérature toronnée par le Mal, et dont les œuvres conjointes sont implacables, stoïques — hantées.
L’obscurité du dehors
Bien loin de l’Amérique tonitruante et victorieuse du Times, McCarthy arme cette parole rendue depuis les bastions le plus échevelés du Dixie.
Comme un prolongement à l’ère contemporaine du geste de James Agee et Walker Evans qui dénichèrent sous « la membrane navrée de la terre » la vertu émaciée des métayers du Sud, McCarthy anime de sa voix les éclopés du monde — ceux sur qui « rien ne demeure, aucun avatar, aucun descendant, aucun vestige. » (Le gardien du verger). Bien loin donc de l’Amérique tonitruante et victorieuse du Times — elle-même enfantée par l’Amérique de la « ruée furieuse » — McCarthy arme cette parole rendue depuis les bastions le plus échevelés du Dixie. Notamment dans Suttree oùlabanlieue étique est un creuset vicié, grouillant de « dissolus et autres débauchés » — eux-mêmes exsudés d’un « carnaval de formes dressées dans la vallée qui a tari la sève de la terre à des lieux à la ronde. »L’écumeur libre Harrogate et sa cohorte de pénitents erratiques, ces « aboyeurs de Dieu avancés dans le monde tels des prophètes d’Antan », portent les clameurs comme ces mêmes prophètes prônaient la torche augurale. Les « yeux brulés » de ces Fol-en-Christ sont autant d’œillades transfigurées qui répondent aux pupilles creuses de l’hollow men contemporain. Ainsi, loin d’être la marge insomniaque du monde, les députations d’harangueurs claudiquants ou de soiffards bibliques qui peuplent Suttree en sont davantage le versant strident — ils sont les pèlerins fouailleurs, errant de conjurations en conjurations, fidèlent à l’hungry eye des« pécheurs qui mijotent dans leurs mantes environnées de fumée [qui] portent le Verbe lui-même hors du tabernacle et le promène par les rues. » À rebours donc l’aplat modernequi pourchasse ces hommes aux aspérités agonistiques, McCarthy nous révèle qu’en l’écuelle seule de ces regards fendus en croix il se recueille les derniers aiguails du lait communiant — comme si les cannelures de ces âmes ravinées étaient perforées comme autant de calices unifiants : « Il se disait que même les damnés de l’enfer ont une communauté de souffrance et pensait que semblablement il saurait estimer un chagrin nominal chez les vivants comme sont pesés à la métairie désastre et ruine selon des lois d’une équité trop subtile pour être prédite. » (Suttree)
C’est cette atmosphère lourde et enfoncée de ténèbres qui permet à McCarthy de tendre le récit comme un psaume — entre le monde et sa révélation, entre le monde et sa consumation. Une épure compulsive, greffée des craquements providentiels et modelée sur le terrible vers de T.S. Eliot : « Fils de l’homme tu ne peux rien dire, ou deviner, car tu ne sais rien, ou seulement des tas d’images brisées. » Dans ses romans, chaque geste et chaque parole est ainsi dressée sur l’à-pic de survie — à la face des siècles et des rois ; comme si en leurs étoffes envahies d’épines il se forgeait la cloche de parousie — dont le tocsin sonnerait l’amorce ou l’achèvement du monde. C’est précisément ce pneuma contracté dont nul n’échappe à la tessiture qui sature La Route :le fond remblayé de cendres, le cannibalisme renaissant, le paléolithisme de la faim, les hommes rauques et ahanants, sont autant de mises en joue de l’homme face à sa survie — qu’elle soit métaphysique ou matérielle, chacune n’étant que le ventricule d’un même cœur bradycardé. Ainsi, toujours dans La Route, après que la pieuse main de « l’homme » se brisa d’impuissance alors qu’il tentait d’allumer une bougie croupissante — comme si cette simple bougie était la dernière à allumer pour les justes — et que celle-ci resta enclose dans sa cécité, tout se passera comme si c’était le monde lui-même qui envoyait ses locustes pour greffer cette cicatrice : « Il sortit dans la lumière grise et s’arrêta et il vit l’espace d’un bref instant l’absolue vérité du monde. Le froid tournoyant sans répit autour de la terre intestat. L’implacable obscurité. […] L’accablant vide noir de l’univers. […] Du temps en sursis et un monde en sursis et des yeux en sursis pour le pleurer. ». C’est peut-être au cœur de ces brandons déchues que se joue le secret balancement de La route : en pourchassant les dernières battitures jaillies de l’âtre gelée,McCarthy et ses personnages appliquent la loi intrinsèque de toute taxinomie de l’obscurité : la moindre lueur à valeur de présage, de signe précellent. À l’image de ce flocon négatif et pourtant tigré de grâce que le père recueille dans sa main : « Un seul flocon gris qui descendait, lentement tamisé. Il le saisit dans sa main et le regarda expirer là, comme la dernière hostie de la chrétienté. »
La terre vaine, « le mois le plus cruel »
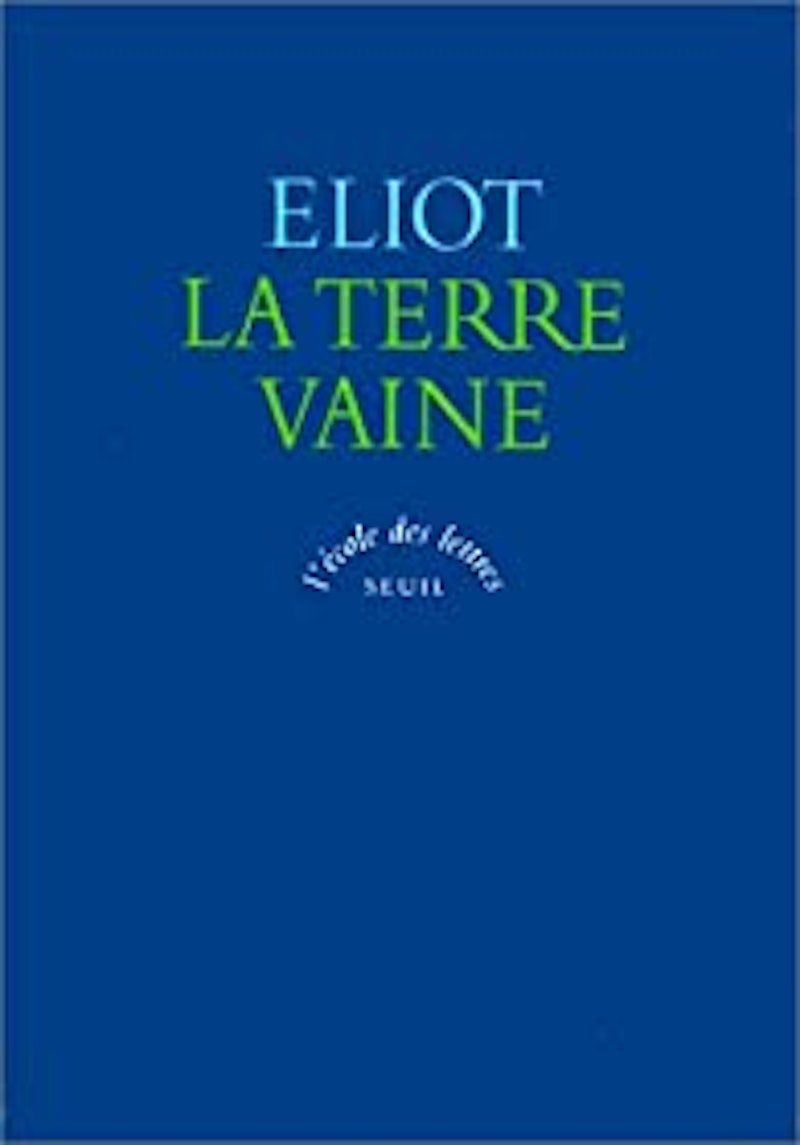
Cette trame tellurique dont les ornières en recouperaient la guerre intérieure n’est pas sans nous rappeler l’étrange et prophétique œuvre poétique de T.S Eliot. En 1922 et 1925, alors que l’âme européenne venait de s’asphyxier de mille tranchées bestiales, T.S. Eliot en recomposa le miroir d’attrition psychique dans deux poèmes majeurs La Terre vaine (The Waste Land) et Les Hommes creux (The Hollow Men)Par-delà la complexité de leurs cavalcades modernistes, ce qui éclope et blesse le lecteur de ces poèmes tient à leurs paysages cruellement balayés par le même souffle pulvérulent — qui balaye d’un même aquilon la charpente et la ruine de l’homme. En se faisant ainsi le sismographe des landes bannies, Eliot porteraainside poussière à pulvis la contrition de l’homme moderne — afin, selon son propre vers, que « ces fragments étayent [nos] ruines ». Semblables à une écholalie de cette recherche des « Lilas qui jaillissent de la terre morte », les romans de McCarthy sondent également le chancre qui corrode les terres gastes — qu’il soit américain dans Méridien de Sang ou La trilogie des confins, apocalyptique dans La route, psychique dans Le passager.Ainsi, à l’instar d’un univers vaincu, échoué aux larges de quelques dévastations antérieures ou guettant fiévreusement l’avènement d’une révélation — la scène des romans de McCarthy suspend son imaginaire à la croix gravé par « La supplication d’une main de mort / Sous le clignotement d’une étoile pâlissante. » (T.S Eliot) : Badlands du Nouveau-Mexique éviscérée de toute filiation morale dans Méridien de sang, terre condamnée et démantelée de ses dernières fondations civilisées dans La route ou encorebanlieue éventrée en un«labyrinthe de sumacs, de phytolaques et de chèvrefeuilles flétris » dans Suttree : toutes ses images sont le miroir oblique que McCarthy porte le long du limon humain — et plus encore, le long de notre terre moderne. Une terre dépolarisée, sans cairn ni péon pour guider la courbure des hommes — si ce ne sont les caillots épiants et déposés en parole par l’étrange Juge Holden de Méridien de Sang ou par l’attraction démoniale de la « cardeuse d’âmes » de Suttree.
En outre, bien que la pitié piétinée de Méridien de sang puisse apparaitre comme son versant le plus cruel, on retrouve à des profondeurs insensées du Malpais les strates les plus précaires de l’homme — comme si celles-ci surgissaient d’un même sédiment supplicié. Impassible et anthropique, le sceau de cette terre aréique enserre plus fatalement l’homme dans son linceul corruptible que ne le ferait la simple barbarie — qui sera toujours humaine, trop humaine. C’est cette catabase perforée dans la « vallée d’étoiles mourantes » (T.S. Eliot) qui rend Méridien de sang si impalpable : sa charrue enfonce son soc dans le sillon de la terra damnata pour y retrouver l’homme — tel qu’il est hanté en sa nature meurtrière. Maculé par une roche rubescente, ce désert du Méridien est à l’image de ceux qui le cavalent : stuporeux, sardonique — et « dont la vraie généalogie n’est pas la pierre mais la peur. » Un royaume buriné par le soleil, mais le soleil occulte et terrible qui n’éclaire plus que la face morte de l’homme — où les œillades larvaires et saturées de violence des chasseurs de scalps ne peuvent qu’errer, de biefs taris en cranes édentés, à l’image d’une « patrouille condamnée à chevaucher sans fin pour expier une antique malédiction. ». Cette scansion erratique est annoncée dès les premières lignes : le « gamin », sorte de Rimbaud carbonisé avant l’âge, alors qu’il fut fusillé en traitre « juste au-dessus du cœur » par un quartier-maitre maltais, fait face aux regards détournés des « autres » sur son propre corps éventré. Et c’est précisément le long de cette lâcheté que le sarment sanguin de son exil grimpera : « Ses origines sont devenues aussi lointaines que l’est sa destinée et jamais plus tant que durera le monde il ne trouvera des sols assez sauvages et barbares pour éprouver si la matière de la création peut être façonnée selon la volonté de l’homme ou si le cœur humain n’est qu’une autre sorte de glaise. » Manière d’affirmer les liens destinaux qui unissent l’homme et ses arpents pécheurs — l’un gravissant les autres à la mesure de sa déchéance, cherchant toujours, avec la plus torve des larmes, la « mâchoire brisée de nos royaumes perdus » (T.S. Eliot)
Le rougeoiement des cendres
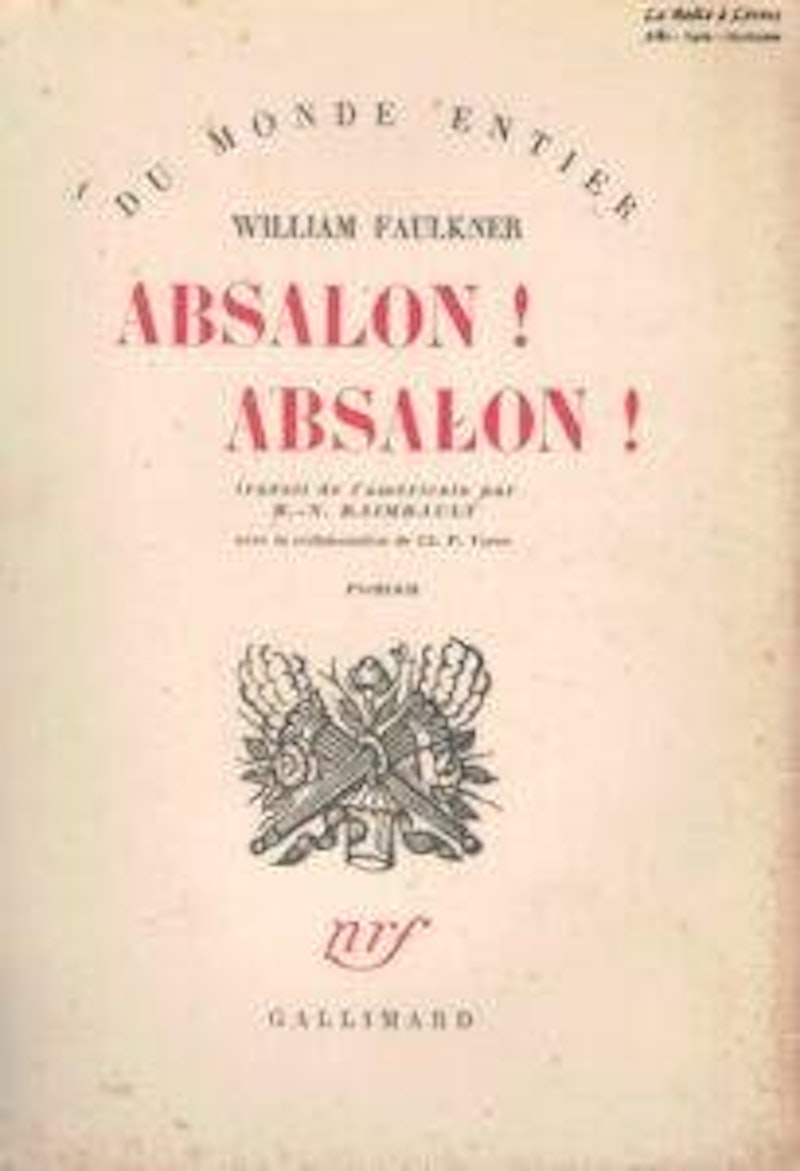
Implacablement miroitée dans la figure du feu, cette éruption antérieure ponctue en des pointes épiphaniques l’ensemble des romans de McCarthy. Le feu fixe une clarté dont la quête hante les hommes — non en ce qu’il porte la lumière, mais en ce qu’il renoue avec ce temps au cœur du Temps, ce kairos suspendu où « la pendule s’arrête » évoqué par Faulkner dans Le bruit et la fureur.Ainsi, toujours dans Méridien de sang : « ils contemplaient le feu qui contient en lui quelque chose de l’homme lui-même tant il est vrai que sans lui l’homme est diminué et coupé de ses origines et comme exilé. Car chaque feu est tous les autres feux, le premier feu et le dernier feu qui sera jamais. » Et c’est peut-être sous le signe seul de cette apicale embrasée qu’il nous faudrait lire ses romans ; un feu précisément foudroyé par l’étrange vers de T.S Eliot « En ma fin est mon commencement » — par lequel on assisterait à la consomption féroce de l’aube et du crépuscule. Un feu dont l’opale serait creusée dans l’aubier même de l’apocalypse, entre son écorce destructrice et son cœur de révélation. Et c’est à l’aune de cette même collision secrète, forgée dans le roc des flammes, que les hommes seront semés dans l’abîme inhumaine ; là où ne perdure que le cristal seul de leurs poussières : « Tout avait disparu. Plus la moindre trace, plus rien. La piste se perdait là, dans cette rue au bord de l’eau où tout ce qu’il a avait été traînait en ombres de papier, quelques-unes ici même, qui s’effaçaient. Après ça, plus rien. Quelques rumeurs. Des mots vains emportés par le vent. D’antiques nouvelles qui à force de voyager n’étaient plus fidèles » (Suttree)
Les romans de McCarthy fouillent sous le suaire de poussière qui macule chacun de nos pas sur la waste land, comme pour y déterrer le grain immaculé d’une parole silencieuse
Dès lors, et à la suite de T.S. Eliot qui nous enseigna que « This is the way the world ends / Not with a bang but a whimper », McCarthy nous révèle les hypothétiques mots murmurés par le commensal d’un regard : celui qui fut apposé d’un même œil par le premier et le dernier homme — tous deux uniques témoins de l’étincelle soufflée depuis l’extrême pointe du temps. Et c’est dans les visages mêmes de ces pèlerins de l’outre-monde que McCarthy taille ses concrétions romanesques — sans que celles-ci ne soient dénuées d’une lueur crénelée à l’intime de leurs yeux. À l’image du « prédicateur » que rencontra Cornelius Suttree lors d’une de ses descentes le long de la rivière Tennessee et que celui-ci lui assena la parole dialogique par excellence — celle qui s’agrippe à la branche de charité : « Y suffit pas d’aller dans l’eau pour être sauvé, […]. Faut aussi qu’on vous sauve. » ou encore dans La route, où le poids vivant de la main du père à son fils —une main donnée, filiale et salvifique — ouvre une brèche dans la trame cendrée ; et permet à McCarthy de sonder les traces d’une piété rendue à celui qui nomma ou qui nommera — rendue à ce Dieu dont la route est gravée par les semelles effacées de notre fuite : « Il n’y a pas de Dieu et nous sommes ses prophètes. »
Et, de même que c’est sur les terres les plus assoiffées qu’éclosent les fleurs de Jéricho, les romans de McCarthy¹ fouillent sous le suaire de poussière qui macule chacun de nos pas sur la waste land, comme pour y déterrer le grain immaculé d’une parole silencieuse — autour duquel « le monde inapaisé continue de tournoyer » (T.S. Eliot) À l’image d’un pèlerin donc, mais un pèlerin de l’apocalypse — qui ne pourrait moissonner que les larmes de Job perlées dans l’œil émacié des hommes. Et c’est peut-être cette larme captive que recueille plus intensément les romans de McCarthy : une larme violente, fidèle aux « fondations du monde qui puise son essence dans le chagrin de ses créature » (Le passager), écoulée sur le visage de Job et qui, dans le taedium de notre temps où aucune larme ne tombe, en déposerait la semaille écorchée — pour que ses cendres vaines par d’autres cendres soient vaincues.
Henri Rosset
Illustration : Zao Wou-Ki, Vent et Poussière, 1957.
¹À noter que sur Cormac McCarthy, l’on trouve de multiples et érudites notes sur chacun de ses romans sur le Stalker de Juan Asensio

















