
En mars 2022, sur l’initiative de Guillaume Narguet, les deux écrivains Christian Dedet et Christian Guillet ont été réunis autour d’une table ronde, soixante ans après leur première rencontre ! Christian Dedet a notamment écrit son journal, en trois volumes, et Christian Guillet son autobiographie, en neuf volumes. Ils livrent ici à Zone Critique leurs réflexions sur l’écriture, la place du « Moi » en littérature et la vie de l’écrivain.
Introduction des deux participants par Guillaume Narguet
Christian Dedet. Originaire du Languedoc, vous faites vos premières armes littéraires en collaborant à la revue littéraire montpelliéraine Les Cahiers de la Licorne. Vous exercez l’activité de médecin thermal à partir des années soixante et le reste du temps, vous le consacrez à l’écriture, ce pendant 33 ans. Vous publiez votre premier roman, Le Plus Grand des taureaux, en 1960 au Seuil, une œuvre inspirée de votre passion pour la tauromachie ; suivent Le Métier d’amant en 1962 (où l’on sent l’influence de Drieu La Rochelle, avec éventuellement des éléments autobiographiques, nous en parlerons peut-être tout à l’heure), La Fuite en Espagne en 1965 etc., jusqu’à votre plus grand succès, La Mémoire du fleuve, qui obtint le prix des Libraires en 1985. Dans votre bibliographie figurent donc des romans d’inspiration hispanique ou inspirés par la guerre d’Algérie, des récits de voyages, des chroniques littéraires, et, à partir des années 2000, votre journal, qui compte à ce jour trois volumes : Sacrée Jeunesse, l’Abondance et le Rêve et, le dernier en date publié en novembre 2021 : Nous étions trop heureux, qui couvrent la fin des années cinquante jusqu’en 1970 avec la mort de De Gaulle.
Christian Guillet. Ni romancier, ni diariste, vous vous définissez plutôt comme écrivain autobiographe. Originaire de Paris, vous faites vos études au collège Stanislas et au lycée Saint-Louis de Gonzague et, après une adolescence passablement agitée, vous vous tournez très tôt vers la grande littérature, encouragé en cela par votre père proustien, à qui vous vouez une grande admiration et qui jouera un rôle de premier plan dans votre œuvre. Vous enseignez justement la littérature pendant 22 ans dans un lycée parisien, tout en élaborant en parallèle votre œuvre, vaste étude autobiographique en neuf volumes que vous achevez dans les années 90 avec la mort de votre père. D’abord publié chez Flammarion, vous avez été réédité dans les années 2000 par l’Age d’homme. Citons par exemple Le Rouge au front, votre premier volume, Adieu trophées, L’Adoration perpétuelle, Au Nom du père ou bien encore Chapelle ardente.
Pourquoi cette soirée autour de la mise en scène du Moi dans la littérature ?
Pourquoi cette soirée autour de la mise en scène du Moi dans la littérature ? Pour la petite histoire, je préparais des entretiens en parallèle avec chacun de nos auteurs ici présents pour des revues concurrentes quand je suis tombé sur ce passage du journal de Christian Dedet, à la date du 31 janvier 1965, qui est invité chez les Jouhandeau.
« 31 janvier 1965. Il y a là, bien sûr, Madame Jouhandeau, Elise (à qui Marcel me présente), affaissée dans un fauteuil, visage de vieille Auvergnate, dur et soupçonneux. Pensait-elle : « Encore un nouveau giton » ? Il y a un éditeur de chez Plon, Michel Tournier. Le vieux Jean Denoël, qui me témoigne de la sympathie, sachant mon nom par Delteil. Un jeune romancier aux airs tragiques et sombres, Christian Guillet, qui publie chez Flammarion et dont Solange de La Baume m’a donné un jour La Porte d’ivoire, récit initiatique. Cette petite société pérore, adule, lance des anathèmes jusqu’au moment où survient ce que je comprends être l’inévitable attraction de ces matinées à Rueil, la scène de ménage, l’écharpage conjugal entre Marcel et Élise. Sur un prétexte futile, le ton monte. L’épouse martyre dit son dégoût, son mépris. Marcel prend à témoin de sa patience, de son abnégation, de ce qu’on fait de lui dans sa propre maison […]. La durée de ces scènes doit être assez variable, mais aujourd’hui, cela se prolonge et rebondit au point que Marcel ne pourra songer à s’asseoir au piano-orgue pour une improvisation ».
La coïncidence étant trop forte, je me suis dit qu’il pourrait �être intéressant de faire se rencontrer de nouveau ces deux écrivains, qui ne s’étaient jamais recroisés depuis cette réunion chez Jouhandeau il y a soixante ans.
La coïncidence étant trop forte, je me suis dit qu’il pourrait être intéressant de faire se rencontrer de nouveau ces deux écrivains, qui ne s’étaient jamais recroisés depuis cette réunion chez Jouhandeau il y a soixante ans. D’autres éléments sont bien sûr entrés en considération ; tous les deux ont des points communs : même génération, des fréquentations communes, une certaine méfiance vis-à-vis des écrivains à la mode à partir des années 60 (la bande de Tel Quel, comme Sollers). Ils auraient très bien pu se recroiser à la manifestation en soutien à De Gaulle après Mai 68, ce qui a été peu ou prou leur seule trace d’engagement politique et qu’ils racontent tous les deux dans leurs œuvres respectives. Ils ont tous les deux été invités sur le plateau de l’émission Apostrophes etc. Mais ils ont également des différences : l’un est un méridional à l’accent chantant, l’autre est d’un caractère nordique, l’un est plus mondain (sans que ce soit péjoratif) et a obtenu une certaine reconnaissance, jusqu’à être considéré comme potentiel prix Goncourt et candidat à l’Académie française, l’autre n’a pas vu son œuvre obtenir le succès qu’elle méritait et a continué son chemin dans une certaine obscurité, mais nous sommes justement là pour lever ce voile. Ecrivain mondain et écrivain reclus, voire maudit ? L’un délimitant bien la carrière professionnelle et l’œuvre littéraire, l’autre sacrifiant tout à l’Art, la vie pour l’Art.
Guillaume Narguet : Une première question qui s’adresse à vous deux : comment avez-vous noué cette relation avec Jouhandeau ? Ce dernier a-t-il exercé une quelconque influence sur votre propre œuvre ? Nous savons qu’il est l’auteur de ces fameux Journaliers, une longue chronique en vingt-huit volumes qui s’étend des années 50 aux années 70, qui ne sont pas un journal à proprement parler mais un ensemble de remarques et de réflexions suscitées par un fait, une rencontre, une lecture, un souvenir, ce qu’on peut retrouver dans votre propre œuvre.
Vous évoquez ce qu’il a écrit mais il a rédigé environ cent trente livres, ce qui est une folie très négative à mes yeux. Les trente derniers sont ses journaux intimes, […]. C’est une suite de phrases sans composition.
Christian Guillet : J’étais publié chez Flammarion et mon premier lecteur a été Henri Parisot, qui fréquentait le milieu des surréalistes. Il m’a recommandé d’aller voir Marcel Jouhandeau, que je ne connaissais pas du tout. Je lui ai alors écrit et il m’a répondu très gentiment que je pouvais venir le voir chez lui. Ce que j’ai fait et à partir de là, une amitié est née car on parlait beaucoup de littérature. Vous évoquez ce qu’il a écrit mais il a rédigé environ cent trente livres, ce qui est une folie très négative à mes yeux. Les trente derniers sont ses journaux intimes, ce qui est, de loin, la partie la plus faible. C’est une suite de phrases sans composition. Auparavant, il avait été essentiellement un chroniqueur de son époque et de la petite bourgeoisie telles qu’il les connaissait depuis son terroir un peu perdu vers Guéret. Ce n’est pas quelque chose qui me passionnait, mais j’ai eu cette chance d’attirer son estime avec mon premier ouvrage, ce qui me servait évidemment auprès des critiques ou des gens du métier. Je l’ai beaucoup fréquenté seul à seul et j’étais très ennuyé du peu d’intérêt littéraire que je portais à sa production car j’avais de l’affection et de la gratitude pour lui. Cependant, la différence d’âge était si considérable que cela ne pouvait me donner droit qu’à du respect envers lui, je ne pouvais pas avoir la même franchise à son égard qu’envers des gens de mon âge. Par conséquent, je me privais de le mettre en garde contre les défauts de cette écriture permanente qui était la sienne. Cette amitié n’a jamais pu être véritable, elle n’allait que dans un sens. Pour ma part, j’essayais de tenir compte de ce qu’il me disait ; je lui envoyais mes livres, qu’il devait feuilleter suffisamment pour m’écrire des choses qui n’étaient pas stupides. Puis un jour, j’ai fait son portrait d’une façon très littéraire et travaillée, ce qui ne lui a pas plu, et une petite brouille s’est insinuée sans que nous en soyons jamais vraiment sortis.
Christian Dedet : Je devais avoir vingt-quatre ou vingt-cinq ans quand j’ai rencontré Jouhandeau. C’était à l’occasion de la publication de mon deuxième livre, Le Métier d’amant, aux éditions du Seuil. L’intrigue ressemblait beaucoup plus à L’Homme couvert de femmes de Drieu La Rochelle qu’à Dom Juan ; mais c’est un livre, disons juvénile, et quand je le relis maintenant, je le trouve assez daté et naïf. Le Figaro avait écrit un long article, à la fois un peu moqueur et un peu favorable aussi, puisque j’étais plutôt bien apprécié au Figaro. Cependant, un plaisantin avait mis à la place de mon portrait, qui, au vu de ma jeunesse, était plutôt agréable, celui d’un vieux barbon horrible, avec un double menton affreux, avec comme sous-titre une formule du style : « Christian Dedet imagine un personnage à sa ressemblance ». Quand cet article a été publié, j’ai senti la terre se dérober sous mes pieds. Serge Montigny, l’attaché de presse des éditions du Seuil, qui avait beaucoup de talent et d’entregent, a essayé d’arranger le coup. Un article rectificatif a été publié la semaine suivante mais le mal était fait et j’en étais mortifié. C’est alors qu’une de mes amies de l’époque m’a dit : « Il est arrivé la même chose à Jouhandeau » et m’a montré l’article qu’elle avait découpé car elle était lectrice de Jouhandeau. L’article montrait une photo de ce dernier avec une sorte de bandeau noir sur l’œil. Je lui ai donc écrit en lui expliquant que j’avais vécu la même mésaventure que lui. A cette époque, j’avais lu quelques-uns de ses livres mais je n’étais pas non plus un grand amateur. Il m’a répondu, dans une lettre absolument exquise, que nous avions souffert du même drame atroce et autres qualificatifs grandiloquents. Christian, vous connaissez les excès de Jouhandeau… Il m’a alors proposé de le voir. Je servais à cette époque sous le drapeau, pendant la guerre d’Algérie, et j’ai profité d’une permission pour me rendre à Rueil. Il m’a reçu avec beaucoup d’amabilité ; la première question qu’il m’a posée a été : « Avez-vous le goût des garçons ? ». Je lui ai répondu non et il a rétorqué : « Vous comprenez, je sens naître une grande amitié pour vous, et à chaque fois que je reçois de jeunes auteurs, je leur pose la question pour que la conversation s’engage sur des bases saines ». Cela a été la première rencontre, qui a été suivie de nombreuses autres.
Nous parlions de manière assez approfondie de ses livres ; mon épouse m’a accompagné quelques fois également et nous nous sommes liés d’amitié avec les Jouhandeau, et leur fille adoptive Céline. Qu’on me permette de citer un passage du tome 3 de mon journal, consacré à une de mes dernières visites chez lui :
« La mort, l’année dernière, de Jean Paulhan l’a beaucoup affecté. Il revient sur ses relations initiales avec la NRF et combien Paulhan, non seulement a orienté, aimanté son œuvre à des époques pour lui déterminantes, mais en de maintes circonstances par la suite a su, avec sa ferme discrétion, lui faire éviter des erreurs dont il frémirait rétrospectivement » [là, je fais allusion à son antisémitisme, à la collaboration, etc.].
Il me parle aussi, à propos de ma présence à Esprit, d’un moment de sa jeunesse chrétienne où il se serait senti sioniste.
« Quand Marcel se livre ainsi à son interlocuteur […] on sent qu’il le fait avec un plaisir qui est non seulement celui du conteur, mais qu’il s’émeut à nouveau de ce qu’il a peut-être déjà raconté. C’est dire s’il serait difficile et vain de démêler chez lui, chez Jouhandeau, ce qui est du narcissisme, de l’humilité, de la générosité ». Voilà un portrait du Jouhandeau qu’on fréquentait, Christian Guillet et moi, périodiquement.
« Il se lance dans un récit minutieux à douce voix infatigable, évoquant un prêtre défroqué (ou rencontré jadis ?) qui, une fois marié, eut deux enfants profondément croyants, tenus dans l’ignorance du passé religieux de leur père. Vint la mort de celui-ci après celle de sa femme et Jouhandeau de louer la noble attitude du chanoine de Courbevoie, où se dénoua ce drame qui, pour ne pas traumatiser les descendants du défunt, accepta de fermer les yeux sur ce qu’il tenait de la confession et laissa passer le corps dans son église en de brèves, mais chrétiennes, funérailles. Quand Marcel se livre ainsi à son interlocuteur du parler si réfléchi que c’en est presque de l’écrit, autrement dit du Jouhandeau natif, on sent qu’il le fait avec un plaisir qui est non seulement celui du conteur, mais qu’il s’émeut à nouveau de ce qu’il a peut-être déjà raconté. C’est dire s’il serait difficile et vain de démêler chez lui, chez Jouhandeau, ce qui est du narcissisme, de l’humilité, de la générosité ».
Voilà un portrait du Jouhandeau qu’on fréquentait, Christian Guillet et moi, périodiquement. Combien de fois l’avez-vous vu ?
C.G. : Pendant une période, je le voyais toutes les semaines, rue du Commandant Marchand, dans le 16e. Il est venu également chez moi, pour mes fiançailles notamment. Il connaissait mes parents, ainsi que ma femme et mon fils, qui dessinait chez lui.
C.D. : Mon épouse et moi l’avons vu à peu près une quinzaine de fois en tout et de façon assez espacée. Il venait d’emménager à Rueil.
G.N. : Nous allons maintenant évoquer vos œuvres respectives. Christian Guillet, vous n’avez pas écrit de journal, ni de mémoires et encore moins d’autofiction ; vous vous êtes livré à une autobiographie sur environ quarante ans. Dans quelle mesure peut-on dire que votre œuvre fait preuve d’originalité ? Car, après tout, Montaigne, Rousseau ou Chateaubriand s’y sont déjà essayés.
On se trouve devant une absence totale, à mes yeux, d’autobiographie avant la Révolution. En revanche, à partir de la Révolution, c’est un déluge, tant et si bien que deux registres uniques se font face : le journal intime et les mémoires.
C.G. : On peut constater que l’autobiographie s’est vraiment développée depuis le romantisme avec sa culture du Moi. En littérature (je n’évoque pas la philosophie), nous avons Montaigne, avec ses Essais et son journal de voyage en Italie. Autrement, il n’y a pas d’autobiographe. On se trouve devant une absence totale, à mes yeux, d’autobiographie avant la Révolution. En revanche, à partir de la Révolution, c’est un déluge, tant et si bien que deux registres uniques se font face : le journal intime et les mémoires. Or, je récuse l’un et l’autre, c’est ce qui m’a conduit à inventer quelque chose d’un peu nouveau, un peu différent, sans exagérer sur le terme d’invention. Mon confrère a rédigé un journal intime, mais il a été précédé par des gens qui étaient aussi de valeur. Qu’est-ce que je reproche au journal intime ? Je pense qu’il y a deux vices inhérents, et c’est ce qui m’a poussé à ne jamais en composer : premièrement, il n’y a pas de composition, cela ne peut donc pas être une œuvre d’art, car il n’y a pas d’œuvre d’art sans composition ; secondement, et c’est pour moi le défaut fondamental : on a les yeux rivés sur l’événement, l’anecdotique. On relate ce qu’il s’est passé au cours de la journée qui vient d’être vécue. Il n’y a donc pas de recul, ce n’est pas mûri dans le fond, ni dans la forme. C’est, à mon sens, une entreprise anti-littéraire qui se rapproche davantage du journalisme.
G.N. : Dans ce cas, vous déniez toute valeur artistique au journal d’un Léautaud ou à celui d’un Léon Bloy ?
Les faits en eux-mêmes n’ont pas de valeur littéraire. Il n’a plus les impressions qu’il avait ressenties à l’époque. Rien que pour cette raison, les mémoires ne peuvent pas être une œuvre d’art.
C.G. : J’apprécie énormément Léautaud mais non pour son Journal littéraire, qui est très faible. Il a fait bien d’autres choses, comme Le Petit Ami ou In Memoriam, qui sont merveilleux. Voilà les raisons pour lesquelles je ne voulais pas faire de journal intime. Quant aux mémoires, c’est l’histoire d’un monsieur de cinquante ans par exemple, qui se met à évoquer l’homme qu’il a été à trente. Les cartes sont faussées car les souvenirs concernent des faits qui se sont déroulés dans le passé et non des impressions éprouvées. Le mémorialiste relate donc par exemple qu’il s’est marié tel jour et que son enfant est né tel jour mais les faits en eux-mêmes n’ont pas de valeur littéraire. Il n’a plus les impressions qu’il avait ressenties à l’époque. Rien que pour cette raison, les mémoires ne peuvent pas être une œuvre d’art. Et il y a, d’autre part, un vice fondamental dans les mémoires qui est le suivant : l’homme de cinquante ans croit qu’il fait le portrait de l’homme qu’il était à trente ans, il semble être de bonne foi ; or, c’est un leurre puisqu’il sait forcément tout ce qu’il s’est passé entre trente et cinquante ans, donc son jugement est altéré, de façon inconsciente. Quand il fait son portrait, il ne dépeint pas un homme qui ignorait complètement ce qui allait se passer les vingt années suivantes. Il brosse le portrait d’un homme qu’il n’a pas été ou qui n’est plus celui qu’il a été. Je récuse donc absolument toute valeur artistique aux mémoires.
G.N. : Vous écriviez donc votre autobiographie au jour le jour ?

C.G. : Pas tout à fait. J’ai eu toute ma vie un carnet sur moi, avec un crayon, et, où que je fusse, je réfléchissais au livre que je voulais rédiger et qui devait correspondre à une tranche de vie en particulier, sur cinq ans. J’ai retranscrit ainsi ma vie en neuf volumes. J’avais cette préoccupation obsessionnelle en tête. Donc je prenais des notes, à chaud et en écrivant à peu près n’importe comment, sur tout ce qui pouvait concerner ce livre et quand j’étais seul, je composais les phrases pour en faire un récit, sur cinq ans. Je mettais autant de temps car j’étais extrêmement exigeant sur l’écriture et également sur le choix du contenu, il me fallait donc prendre le recul nécessaire.
G.N. : Donc pour répondre (moi-même) à ma question précédente : ce qui fait l’originalité de votre démarche consiste dans le fait d’extraire de la vie réelle tout élément qui pourrait relever de l’ordre de l’esthétique. Comment identifiiez-vous ces éléments ?
C.G. : Je prends pour modèle un artiste qui m’a toujours passionné, à savoir Rodin. Quand ce dernier façonne une femme à partir d’un marbre, il semble la sortir du matériau, il donne cette impression qu’elle y était déjà, qu’il n’a rien fait d’autre que la chercher. C’est la raison pour laquelle il y a toujours une partie mineure qu’il ne travaille pas (comme un bout de pied par exemple) pour montrer qu’il n’a pas accouché entièrement cette femme du marbre. En ce qui me concerne, j’ai tenté d’appliquer cette méthode en identifiant, pendant cette période de cinq ans que j’ai évoquée, ce que je pouvais extraire de littéraire à partir du réel, ce qui, dans le réel, pouvait quitter déjà complètement le réel. En somme, je travaillais dans une transformation du réel direct.
G.N. : Christian Dedet, votre intention était différente puisque, pour le coup, vous avez écrit votre journal, que vous avez tenu très tôt, dès les années 50. Quelle a été votre motivation ? Pensiez-vous un jour le publier ? Avez-vous procédé à une réécriture en vue de la publication ?
J’avais un rapport au temps quelque peu angoissé et, dans le même temps, délectable, et me disais que tout ce qu’on vivait allait retomber dans le néant si l’on n’en retenait pas un peu.
C.D. : Ce qui a déclenché cette envie de journal qui s’est constitué au fil du temps comme les gouttes tombant des stalactites et finissant par constituer un rocher, c’est ce sentiment, que je tiens de mes origines espagnoles, el peor es siempre cierto, de la brièveté de la vie. J’avais un rapport au temps quelque peu angoissé et, dans le même temps, délectable, et me disais que tout ce qu’on vivait allait retomber dans le néant si l’on n’en retenait pas un peu. Pour moi, noter ce que je voyais, ce qui m’impressionnait, m’intéressait ou m’émouvait était quelque chose qui relevait presque du sauvetage inconscient. Je relevais donc ce qui concernait mon nombril, mes relations avec telle ou telle personne (écrivain ou autres) ou une réaction issue de mon épiderme, qui est la couche la plus profonde que nous ayons, disait Byron, ou bien encore une impression viscérale, angoissante ou exaltante. Je couchais tout cela sur des bouts de papier (pas de carnet pour ma part) en style télégraphique, ou quelquefois de manière plus rédigée quand j’avais le temps, et je mettais le tout dans une boîte d’archives. A la fin de l’année, j’avais une boîte remplie d’archives manuscrites. J’ai procédé ainsi toute ma vie, sans forcément songer à publier ce que j’écrivais.

J’ai toujours considéré que je ne voulais pas être écrivain, que ce n’était pas un métier, mais un don et une chance de survie, dans tous les cas quelque chose d’extraordinaire qui ne se choisissait pas comme n’importe quel métier. J’ai choisi d’être médecin par goût, celui de soigner. Et j’ai exercé la médecine thermale car cela me permettait de faire vivre la station thermale de Châtel-Guyon pendant toute la période estivale. Puis je rentrais à Paris où je pouvais m’adonner à la littérature. J’ai donc pu assouvir mes deux passions à tour de rôle.
Il y a à ce jour trois volumes publiés de mon journal, que j’ai commencé à mettre en forme à partir de 2005 : le premier, Sacrée Jeunesse, s’étend de 1958 à 1963 et concerne mes débuts, mes études de médecine, mes séjours d’interne à l’hôpital de Saint-Denis, et mon premier livre aux éditions du Seuil ; le deuxième, l’Abondance et le Rêve, de 1963 à 1966 ; et le troisième, qui vient de paraître, Nous étions trop heureux, qui va de 1967 à 1970, date de la mort du général De Gaulle. Les trois volumes couvrent donc toute la Ve République de De Gaulle, mes émotions, les évolutions de la société, les coups durs, Mai 68, le passage d’un monde à un autre etc.
En dehors de cela, j’ai publié une demi-douzaine de livres au Seuil qui ont eu plus ou moins de retentissement, certains ayant obtenu un succès assez notable. Puis j’ai eu un coup de chance, qui a été la rencontre avec Jean-Pierre Sicre, le fondateur des éditions Phébus, maison toute jeune et déjà moribonde. J’y ai publié La Mémoire du fleuve en 1984, où j’ai laissé libre cours à ma vocation d’africaniste, et qui a remporté le Prix des Libraires en 1985. 700 000 exemplaires ont été vendus, ce qui a permis le sauvetage des éditions Phébus et ce qui a représenté pour moi une merveilleuse aventure. Ensuite, j’ai publié Le Secret du docteur Bougrat, un autre best-seller, Ce Violent Désir d’Afrique, Au Royaume d’Abomey etc. Bref, j’ai eu une vie d’auteur à gros tirage et à succès pendant presque vingt ans. Puis des ennuis de santé ont fait que j’ai dû me résoudre à voyager autour de ma chambre comme Xavier de Maistre, et c’est à ce moment-là que j’ai commencé à tirer de mes caisses et de mes boîtes d’archives tous ces papiers que j’avais accumulés au fil des ans.
G.N. : Je souhaiterais rebondir sur une phrase que vous avez prononcée : « Je n’ai pas voulu faire de l’écriture mon métier ». Elle fait écho à cette citation de Paul Flamand, le fondateur des éditions du Seuil, qui vous a un jour dit : « La littérature n’intervient que pour une part trop mesurée dans une existence par ailleurs surabondante ». Cela semble bien résumer votre parcours.
C.D. : Paul Flamand me poussait beaucoup car j’étais « goncourable ». Chaque fois que je publiais un nouveau livre, j’étais nommé au Goncourt et cela l’inquiétait. Il avait tort de me précipiter ainsi car le temps de l’éditeur, qui court après son prix, n’est pas forcément celui de l’auteur et du créateur. Ils ne vont pas toujours au même pas.
G.N. : La démarche est inverse pour vous, Christian Guillet. On peut justement dire de vous que vous avez « sacrifié » votre vie à la littérature. Vous considérez à l’inverse de Christian Dedet que la vie n’est pas séparable de la littérature.
C.G. : C’est ce qui s’appelle l’autobiographie. Mais j’ai surtout cherché à mener la vie la plus banale possible. Je vois dans cet adjectif une qualité universelle et intemporelle. C’est-à-dire que je prenais dans ce qui m’arrivait, et j’étais bien servi pour cela, ce qui était le plus banal (un amour, un deuil, la naissance d’un enfant etc.), qui concernait tout le monde, sans qu’il y ait quoi que ce soit d’anecdotique. Il n’y a rien, dans mes livres, qui soit rattaché à des circonstances passives et à une actualité, que je vomissais. Vous pourrez me rétorquer que j’évoque malgré tout la guerre d’Algérie. Mais elle y figure à titre de prétexte, je ne prends aucunement parti. Je m’y suis trouvé sans qu’on me demande mon avis, et j’ai dû en parler pour que mon récit ait un minimum d’authenticité. Mais si l’on y prête attention, je ne parle pas vraiment de la guerre d’Algérie en elle-même. C’est le thème de la guerre en général qui m’importe. Je ne m’excitais pas dessus comme tous les gens de ma génération qui se croyaient obligés de prendre parti et de se forger leur opinion (du moins, ce qu’ils croyaient être leur opinion), qui n’était rien moins que banale et fugitive. J’ai toujours fui le fugitif. Je ne parlais que de choses marmoréennes.
G.N. : C’est-à-dire que si vous avez traité de l’actualité incidemment, c’est pour en sortir une vérité plus générale.
C.G. : Tout à fait. Je parlais de la vérité générale tout en éliminant le reste.
G.N. : Christian Dedet, l’intérêt de votre journal réside dans le fait qu’il fourmille d’anecdotes, avec quelques passages marquants. Cela est donc une démarche radialement différente de celle exposée par Christian Guillet, quel est votre avis à ce sujet ?
C.D. : Ma conception du journal est beaucoup plus stendhalienne, ou beyliste, que ce qu’il a très bien exprimé, à savoir chercher l’exceptionnel dans le banal. C’est une jolie formule. Pour ma part, je distinguerais plusieurs types de journal. Il y a le journal d’introspection comme celui d’Amiel ou de Charles Du Bos ; il y a le journal un peu parisien, éditorial, cancanier de Léautaud qui est merveilleux, notamment sur l’histoire de l’édition, et plus précisément le Mercure de France. Et il y a enfin une troisième forme de journal intime, qui est le journal stendhalien. Cela connote la chasse au bonheur, la couleur du temps, le soleil sur San Pietro et Montecitorio à Rome. Pensons au début de la Vie de Henry Brulard, quand, assis sur les marches de San Pietro, il fait le bilan de sa vie d’homme de cinquante ans et se demande quel homme il a été. Et plus tard, son hésitation entre Matilde et Clémentine Curial, lorsqu’il se demande laquelle des deux lui accordera ses faveurs. C’est une sorte d’adéquation entre sa destinée personnelle et la destinée du monde et du temps qui passe.
Je me définirais plutôt comme un journalier
Je suis moins sévère que Christian sur l’actualité. Il ne s’agit pas forcément de l’actualité qu’on peut lire dans tous les journaux. Quand je relate les événements de Mai 68 en cinquante ou soixante pages, cela tient à la fois de l’humour, du bouffon, du rabelaisien. Ce qui compte, c’est la façon de sentir et voir les choses, pour dépasser l’actualité. Ce qui compte dans la peinture de l’actualité par les chroniqueurs de l’époque de Rabelais et de Villon, ce n’est pas l’événement lui-même, mais la façon truculente dont cela est raconté. Je me définirais plutôt comme un journalier, à l’image de Jouhandeau d’ailleurs. C’est justement ce qui nous unissait. Même si je sais bien qu’il a bourré du papier et qu’il y a beaucoup de remplissage. Il me disait, à ce titre, qu’il était navré de ne plus avoir de lecteurs chez Gallimard ; il vendait, d’après Gaston, péniblement 2 500 exemplaires. Mais il n’en reste pas moins vrai que subsistait chez lui cette adéquation dont j’ai parlé entre les jours qui passent, l’universel et la haute morale. Voire peut-être parfois la plus basse. Tantôt, il racontait des histoires d’érotomane. Et à côté de cela, il traitait de questions théologiques. Pour moi, le journal, c’est une variété au contact de la vie, dans une perspective beyliste ou peut-être narcissique. Un mélange de narcissisme, de réflexion et d’enchantement. Je prends à témoin, pour terminer, un autre passage que j’aime beaucoup de Stendhal quand il raconte à quel point il était heureux à Frascati lorsque sa petite sœur lui avait pris le bras pendant le feu d’artifice, alors qu’au même moment, en France, la guillotine fonctionnait à plein régime (c’était en Thermidor an II). Là se situe le côté inimitable de la chose vue et dite.
G.N. : Christian Guillet, vous connaissez la fameuse sentence de Pascal, qui consiste à dire que le moi est haïssable et que chaque moi est l’ennemi et voudrait être le tyran de tous les autres. Que vous inspire cette phrase au regard de ce que vous avez pu écrire dans votre œuvre ?
C.G. : Rien du tout car il ne faut pas oublier que Pascal, quand il écrit cela (comme tout ce qui entre dans le cadre des Pensées), le fait dans l’optique religieuse de montrer que l’Homme sans Dieu est misérable et que l’Homme avec Dieu est sauvé. C’est relatif à une option métaphysique ou morale, ce n’est pas du tout valable ici car l’aspect moral ne m’intéresse pas du tout. C’est l’aspect esthétique uniquement qui m’intéresse. Il y a mille formes d’esthétique, évidemment. Il ne s’agit pas que de style, comme le croient la plupart des gens ; elle peut résider dans une situation ou un visage. L’écriture, qui est capitale, viendra pour moi en dernier.
G.N. : Au cours de nos échanges, vous m’avez souvent parlé de Rousseau et de Saint-Simon, deux metteurs en scène du Moi très différents. Rousseau, c’est l’autobiographie, la vie en tant que présent, la vérité du Moi seul, le récit d’une initiation, l’introspection ; Saint Simon, ce sont les mémoires, l’Histoire, la vie en tant que passé. Dans quelle mesure avez-vous pu combiner l’attrait que vous éprouvez pour ces deux auteurs ?
C.G. : J’ai un respect considérable pour l’un et l’autre, même si j’estime un peu plus Rousseau que Saint-Simon. Concernant ce dernier, il n’y a pas d’écrivain chez qui le style soit plus important que chez Saint-Simon. Si l’on enlève le style, il ne reste rien. C’est un style unique, qui n’a aucun prédécesseur et aucun successeur car il est tout entier contenu par le tempérament du personnage principal, c’est-à-dire le narrateur. Le style occupe la totalité de la plume, de ces huit volumes énormes. Ce n’est pas un intellectuel, c’est le tempérament qui compte, et c’est bien plus important et plus beau que l’intellectualité. Rousseau, c’est tout autre chose. Bergson disait qu’il n’existe, dans aucune langue, un écrivain, quel qu’il soit, qui ait eu l’importance de de Rousseau. On peut faire confiance à Bergson qui est un bon lecteur, et même si je n’ai pas une connaissance poussée des littératures étrangères, je pressens que cela doit être vrai. C’est un cas unique. Cela dit, il n’est pas toujours autobiographe. Ses histoires politiques ne m’intéressent pas beaucoup. Je me suis forcé à en lire mais L’Emile et sa conception de l’éducation me laissent froid. Ses Dialogues sont beaucoup plus faibles. Je privilégie les Confessions et les Rêveries. En cela, je suis d’accord avec Julien Gracq qui dit qu’il y a dans les Confessions un nombre fort limité de pages qui ont une valeur littéraire. On n’a bien souvent pas l’honnêteté de le dire, je suis donc très content qu’il dise cela, c’est tout à fait vrai. Mais ces pages sont inouïes.
C.D. : Christian Guillet parlait de Saint-Simon. Pour moi, Saint-Simon, que je lis et relis, est un des sommets de la langue française. En plus de cela, il était critique et il a créé une véritable langue. Christian a parlé de huit volumes, j’en compte plutôt dix-huit dans la grande édition Ramsay.
C.G. : Je parlais de la Pléiade, en huit volumes.
C.D. : Je n’aime pas la Pléiade, je la trouve illisible. J’aime le contact du vrai papier.
J’ai donc toujours été un grand lecteur de Saint Simon et j’apprécie particulièrement ses descriptions du « règne de la vile bourgeoisie », ses humeurs, ses portraits. Je repense au désarroi de Racine quand il s’est trahi devant le roi et Madame de Maintenon ; il avait cité le nom du premier mari de cette dernière, Scarron, à l’époque où elle était encore futile et légère, bien avant qu’elle ne devienne une grenouille de bénitier. Ce passage est sublime et Saint-Simon dépeint à merveille son désespoir, qui finira par le tuer. C’est là que la mémoire de l’individu se superpose à celle de son temps, dans une perspective universelle, celle du temps qui passe.
Il faut toujours distinguer le journal intime des mémoires. Les mémoires ne traitent pas de l’intimité, ils servent à se faire valoir. Ils sont par principe moins sincères que le journal. Ce dernier a beaucoup évolué à partir du début du XXe siècle. Je parlais d’égotisme avec Stendhal mais à partir de Gide, il y a cette espèce de goût presque exhibitionniste pour l’aveu, ce qui faisait dire à Claudel, qui était très généreux pour ses confrères : « Le journal de Gide, c’est le journal d’un malade qui se penche sur son pot de chambre pour voir la couleur de ses urines ».
Il faut toujours distinguer le journal intime des mémoires. Les mémoires ne traitent pas de l’intimité, ils servent à se faire valoir. Ils sont par principe moins sincères que le journal.
Il y a une autre forme de journal qui a fait son apparition plus tard, à partir du sartrisme et de l’existentialisme, de l’homme déchu à la Beckett, c’est le dénigrement de soi. On lit par exemple dans le Journal de Michel Leiris cette envie permanente de se dénigrer et de faire voir qu’il n’est pas si mauvais malgré ce dénigrement.
C.G. : Cette partie figure plutôt, il me semble, dans La Règle du jeu, qui n’est pas un journal. C’est une étude en profondeur, et sous forme d’un récit extrêmement élaboré.
C.D. : Alors c’est un faux journal ou un récit biographique.
C.G. : C’est surtout une analyse très poussée et maladive de soi, avec psychanalyse à la clef bien entendu. Il commence même avant La Règle du jeu, avec l’Age d’homme qu’il écrit à trente-trois ans, qui est son premier livre d’autobiographe et que je n’aime pas du tout, je trouve cela fade. Dans l’Age d’homme, il raconte son opération des végétations quand il avait quatre ans. On retombe dans le travers que je dénonçais tout à l’heure puisqu’il raconte cela trente ans plus tard. Il explique qu’il s’agit là du drame de sa vie, qui a entraîné des conséquences monstrueuses parce que les médecins et ses parents lui ont menti. C’est alors qu’il a compris que la bête humaine est une saloperie épouvantable et qu’il faut comprendre le contraire de ce que les gens vous disent. Je pense, pour ma part, qu’il s’agit là d’une littérature de mauvais goût, qui est fabriquée et artificielle.
G.N. : Pour revenir sur le cas de Rousseau : dans votre œuvre, le lieu, peut-être plus que l’action ou le temps, semble primordial ; qu’il s’agisse de votre service militaire en Allemagne ou la guerre en Algérie, des voyages que vous effectuez au Brésil ou en Chine, vos errances nocturnes dans Paris… le lieu où vous vous trouvez semble être un moyen de connaissance de vous-même. C’est en cela une démarche rousseauiste puisque, si l’on cite Rousseau dans une de ses Lettres morales, il dit : « Commençons à nous rassembler où nous sommes, afin qu’en cherchant à nous connaître, tout ce qui nous compose vienne à la fois se présenter à nous ».
C.G. : Je suis assez peu visuel, je ne m’occupe pas tellement de l’endroit où je me trouve. Mais quel que soit l’endroit où l’on vit, cela peut exercer une influence sur votre état d’âme.
C.D. : Dans mon journal, on bouge beaucoup, puisque je suis un écrivain voyageur. L’action de mes trois volumes se déroule à une époque où, en tant que passionné de tauromachie, je me rendais surtout en Espagne pour pouvoir manier la cape avec de jeunes toreros. J’y parle aussi d’Italie, où j’ai passé une partie de mon enfance puisque mes parents m’envoyaient dans un collège religieux en Italie afin que je m’exerce en italien, qui était la langue étrangère principale à mon baccalauréat. J’éprouve un grand amour de l’Italie qui a duré toute ma vie. Et puis, plus tard, ce fut l’Afrique, quand j’étais médecin.
G.N. : Christian Guillet, la figure de votre père occupe une place centrale dans votre œuvre. Je vous cite : « Mon père constituait la meilleure part de moi ». Vous a-t-il légué aussi cet amour de la littérature à laquelle vous avez consacré votre vie ?
C.G. : Je crois que Léautaud a raison quand il dit qu’on n’est jamais influencé que par quelqu’un qui nous ressemble. Cela me paraît logique, bien que personne n’y songe. Le goût pour la littérature était certainement inné chez moi, mais je ne le savais pas et mon père me l’a révélé. Nous nous sommes influencés l’un l’autre. Ce n’était pas le cas de mes quatre frères et sœurs pour qui la littérature n’avait aucune importance. Il s’agit très souvent d’une révélation que quelqu’un fait de votre Moi.
G.N. : L’amour semble être une épreuve. Si je vous cite encore une fois : « Celui qui aime est habité par un Dieu, mais il est plus seul que celui qui n’aime personne ». Est-ce que, pour vous, l’amour est une épreuve de solitude ? Cela serait a priori paradoxal.
C.G. : Oui, mais c’est sincère de ma part. Je crois qu’on n’aime pas comme l’autre vous aime (s’il vous aime), mais vous pouvez aussi aimer quelqu’un qui ne vous aime pas. C’est dramatique. C’est en cela qu’il s’agit d’une épreuve de solitude. Il y a toujours quelque chose d’illusoire dans un couple, ne serait-ce qu’à cause de la différence des sexes.
C.D. : La plus belle chose qu’on ait écrite sur l’amour, ce sont les Lettres d’une religieuse portugaise. « Faites tout ce qu’il vous plaira ; mon amour ne dépend plus de la manière dont vous me traiterez ».
G.N. : Sans recourir à l’expression un peu cliché du « récit initiatique », tant votre journal, Christian Dedet, que votre autobiographie, Christian Guillet, sont des récits de l’expérimentation et de la découverte. On y parle par exemple de l’initiation à l’amour, des premiers émois. Votre journal, qui débute au sortir de l’adolescence, est une longue quête de l’amour qui trouve son aboutissement à la fin du deuxième volume et surtout au troisième quand vous évoquez votre vie conjugale. Cela est le prétexte d’un très beau passage concernant votre voyage de couple en Sicile et nous allons commencer la lecture des extraits.
C.D. : Nous avons fait, mon épouse et moi, le voyage de noces en Sicile, avant les noces elles-mêmes. Nous y avons passé les trois mois de l’hiver 1966-1967, un hiver dans une Sicile sublime et tragique.
G.N. : Extrait de Nous étions trop heureux (journal 1967-1970) de Christian Dedet
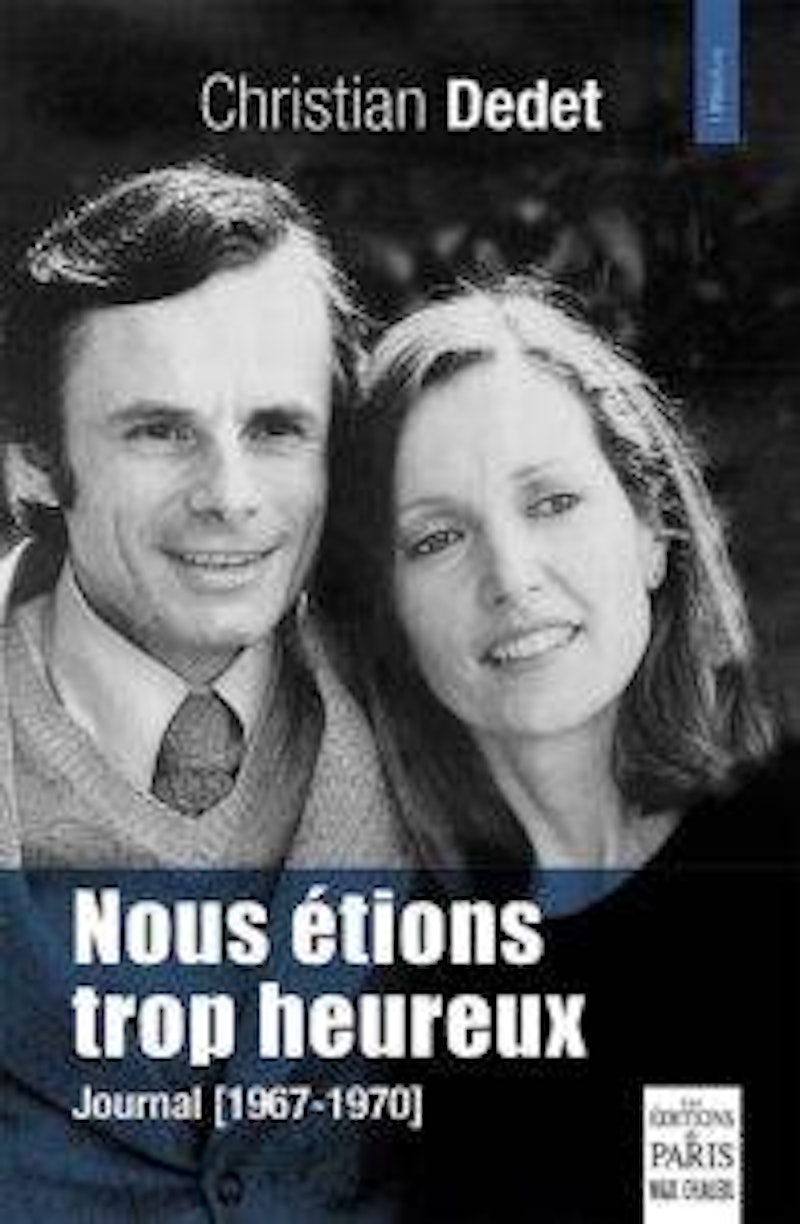
« Les cérémonies nuptiales me fascinent, je ne suis heureux que lorsque je me marie. C’est ce qu’a déclaré un certain Donati aux carabiniers venus l’arrêter devant l’autel de la Santissima Immacolata, à Messine. Sa fiancée s’est évanouie avant de prononcer le « oui » qui eût fait d’elle sa quatorzième épouse !
Qu’est-ce qui est le plus étonnant dans ce fait divers : l’habileté de l’homme à falsifier des pièces d’état civil ou son acharnement à assouvir une manie grandiose ? Les journaux ne blâment pas, ils commentent avec gravité. Dans les pays qu’imprègne le sacré, le personnage de l’aventurier garde une dimension métaphysique. Et puis ici, les prouesses de Donati font rêver l’âme oriental. Au printemps, il se fiance à Pérouse avec une jeune fille de vingt ans, puis avec une institutrice sicilienne à peine plus âgée, tout en épousant à Parme une veuve bien en chair. Il quitte Parme peu après, épouse à Venise, sa fiancée de Pérouse, l’abandonne à Bolzano. Nouvelles fiançailles à Florence. Il gagne enfin Messine, décidé à épouser la jeune Sicilienne. Goûtera-t-il une fois encore au délicieux émoi ? Il s’en faut d’un cousin soupçonneux ou d’un frère à couteau. L’homme est en prison ! Il a cependant l’avenir devant lui. En effet, seul le premier mariage est reconnu valable. Les douze autres seront déclarés nuls et rayés des registres de l’état civil. Ultime drôlerie, sa première femme a demandé l’annulation en cours de Rome. Donati sortira de prison célibataire, libre comme au premier matin.
Taormina, 25 septembre.
Nous avons tout l’hiver devant nous. Je me suis organisé pour travailler : cinq jours avec heures de bureau, comme la plupart de nos contemporains. […]
Je voudrais écrire ici (à tout le moins mettre en route) ce fameux livre que le Seuil attend et que les futilités de la vie parisienne, les incessantes tentations de la chronique littéraire (sans parler de mes mois de médecin, l’été, aux eaux de Châtel-Guyon) me font différer depuis deux ans. »
Il y a dans mes journaux beaucoup d’inquiétude créative, de dénigrement, de soi, d’encouragement, d’illusions, de faux départs, d’enthousiasme. Enfin, le drame de l’écriture, qui est extrêmement douloureux, parfois et voluptueux toujours.
« Je pense que c’est une photographie de Paule enfant, vue les premiers temps où nous sommes mieux connus, qui m’a fait comprendre à quel point il était possible que je devienne amoureux d’elle, que je m’attache à tout jamais à elle. Aimer une femme n’est pas seulement la saisir (la prendre) dans son instant présent mais tenter de percer le mystère qu’elle est – si tant est qu’il soit possible de percer le mystère de la femme. S’attendrir jusqu’à l’adoration en pensant à l’enfant qu’elle fut.
Paule, écolière de sept ou huit ans, sur ce cliché à l’argentique un peu pâli mais intact, fixée dans son attention plus sage que timide, assise avec sa blouse de percale qui laisse voir ses jolis petits genoux, tenant à deux mains un livre ouvert qu’elle ne regarde pas – ceci pour mieux répondre à la gravité de l’instant et lever les yeux qu’elle a déjà si profonds dans l’attente – qui sait ? – de la beauté du monde. Mais cette beauté, saurai-je l’aider à la trouver ? Serai-je capable de la lui faire vivre dans la durée ? Parfois une bouffée d’inquiétude me gagne quand je réalise tout à coup à quoi je me suis exposé en entraînant ce petit ange, qui cache si bien son jeu, sur les routes d’Italie. Il me semble, grâce à cet amour, avoir quitté le personnage mi-bouffon, mi-tragique que je m’efforçais de paraître, au début des années 60 (« homme de paille, comme eût dit Pierre-Jean Jouve dans Paulina 1880, mais de belle qualité : prêt à brûler avec beaucoup d’étincelles ») ; […] »
Cela tient de la chronique, c’est la Sicile, l’amour… Le journal, pour moi, se vit au flux des impulsions, des tentations, des souvenirs, des anxiétés, des inquiétudes et puis de la condition humaine.
Extrait d’Adieu trophées de Christian Guillet :
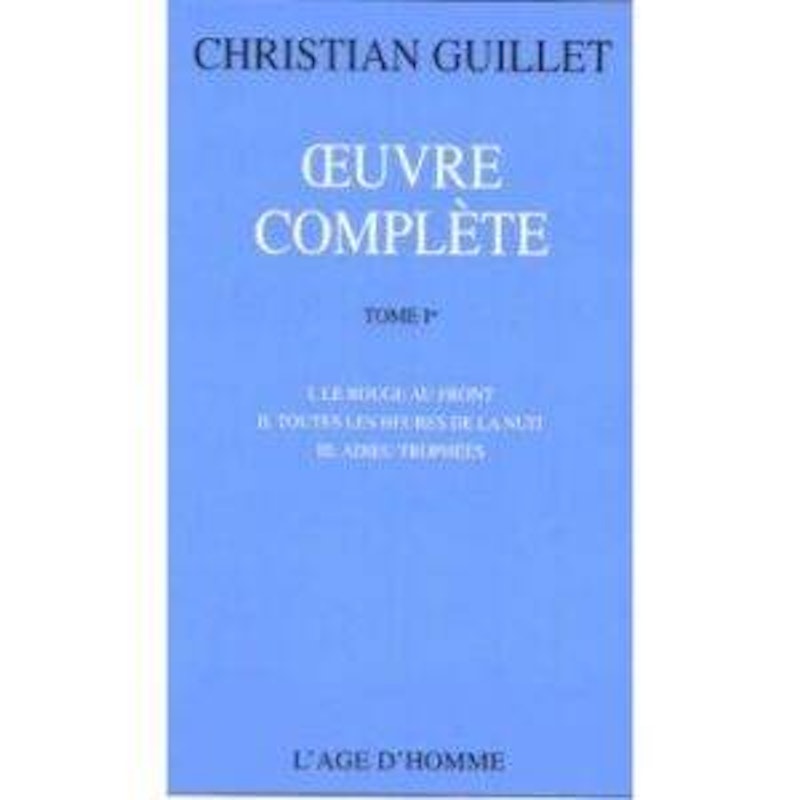
C.G. : Je vais vous citer des extraits qui permettent d’illustrer ma conception de l’autobiographie telle que je vous l’ai expliquée. Le premier extrait nous emmène en mars 1961 à Tlemcen, pendant la guerre d’Algérie pour laquelle j’ai été mobilisé.
« Dans les rues, je me trouvai seul pour la première fois, le mélange insolite de colons et d’indigènes exprimait en lui-même la désharmonie, et d’instinct rassuré au passage du moindre Européen, je me retournais avec effroi dès que j’entendais des pas dans mon dos. […] je me sentais dans un pays ennemi où l’ennemi restait le maître et attaquait où il voulait. Je gagnai la vaste citadelle médiévale, véritable maison de passe où le drame se retrouvait en miniature : […]. Dans le bruit des ambulances, des chiens de l’armée et des soldats libérables qui partaient en chantant, j’entendais rarement le silence – tel un autre drame, […] et j’ouvris une fenêtre du donjon où j’avais atteint ma chambre : des pierres faillirent me tuer, lancées à mon adresse par des gamins arabes… Ainsi la fin de cette guerre ressemblait-elle à son début, et plutôt que d’assister à des combats particuliers auxquels on rêve de prendre part, mais dont le caractère artificiel permet peu d’embrasser un mouvement historique, j’arrivais à ce moment de la fin qui, comme l’agonie des hommes, se révèle plus riche que l’aventure qui l’éclaire. […] La guerre ! Une des rares passions auxquelles les hommes peuvent se livrer sans la femme, une de ces turpitudes qu’ils n’oseraient pas commettre devant elle : la guerre forme la plus belle fête des hommes, on ne prendrait jamais pour ses animateurs ceux qui, dans le courant des jours, trahissent une douce médiocrité et qui en sortent sous la poussée d’un démiurge très puissant.[…] Il me semblait jouer au poker en traversant les rues, chacun de mes pas équivalait à un pari pour la vie ou pour la mort, je ne sentais même plus ma vie, désormais abstraite comme une courbe, et j’avais beau me persuader que je n’étais pas homme à mourir pour rien, la politique de mon pays soudain concernait ma peau : devinant déjà combien les gouvernements avaient menti, accablé par le poids du monde en agonie que je représentais ici, je joignais à mon amertume un besoin d’énergie insensée. »
Je vous donne un dernier texte. Ma femme est enceinte et je rêve à l’enfant que je ne connais pas et que nous allons avoir. Et cette inspiration me paraît primordiale par sa banalité, c’est-à-dire son caractère souverain, éternel, universel.
Extrait de Le Temps du partage de Christian Guillet :
« Le temps passait, tandis que ma plume cherchait les premières images de notre enfant, les aiguilles de Simone inventaient pareillement ses mesures faute de pouvoir les prendre, elle tricotait des barboteuses avec une tendresse pour lui qui se tissait de maille en maille en révélant ses formes avant lui-même, ses habits peu à peu bien rangés et d’autant plus touchants qu’il n’existait pas encore s’ajoutaient aux petits meubles dont chaque apparition répétait sa naissance prochaine, sa garde-robe minuscule laissait croire qu’il habitait depuis longtemps déjà la maison qui tout entière se préparait à l’accueillir comme si la vie d’un être le précédait sur la terre. […] Je me prenais pour lui et d’avance regardais le monde comme à travers ses propres yeux […] et à son exemple me dressais sur la pointe des pieds sans même en avoir besoin : un guéridon au contraire ou une jeannette ou le coussin d’une escabelle m’indiquaient ses futures proportions et la couleur d’une dragée ou l’onctuosité d’une purée ou la tendreté d’une viande prêtaient à ma bouche la fraîcheur de la sienne, et je cultivais pour le connaître des spontanéités puériles en déplorant l’effort nécessaire à les retrouver – et déjà je l’apercevais dans toutes mes faiblesses ou mes fautes de grammaire. […] Je découvrais lentement la seule sorte d’amour qui commence avant la naissance de celui qui en est l’objet et lui portais cet amour intermittent comme était encore sa présence parmi nous, mais chaque jour je l’aimais davantage à l’idée qu’il existait un peu plus que la veille. […] Son influence à lui aussi grande qu’il serait petit m’inspirait une tendresse qui le précédait pareille à une première expression de lui-même, une tendresse qui au long des mois vieillissait déjà un peu dans mon âme si joyeuse pourtant de savoir qu’en réalité il n’était pas même encore jeune, une tendresse telle sans doute que s’il était né en effet avant sa naissance […] une qualité de tendresse jusqu’alors imprévisible dans mon existence mais que la nature m’imposait de la même façon qu’elle épanouirait pour lui des sourires ou des fleurs. Il accompagnait déjà ma vie dans la rue où sous le soleil dansait sa petite ombre près de la mienne, où je penchais maintenant une tête souriante et marchais moins vite comme pour qu’il me suivît. […] ».
- Nos plus sincères remerciements à Christian Dedet et Christian Guillet pour leur participation, à Juan Asensio (qui a défendu plus d’une fois l’œuvre de Christian Guillet dans son blog Stalker), à Benoît Galland et à toute l’équipe de Zone Critique pour avoir permis l’organisation de cette soirée.
- Entretien animé et retranscrit par Guillaume Narguet.
- Photo : Christian Dedet et Christian Guillet, mars 2022.

















