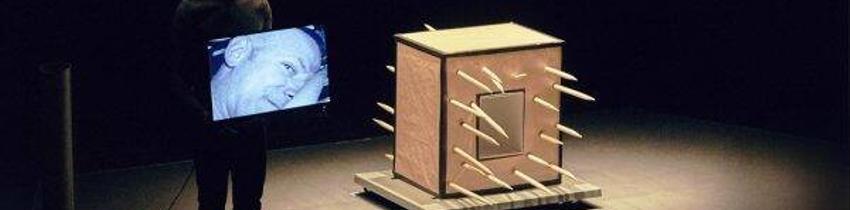Zone Critique a rencontré Bertrand Burgalat, musicien érudit et désopilant mais aussi directeur de Tricatel, label défricheur sans équivalent. Une discussion à rebours des postures et des passages obligés avec cette figure majeure de la pop en France.
On aimerait écrire qu’on ne présente plus Bertrand Burgalat… Et pourtant le musicien semble naviguer depuis deux décennies dans l’indifférence quasi-générale. Ce n’est pas faute d’avoir été associé à un nombre invraisemblable de projets, souvent salués par la critique mais n’éveillant qu’une estime sans lendemain du public. Qu’il soit sur scène pour interpréter ses titres avec Aquaserge ou A.S. Dragons, sur France Inter pour Face B, délirante émission d’une seule saison (en regard de laquelle Pascale Clark et ses velléités de DJ peuvent aller se rhabiller), ou ailleurs, déjà ailleurs, il s’évertue à maintenir ce fragile équilibre de ceux qui ont pris leur parti de composer avec les aléas de la notoriété.
C’est ainsi qu’il ne cesse de déployer sa pop sincère et singulière afin de « poursuivre et amplifier » l’aventure Tricatel. Ces derniers temps cela donne la musique accompagnant le défilé inaugural de la marque éponyme de sa femme, la styliste Vanessa Seward, ou encore la bande originale de Gaz de France, premier long-métrage encore inédit du réalisateur Benoît Forgeard, son comparse du Ben & Bertie Show sur Paris Première. Puis la sortie de l’album Big Sun, sidérant détour par la Martinique de Christophe Chassol, virtuose des assemblages musique-vidéo qu’il a baptisé ultrascore.
On a voulu savoir ce qui se cachait derrière cette débauche d’énergie. Entendre quelles influences ont jalonné ce parcours. Éviter autant que possible de recycler les poncifs sempiternels : dandy, rétro, branché, décalé, on en passe… Mais : inclassable peut-être, insaisissable sans doute, intarissable assurément ! Alors laissons dire et écoutons plutôt Bertrand. En avant la musique !

Dans ton dernier album studio, Toutes directions, sorti en 2012, des amis, la plupart écrivains, t’ont proposé des textes que tu as ensuite mis en musique ou qui sont venus s’intégrer à une mélodie existante. Peux-tu revenir sur cette approche ?
Ce qui est paradoxal avec les albums que je fais en tant qu’interprète, c’est justement que je ne me sens pas bien dans ma peau d’interprète, je ne me sens pas chanteur. Ce que j’aime c’est faire de la musique, c’est concrétiser des choses. Et j’interprète ces chansons parce que c’est parfois le seul moyen pour qu’elles existent. Si quelqu’un d’autre pouvait le faire je serais ravi, parce que j’ai trop de respect pour le côté showman pour prétendre à cela. Dans le fait de sortir un album ou de faire des concerts il y la dimension d’un spectacle à proposer et je trouve cela prétentieux de faire payer le public pour se regarder les pieds et chanter approximativement.
Pour les textes, j’ai toujours travaillé avec des paroliers car je ne pense pas avoir ce talent, surtout quand il s’agit de parler de moi alors que j’essaie de réaliser des choses assez personnelles, même intimes par certains côtés. Donc ce travail d’équipe qui est de toute manière intéressant, me permet de dire des choses plus personnelles, alors que je m’autocensure davantage si j’écris pour moi. Je n’ai pas l’impression d’étaler ma vie mais d’exprimer des choses plus universelles.
J’ai aussi la chance de connaître des gens qui ont une écriture splendide. Par exemple Elisabeth Barillé. On peut être un écrivain formidable et être incapable d’écrire de bonnes paroles. D’abord, on est trop souvent intimidé par le côté rime et métrique. On a alors tendance à penser que ne compte que les rimes, le nombre de pieds, alors que c’est la musicalité, quelque chose de plus vaste, qui est essentiel. Je me souviens de romans qu’Elisabeth était en train d’écrire et dont elle me lisait des passages, on ressentait directement cette musicalité avant même qu’elle fasse des chansons. Donc je pense que c’était assez facile pour elle de m’apporter un texte fluide, que je pouvais immédiatement adapter.
Mais on m’a aussi envoyé des textes qui comportaient des irrégularités ce qui m’obligeait à sortir de certains automatismes dans la mélodie et à composer des choses plus singulières.
Qui sont les autres collaborateurs de cet album ?
Il y a Matthias Debureaux, un vieil ami qui a déjà écrit beaucoup de chansons avec moi. Il a sorti deux livres absolument poilants, L’art d’ennuyer en racontant ses voyages et Les dictateurs font très bien l’amour dans lequel il reconstitue quinze rencontres aberrantes mais qui ont vraiment eu lieu. À chaque fois, il a un côté assez journalistique, il a un thème et sait très bien la direction qu’il prend.
Il y a également Laurent Chalumeau, qui par ailleurs écrit des polars que je prends toujours énormément de plaisir à lire. C’est très bien ficelé, ça se passe souvent sur la côte d’Azur…
Hélène Pince m’a aussi rédigé plusieurs textes pour lesquels on a eu des approches opposées. Pour Bardot’s Dance j’ai composé la musique à partir du texte, ce qui explique un peu le côté semi-parlé. Et pour La Rose de sang, elle s’est vraiment calée sur la musique.
Enfin, sans être exhaustif, il y a eu Marie Möör qui m’avait envoyé le texte de Sur les colombes de granit. C’était une ébauche que j’ai décidé de conserver telle quelle, justement pour les irrégularités, parce que c’est un texte somptueux.
Considères-tu comme un atout cette multiplicité de sources, ces regards croisés, ces sensibilités qui éventuellement convergent ?
J’essaie d’éviter de faire un disque avec un ou deux titres commerciaux et des morceaux de remplissage. Ce qui m’intéresse c’est que chaque chanson complète les autres, à la fois dans la musique et dans le tempo, pour créer une continuité à travers l’album, une sorte de petit film, même si c’est un peu un cliché. En tant qu’auditeur, cette juxtaposition d’écritures au niveau des textes correspond à la multiplicité d’états d’esprit qu’on traverse, ne serait-ce qu’au cours d’une journée.
Je répète souvent que ne pas connaître le grand succès, toujours rencontrer des difficultés pour faire aboutir les projets a au moins le mérite de ne pas nous rendre prisonnier d’une recette. Rien ne m’empêcherait par exemple, j’y ai souvent songé d’ailleurs, de faire un album uniquement avec des tempos extrêmement lents. La différence c’est que si par exemple Radiohead sortait ça demain, on dirait : « Oh mais quelle audace, ils ont fait des trucs incroyables, ils ont pris des risques fous en faisant des morceaux assommants etc ! » Moi ça n’aurait aucun impact positif ou négatif, ça le laisserait simplement face à moi-même, face à ce que j’ai envie d’exprimer.
D’où venait le titre Toutes Directions ?
J’avais lu le Les Insoumis d’Éric Neuhoff, un essai dans lequel il évoquait des figures très sympathiques des années 60-70. Il parlait de Paul Gégauff, Maurice Ronet, Pascal Jardin, Jean-Pierre Rassam et surtout de Dominique de Roux. Au début du texte qu’il consacrait à ce dernier, il avait cette phrase que j’avais trouvé à la fois belle et juste – je cite en substance mais c’était mieux écrit : « Toute sa vie, il a suivi le panneau toutes directions. » Ce titre était pour moi une manière de clin d’œil à un écrivain qui m’a beaucoup marqué, notamment à travers sa correspondance.
Je n’irais pas à Venise, j’irais plutôt à l’échangeur de Bagnolet ou autour du Carrefour Pleyel à Saint Denis, ça ce sont des endroits romantiques !
Et puis, sans aspirer à la dispersion, Toutes Directions signifiait que tout est possible, même si à cinquante ans alors qu’on on se rend compte que tout est sans doute joué, qu’on a beaucoup pleurniché sur des projets, qu’on a perdu énormément de temps à essayer de rencontrer et de convaincre des gens pour qu’ils les soutiennent… Alors que ça pourrait être autre chose. Mais ce n’est pas non plus la tentation de Venise ! D’abord parce que je n’irais pas à Venise, j’irais plutôt à l’échangeur de Bagnolet ou autour du Carrefour Pleyel à Saint Denis, ça ce sont des endroits romantiques !
Tu as quand même chanté plusieurs fois en italien…
Oui bien sûr. J’adore l’Italie et je n’ai rien contre Venise en soi. Mais je suis plutôt du côté de Régis Debray et de son essai Contre Venise, ou de Marinetti proposant de vitrifier cette ville-musée ! Car tout ce que signifie Venise pour le bon goût d’aujourd’hui, le vieux beau qui emmène une jeune fille et lui montre des monuments, puis s’en va chez une vieille duchesse qui lui prête son palais, moi ça ne m’évoque rien !
Plus largement, en musique c’est assez facile de se dire que pour l’album suivant, on va changer de studio, de musiciens, de pays. On trahit un peu tout le monde, on vire les vieux potes et finalement on produit un truc inédit. Mais ça reste cosmétique, on reste face à soi-même. Il y a un poème de Constantin Cavafy qui résume tout ça (NDLR : il s’agit de La ville). Donc pour changer sur le fond, je crois qu’on fait aussi bien de garder les mêmes instruments et de partir de là pour parvenir à quelque chose de différent. Après, je n’ai jamais eu tellement le choix.
Tu penses que c’est la raison pour laquelle on t’a souvent identifié à un certain style, une certaine coloration du son, assez luxuriante et mélancolique ?

Je n’ai jamais eu la volonté d’avoir une marque, de sonner de telle ou telle manière et de le répéter à l’infini. C’est plutôt inconscient. Je reviens vers les mêmes sons, les mêmes styles et j’essaie de varier sur le motif en prenant ce que j’ai à disposition dans le studio. S’il y a un piano dans la salle d’enregistrement alors j’ai de fortes chances d’intégrer des plages de piano à certains morceaux. S’il y a un vibraphone, je m’en sers aussi. Et s’il n’y a rien j’essaie de faire avec. Je pense notamment à certaines musiques que j’ai composées pour des films, l’absence de budget m’obligeant sur le plan créatif à trouver des alliages d’instruments originaux, assez différents du simple truc pseudo-symphonique, en y arrivant par des voies détournées. Finalement, les contraintes sont surtout frustrantes pour les musiciens avec qui je travaille et qui mériteraient de beaucoup mieux gagner leur vie.
Comment s’est construit ton itinéraire musical ?
À 10 ans, je découvre Pink Floyd puis Stravinsky pour la musique classique. Dans ce domaine d’ailleurs je m’intéresse essentiellement à la période qui va de Debussy à Messiaen. À l’époque, il y a eu aussi Soft Machine et le reste du rock progressif.
Puis j’ai vécu à Londres. C’était en 1978 et j’avais 15 ans. À cette époque, à Londres, la mode était plutôt à la comédie musicale Grease qu’aux Sex Pistols. Le punk était un phénomène très fugace, qui venait de se terminer. Tout le monde pensait d’ailleurs que ce serait pareil avec le rock. On le ressent bien quand on voit À la mémoire du rock, le film merveilleux de François Reichenbach, tourné en 1961. En gros jusqu’à l’arrivée des Beatles, qui étaient au départ un groupe de revival, le rock et ses variations apparaissaient comme une mode qui allait passer et être remplacée comme le twist ou d’autres styles de musique.
Au début, de grands artistes tels Bowie et Brian Ferry me paraissaient très superficiels. Ce qui est marrant, toutes proportions gardées car je ne me compare pas à eux, c’est que quand j’ai créé mon label, certains le voyaient comme un truc de poseur, de mondain superficiel, ce qui était exactement ce que j’avais pu reprocher à des groupes comme Roxy Music ou T-Rex, que j’ai adorés par la suite.
Ensuite il y a eu un truc extraordinaire qui s’est complètement fracassé avec toute la vague new-wave en France entre 1979 et 1982, vraiment juste après le punk. Des groupes comme Mathématique Moderne, Suicide Romeo, Artefact, le groupe de Maurice G. Dantec… Il y avait aussi un contexte. Je pense qu’à l’époque ceux qu’on appelait les branchés étaient beaucoup plus hautains, plus méchants, assez inaccessibles et en même temps beaucoup plus libres car pas du tout conformistes. Aujourd’hui c’est davantage des gens qui attendent en permanence l’approbation pour aimer telle ou telle chose. Eux avaient un regard neuf parce qu’ils avouaient et transformaient en permanence leurs admirations.
Ton goût pour la chanson à texte est donc venu plus tard ?
En ce qui me concerne, pendant longtemps les émotions passaient surtout par la musique tandis que les paroles venaient presque polluer l’écoute. Je considérais la chanson presque comme un truc de prof, un truc un peu chiant. Mais par capillarité, d’abord en revenant à certains groupes anglais, je me suis rendu compte que parfois des morceaux qui avaient l’air désinvoltes ou superficiels reposaient sur une écriture extraordinaire et souvent très profonde.
Donc ça a été le parcours classique : Gainsbourg, Polnareff, Françoise Hardy comme portes d’entrée. Puis je suis passé à Vassiliu. Et plus récemment – je venais de finir l’album avec Houellebecq, Pierre Bouteiller passait sur France Inter La Solitude de Léo Ferré, que je ne connaissais pas. D’abord c’était sidérant, je me suis rendu compte que c’était exactement ce qu’on avait essayé de faire ; et puis c’était simplement une chanson très forte. Je me suis ensuite intéressé à Caussimon, à toute cette période pendant laquelle Ferré écrit et dirige des orchestrations ravéliennes. J’ai été ébloui par tout cela. J’étais passé à côté de Ferré parce que son emphase me déconcertait et parce que je ne connaissais pas cette période qui commence quand il quitte sa femme Madeleine et à partir de laquelle, d’après moi, il fait ses plus beaux morceaux. Mais finalement le plus agréable c’est quand on parvient à surmonter certaines réticences ou juste une méconnaissance pour découvrir qu’on aime des choses qu’on ne connaissait pas ou qu’on pensait qu’on n’aimerait pas.
J’ai eu ça aussi avec le reggae. Quand j’étais à Londres c’était l’explosion, j’avais vu des groupes comme Inner City au Rainbow et ça ne me parlait pas beaucoup. Je ne trouvais pas leur musique vraiment planante ou spatiale, contrairement à ce qu’on en disait et malgré toutes les drogues qu’ils avaient l’air de prendre ! Mais j’y ai été ramené par toute la culture Mod et la Northern soul. Je suis arrivé au rocksteady, à John Holt, du reggae d’avant le reggae si l’on peut dire. En général pourtant j’ai tendance à moins écouter les sources que leurs applications, comme avec Bach et Ravel, ou le blues pur et la soul, que j’écoute plus volontiers…
Et le jazz dans tout ça, comme dirait (ou presque) Jacques Chancel ?
Mon rapport avec le jazz est assez paradoxal. Je m’y suis d’abord intéressé via Magma vers mes 14 ans. Christian Vander parlait sans cesse de Coltrane que je me forçais à trouver génial. J’aimais bien Naima, My Favorite Things, que je croyais être un original, mais j’étais assez insensible à ses morceaux plus abstraits. À Londres j’avais vu deux fois Elvin Jones. Je me suis intéressé au jazz à un moment où il se mettait dans cette impasse du jazz-rock, une sorte de musique modale, sportive, où les mecs jouent de plus en plus vite. C’est assez marrant d’ailleurs de constater que le mot feeling a quasiment disparu du vocabulaire des musiciens de jazz. Une des choses les plus drôles est de regarder Jazz à Vienne sur le câble, de couper le son et de regarder les mimiques que font les musiciens – c’est affligeant, on dirait un film porno, les plans de coupe sur le visage du mec en pleine pignolade. Je fais une autre parenthèse : récemment je n’ai pas voulu voir Whiplash. J’avais l’impression que ce film donnait une vision mécanique de la musique, comme une performance alors que l’improvisation n’en est en fait presque jamais : les types font des gammes, ils ont leurs grilles, alors que dès qu’on sort de ça…
Mais encore une fois, on a des préjugés qui s’effacent aussi. C’est ce qui s’est passé par exemple quand j’ai découvert certains morceaux de Pharoah Sanders, de Dolphy, d’Ahmad Jamal, de Duke Ellington aussi, les trois Sacred Concerts dans les années 1960 ou des morceaux très lents comme On a Turquoise Cloud.
Duke Ellington qui avait d’ailleurs une sensibilité littéraire certaine puisqu’il a sorti un album, Such Sweet Thunder, dont chaque morceau renvoie à une pièce de Shakespeare…
Oui, j’ai eu il y a 15 ans avec lui le même émerveillement tardif que quand, dans les années 80, j’ai découvert que les Beach Boys avaient des choses comme Pet Sounds. Ce que j’ai aimé chez lui c’est une forme de musique où tout demeure dans la succession des instants. Mais finalement, ce qui a été fait de mieux en improvisation ce sont les membres de Can, qui d’ailleurs considéraient qu’ils ne faisaient pas de l’improvisation mais de la composition instantanée.
Dans un genre très différent, t’es-tu intéressé aux grands poètes folks comme Dylan, Young ou Cohen ?
Pas tellement. Je sais qu’il y a des choses formidables. Mais c’est toujours resté un peu mystérieux pour moi. Quand j’entends des gens dire d’un air très profond « Comme le dit si bien Dylan, The times they are a-changin’… », c’est comme si j’entendais Laurent Wauquiez parler des « valeurs », je me demande vraiment à quoi il peut bien penser !
La façon dont j’appréhende un texte de chanson est totalement instinctive et donc je vais réagir sur une image. Tout d’un coup il va y avoir une phrase vraiment suggestive.
Mais la façon dont j’appréhende un texte de chanson est totalement instinctive et donc je vais réagir sur une image. Tout d’un coup il va y avoir une phrase vraiment suggestive. Par exemple, je pense à Ferré, dans Night and Day : « Ton cancer a deux jours et tu as dix-huit ans » ou ailleurs dans Je t’aimais bien, tu sais : « Je te vois comme une algue bleue dans l’autobus / à la marée du soir Gare Saint-Lazare »
J’ai un peu la même méfiance avec la peinture : il faut faire très attention aux choses qu’on a envie d’aimer. Je vois que Libé vend toujours sa couv’ avec Obama parce que tout le monde avait envie qu’il soit bien. Idem avec Picasso ou Glenn Gould, même si je ne suis pas certain que l’auditeur ou le spectateur fasse tellement la différence avec un autre interprète, un autre artiste, ni ne prenne la peine de les apprécier en soi. On a cette forme de culture officielle qui ne porte pas sur de mauvaises personnes, parce que ce sont des gens immensément talentueux, mais pour de mauvaises raisons, le côté artiste torturé, etc.
Tu as réalisé plusieurs albums avec des personnalités liées à la littérature, au cinéma, par exemple Jonathan Coe ou Ingrid Caven. As-tu eu l’impression de pouvoir envisager la musique autrement en travaillant avec eux ?
J’ai eu la chance d’avoir été en en contact avec beaucoup de personnes issues de domaines différents. Des peintres, des dessinateurs et des photographes pour les pochettes d’albums ; des cinéastes pour les vidéos ou pour composer la musique d’un film et enfin, des écrivains qui souhaitaient s’orienter vers autre chose, entrer dans une autre sphère. Pour le label Tricatel et pour moi, c’est une manière d’explorer de nouvelles pistes.
Parfois, il peut aussi y avoir une alchimie, mais sans aucun résultat. Le but n’est pas de faire un coup publicitaire en disant « voilà j’ai travaillé avec untel ! », ou de sortir quelque chose à tout prix. Je pense par exemple à Jack-Alain Léger qui était un grand ami et qui m’a écrit des paroles à un moment difficile pour lui ; le projet n’a donc pas abouti parce que je n’osais pas lui demander de les retravailler, à un moment où tout était une épreuve pour lui. Pareil avec Jean Parvulesco, que j’aimais beaucoup et qui m’a écrit des textes, que je ne voyais malheureusement pas comment les habiller à ce moment-là.
Il y a quand même eu Présence humaine, l’album assez légendaire que tu as réalisé avec Houellebecq…
Dans le cas de Houellebecq, on s’est rencontrés il y a vingt ans. C’était l’époque où Nicolas Bourriaud et Jean-Yves Jouannais montaient la

RevuePerpendiculaire. Je venais de lire Extension du domaine de la lutte, je ne connaissais pas du tout le personnage, mais j’avais adoré son texte qui tranchait avec la production littéraire de l’époque. C’est un livre vraiment important en y repensant rétrospectivement mais qui en même temps contenait en germe une certaine méchanceté qui est apparue ensuite.
Donc il y a eu des années assez chouettes, pleines d’excellents souvenirs. Puis, j’en ai déjà parlé ailleurs, cela s’est plutôt terminé en cauchemar pour le label. Je pense que c’est un type dont le succès a radicalisé les aspects les plus sombres, son côté dominant secret et son sentiment de toute-puissance.
Je cite toujours un peu la même histoire à laquelle cela me fait penser. Dans Casino Royale, Woody Allen, qui joue le Dr. Noé, veut exterminer tous les types plus grands que lui. À un moment, devant Ursula Andress, il évoque un monde d’amour, où tout le monde serait libre et égal… Elle commence alors à tomber un peu amoureuse et lui dit « Mais je ne savais pas que c’était ça que vous vouliez! » et lui répond : « Non, ça c’est ce que je combats ! ».
Je pense donc que dans le succès de Houellebecq, il y a cette ambiguïté de l’homme qui dénonce ce qu’en fait, d’une certaine manière il aime, et inversement. Mais je suis surtout sévère avec son entourage, sans être dupe du côté déchéance, déglingue, qu’il a parfaitement intégré. J’ai lu l’analyse de Soumission qu’a faite Marc Weitzman dans Le Monde et je l’ai trouvée très pertinente, très juste, d’autant plus forte qu’on sent qu’il ne cherche pas à régler des comptes avec Houellebecq, ce qui est souvent le cas des gens qui le critiquent…
On a aussi parlé d’un projet inabouti avec Philippe Muray. Peux-tu nous en raconter davantage ?
Je l’avais lu et on avait fini par se rencontrer. Il m’avait donné rendez-vous au Sélect, il était vraiment très sympathique. Mais le label n’allait pas bien, je venais de sortir le disque avec Houellebecq, je trouvais la musique un peu trop délibérément banale, donc je voulais pas être décourageant ni le faire pour le faire. Ça ne paraissait pas assez différent dans le principe de ce qu’on avait ébauché avec Houellebecq, alors que le label avait vocation a chercher d’autres pistes, quitte à se les faire piquer par d’autres plus tard. C’est un peu notre rôle dans l’écosystème musical.
Avec Tricatel, vous aviez sorti Chambre 1050, l’album d’Ingrid Caven dont la plupart des textes avait été écrit par son mari Jean-Jacques Schuhl. Que représente Schuhl pour toi ?
Je l’ai découvert par Yves Adrien, pour qui la lecture de Rose Poussière a joué un rôle essentiel, notamment par rapport à sa propre écriture. Schuhl a donc certainement fait naître beaucoup de vocations. Les deux mille exemplaires de Rose Poussière ont eu le même destin que les deux mille exemplaires du premier album du Velvet, dont on disait que chaque personne qui l’avait acheté avait ensuite monté un groupe. Il a été comme cela une sorte de passerelle entre la littérature et la musique, l’expérimentation formelle et l’atmosphère propre à l’époque.
Schuhl a été une sorte de passerelle entre la littérature et la musique, l’expérimentation formelle et l’atmosphère propre à l’époque.
On a toujours tendance à se lamenter sur le manque de nerf et d’inventivité du rock français mais le fait est qu’en France, il y a eu des gens qui ont écrit sur le rock, l’ont conceptualisé, l’ont même imaginé avec parfois plus de clairvoyance que les anglo-saxons. Des personnes comme Yves (qui signait certains de ses premiers papiers en 71 Eve Punk Adrien) ou Marc Zermati, le fondateur de l’Open Market dans le quartier des Halles, ont vraiment été les précurseurs du punk bien avant Malcolm Mac Laren, en repartant de trucs garage des années 1960 et en glorifiant les Stooges et le MC5. Ils ont eu un vrai rôle, avec leur côté esthète et, en ce qui concerne Yves, des filiations littéraires très nettes, les références fin-de-siècle, décadentistes, etc.
Et Pacadis dont on a fait un mythe dandy crade et un peu ridicule ?
Je l’ai croisé sans le connaître. Le personnage avait l’air assez foutraque mais je n’en pensais pas encore grand chose. J’ai quelques souvenirs par flashes de concerts et autres, mais pas plus. J’avais le souvenir de son passage à Apostrophes, assez poseur et un peu prétentieux. Cela ne m’avait pas impressionné. Je l’ai d’abord découvert au travers du livre formidable de Marie-Dominique Lelièvre, Gainsbourg sans filtre, qui raconte un entretien entre Pacadis et Gainsbourg, traversant alors un certain passage à vide. Et donc il le titille sur Rock Around the Bunker, en lui demandant si par hasard il n’aurait pas une certaine fascination pour les nazis. Gainsbourg lui répond : « Pas du tout, je les traite de travelos ! ». Et Pacadis le reprend : « C’est bien ce que je disais, tu les idéalises ! ». Voilà, il y avait ce côté provoc’ et en même temps très drôle et très fin.
Ensuite la réédition chez Denoël de ses chroniques dans Libé, qui sont fantastiques et m’ont vraiment marqué. J’avais eu le sentiment que c’était un homme très volatile, alors qu’en fait c’était autre chose. Il avait une manière très libre, sincère et instinctive de parler de la musique, de façon moins cérébrale que celle d’Yves Adrien.
En même temps on peut voir comment au fur et à mesure il se décourage complètement. Vers 85 il réalise une interview avec France Gall et la première question qu’il lui pose, qui dit tout sur l’époque c’est « Qui va te coiffer à Bercy ? »
Et aujourd’hui ?
Ça se poursuit, heureusement. Ce qui m’intéresse dans la chronique, ce n��’est pas tellement le goût de l’auteur, c’est ceux qui essaient de faire abstraction de leurs préjugés et qui laissent filtrer leurs émotions. En revanche, dès qu’on sent que c’est pompé sur la bio, que ça part d’une liste de trois ou quatre bonnes raisons d’aimer, ça ne fonctionne pas ; et j’inclue même des papiers très favorables me concernant qui, pour ces raisons, me laissent complètement de marbre, parce qu’on voit que ce sont des positionnements.
Il y a des gens comme Bertrand Dicale, Nicolas Ungemuth, Jérôme Reijasse ou d’autres, qui font qu’une certaine qualité d’écriture perdure dans Rock & Folk et même dans la plupart des journaux où on trouve en général une ou deux personnes qui se distinguent.
L’essentiel je crois c’est de ne pas tomber dans des considérations de type « est-ce que ça fait bien d’aimer ce genre de choses ? »
Tu as aussi participé au Dictionnaire du rock de Michka Assayas. De quelle manière ?
On avait pensé à un canular. Michka a rédigé une fausse entrée sur un groupe imaginaire que j’avais baptisé les Absorptions, une notice ultra crédible. On enregistre un disque en deux jours avec Larry Mullins et Peter Von Poehl, très psyché, en essayant d’inclure plein de références qui puissent laisser croire que les pauvres Absorptions ont été pillés par plein de gens, pour ouvrir la porte à tout un tas de théories fantasques et conspirationnistes, etc. Ça commençait à prendre forme mais j’ai effacé certains morceaux par erreur et je n’ai pas eu l’énergie de recommencer… Mais je me souviens que lorsque le dico est sorti, Michka a gardé la notice. En plus, l’entrée est vers le début, à la lettre A et certains maniaques s’arrachaient les cheveux en se demandant où ils pouvaient trouver ce disque des Absorptions !
On en a encore peu parlé mais tu sembles très lié au cinéma, affectivement mais aussi esthétiquement, au sens d’une certaine approche de l’image, de ce que le filtre d’un film peut capter des atmosphères, des lieux, des visages…
Je ne suis pas ce qu’on nomme habituellement un cinéphile. Je n’en ai pas la discipline ni les fétichismes. Il y a sept ans on m’avait donné carte blanche pour présenter une douzaine de films sur Ciné Cinéma, c’était un cadeau incroyable. J’ai voulu résister à la tentation de faire étalage de bon goût et j’ai vraiment voulu montrer des films qui étaient en quelque sorte des obsessions qui m’avaient suivi, m’avaient influencé, avaient forgé mon rapport à la vie et que je n’avais pas toujours eu l’opportunité de revoir.
Il y avait d’abord eu un film tchèque, L’Automate des désirs de Josef Pinkava, que j’avais vu à cinq ans. Une histoire étrange dans un parc d’attraction à Brno, avec une machine qui exauce les désirs et des enfants qui montent dans une fusée, avec plein d’allusions masquées à ce qui se passe à l’époque en Tchécoslovaquie. J’avais passé des années à retrouver ce film, je voulais le ressortir, j’étais allé voir l’ambassadeur de la République Tchèque, les gens de Ciné Cinéma ont remué la terre entière pour mettre la main sur une copie !
Il y avait, dans le désordre : le sketch de Fellini pour les Histoires Extraordinaires, Le Fanfaron de Risi, un court-métrage étrange de Resnais sur le plastique, L’Acrobate de Jean-Daniel Pollet, dans le cadre duquel on avait réalisé un entretien avec Antoine Duhamel et aussi Blue Collar, le premier film de Paul Schrader, qui se déroule dans les usines automobile à Détroit. Fantasmes, de Stanley Donen, avec Peter Cook et Dudley Moore, Sweet Charity… J’aurais aimé inclure aussi Radio On de Chris Petit, produit par Wenders en 1979, film new wave dans l’Angleterre industrielle, vraiment un très beau road movie sous influence Kraftwerk.
J’avais aussi choisi Marianne de ma jeunesse que j’avais vu quand j’avais 12 ans, un film très onirique, dans une veine qu’on voit finalement assez rarement au cinéma. Les Coeurs Verts, d’Edouard Luntz. Et puis Continental Circus, un documentaire somptueux de Laperrousaz. Mais nous n’avions pas pu les diffuser. Je voulais aussi La première nuit, un court métrage de Franju, mais ce n’était pas possible non plus. Finalement, on a opté pour Les yeux sans visage.
Si tu mélanges un peu tous ces films, j’imagine que ça cerne un peu mes références…
Es-tu particulièrement attaché à certains réalisateurs ?
Pas vraiment, je ne crois pas. Mais par exemple je trouve que quelqu’un comme Lelouch est traité de manière très injuste et qu’il finira par être reconsidéré. Je pense qu’il va lui arriver la même chose qu’à Sautet, qu’on a longtemps méprisé et présenté à tort comme une sorte de cinéaste giscardien, ceci dit, même si ça avait été juste ça ne serait pas si mal. J’aime énormément Louis Malle aussi, parce que, comme John Boorman, il a toujours fait des films assez différents les uns des autres.
Il y a aussi des gens pour lesquels j’ai une affection plus personnelle. Je pense à Gérard Blain ou aux premiers films d’Alain Cavalier notamment, qui incarnaient un cinéma politique intelligent, un regard libre et intense sur la société. Aujourd’hui je ne trouve ça que dans certains films italiens comme Mon frère est fils unique ou même Romanzo Criminale.
Tout ça, on le retrouve en un sens dans l’attention que porte Tricatel à ses illustrations visuelles…
La difficulté pour les vidéos c’est de résister à la tentation de s’enfermer dans une pâle copie du cinéma. Je pense que le clip de Thriller a de ce point de vu fait beaucoup de mal à la vidéo musicale parce qu’après cela, on a eu le pire des deux mondes : des clips tournés comme des pubs et des gimmicks calqués sur le cinéma dans ce qu’il peut avoir de plus stéréotypé. Pour moi, la référence c’était la vidéo d’Ashes to ashes de Bowie qui essayait d’inventer quelque chose et ne se la jouait pas comme si c’était du cinéma.
De la même manière, quand on fait le Ben & Bertie Show pour Paris Première avec Benoît Forgeard, on n’essaie pas de copier le cinéma, mais au contraire d’utiliser le format propre à la télévision pour parvenir à un résultat inédit. D’ailleurs Benoît considère vraiment l’écran comme une toile, dans sa façon de composer ses images.

Dans le Ben & Bertie Show comme dans ta musique, tu sembles t’amuser à multiplier les clins d’œil pop, les collages hasardeux. Ce qui fait qu’on a parfois tendance à t’identifier à ce goût du vintage…
Non, je ne cultive pas le kitsch et le second degré, simplement je ne me pose pas la question de savoir si tel ou tel élément est ringard ou pas. J’essaie de tout mettre sur la table, à la fois par honnêteté et pour m’en délivrer. Ce que je reproche surtout à l’époque actuelle, c’est d’être passéiste et en même temps de cacher ses influences. Le criminel de guerre à ce niveau c’est Tim Burton, qui pour Charlie et la chocolaterie refait la même chose que la version de 1967 mais en laid, tout en faisant comme si elle n’avait jamais existé !
Propos recueillis par Olivier François et Guillaume Pinaut