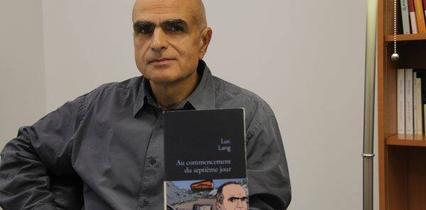La 8ème édition du Festival Livres en Tête aura lieu du 21 au 27 novembre 2016. Zone Critique a sauté sur l’occasion pour publier des entretiens avec les auteurs invités pour l’évènement ! Aujourd’hui Elitza Gueorguieva revient sur son premier roman Les cosmonautes ne font que passer publié aux Editions Verticales. Un roman presque autobiographique à la deuxième personne qui raconte avec recul et autodérision le quotidien d’une petite fille bulgare au moment de la transition démocratique.

A la chute du mur de Berlin et donc à la chute du régime communiste en Bulgarie, tous ses rêves sont bousculés par de nouvelles valeurs qui arrivent d’un nouveau monde qui a d’autres héros et d’autres réalités. Cette petite fille va devoir s’adapter, changer de missions et trouver sa place dans ce nouveau monde.
Quelles missions choisit-elle alors ?
Après la chute du mur, sa nouvelle mission sera de devenir punk ou chanteuse grunge comme Kurt Cobain qui est sa nouvelle idole. Elle va donc élaborer plusieurs stratégies. Elle va déjà s’acquérir un look très effrayant et elle va ensuite se mettre à chanter… A travers ces différentes missions on comprend ce qu’il s’est passé en Bulgarie dans les années 1990. C’est un roman qui commence en 1988 juste avant la chute du régime et qui se termine en 1997, ce qui correspond à peu près à la fin de la transition démocratique qui, en Bulgarie, a duré très longtemps. A travers l’histoire de la petite fille apparaît la grande Histoire et les changements politiques qui ont eu lieu en Bulgarie.
Pourquoi avoir choisi de fragmenter le roman en courts épisodes ?
J’aimais bien l’idée des petits épisodes. C’est un peu l’image de la mosaïque que l’on retrouve dès le début du roman. On est face à une image, on voit plein de petits cailloux qui en eux-même ne racontent rien et quand on s’éloigne on les voit tous ensemble. L’image prend alors forme. C’était le but de cette écriture qui se constituait par fragments.
Vous attendez donc du lecteur qu’il puisse prendre du recul sur la situation ? Qu’en liant ces courts épisodes il puisse se faire une idée du quotidien en Bulgarie à cette époque ?
A la fin du roman, l’image de la mosaïque revient. Cette idée crée une boucle et c’est l’occasion de revoir ce paysage qui s’est construit qui s’est déconstruit. Ça permettra, peut-être, j’espère, de revoir toute l’histoire et d’analyser à nouveau.
Qui est la narratrice ? Pourquoi avoir choisi la deuxième personne du singulier ? Est-ce une forme de journal intime ?
Dès le début j’avais envie d’écrire à la deuxième personne du singulier. Je pense que ça a été inspiré par plusieurs auteurs que j’aime beaucoup mais également par le fait que mon père écrivait pour moi un « journal intime ». Quand je ne savais pas écrire, de mes trois ans à mes dix ans environ, il notait les petites histoires que je vivais et les petites questions que je posais qui le faisaient rire. Ce journal était mené à la deuxième personne. Il s’adressait à moi. Je ne l’ai pas beaucoup consulté, car c’est un peu déstabilisant de lire des choses sur notre enfance puisqu’on a l’impression que ce n’est pas nous, que c’est une autre petite fille. J’aimais bien ce principe et c’est un peu la question de l’autofiction. Ce n’est pas seulement autobiographique puisqu’il y a plein de choses qui sont inventées mais il y a quand même, bien sûr, beaucoup de choses de moi dedans. C’était en fait un mélange entre « moi » et « elle » et ça a donné « tu ».
La première partie est écrite du point de vue d’une petite fille et dans la deuxième partie c’est une adolescente qui raconte son quotidien. La petite fille et l’adolescente ont-elles une manière différente d’appréhender les évènements ?
J’ai beaucoup travaillé sur l’évolution de la langue lorsque la petite fille grandit. Il y a une différence dans la manière de s’exprimer puisque dans la première partie elle a 6 ou 7 ans et il y a une ellipse et dans la deuxième partie elle en a 13 ou 14. J’ai voulu garder cette forme d’humour, cette autodérision et cette dérision de manière générale sur ce qu’il se passe autour mais j’ai essayé d’amener quelque chose de plus grave. Le ton change un peu, il y a un peu plus d’effet poétique, et de mélancolie aussi, tout en gardant le mélange entre burlesque et sérieux et entre drôle et triste. Dans la deuxième partie on ressent plus de charge émotionnelle.
Et pourtant les deux narratrices fonctionnent par raisonnement logique. Elles définissent une mission et savent ce qu’il faut mettre en œuvre pour y arriver sans se laisser distraire par des problèmes que rencontrent habituellement enfants et adolescents.
Quand je parle de charge émotionnelle c’est parce que pour moi l’histoire de la Bulgarie est assez triste. On est face à un désenchantement de toutes les grandes idées qu’on a pu avoir, d’une part le communisme mais également la démocratie qui va mettre du temps à s’installer. Je voulais quelque chose de triste mais ce n’est pas pour autant mélodramatique. J’évite en général le mélodramatique, j’aime bien avoir du recul et avoir de l’humour même dans les situations tristes. Je pense que l’humour est une manière de survivre. Dans le roman, l’humour était une volonté de traduire un état d’esprit qu’il y a en Bulgarie. Les bulgares ont beaucoup de sens de l’humour même si on les trouve souvent un peu sournois ou un peu trop sérieux. Chez eux cet humour est quelque chose qui n’est pas de l’ordre de la littérature mais qui appartient à leur vie de tous les jours. On a un rapport à l’autodérision assez fort, on se moque beaucoup de notre pays parce qu’on ne peut rien faire d’autre ! Quand on vit dans un petit pays qui n’a pas de bol, forcément, on rigole sinon on ne peut pas survivre. C’est pour ça que même dans les moments un peu difficiles dans le roman, l’humour, et les procédés comiques, restent les mêmes. Dans la deuxième partie j’ai simplement ajouté un peu plus d’émotion.
J’évite en général le mélodramatique, j’aime bien avoir du recul et avoir de l’humour même dans les situations tristes
Concernant les changements de l’expression, dans la première partie, la petite fille est un petit soldat qui a beaucoup de recul sur les évènements et qui ne se laisse pas déstabiliser. Elle est presque trop obsessionnelle et psychorigide avec ses listes et ses missions. Sa manière de s’exprimer n’est d’ailleurs pas du tout enfantine. Quand on lit le roman on est face à une personne qui pourrait être à l’université puisqu’elle utilise des mots comme « toutefois, il serait préférable que »… Et ce langage est finalement assez lourd, il n’est pas du tout adapté à une petite fille. Dans la deuxième partie, j’avais envie d’abandonner un peu cet aspect et d’amener quelque chose de plus fluide, de plus littéraire et de plus poétique. Il y a donc un petit changement de langage. Et moi-même, en tant qu’étrangère, comme c’est mon premier roman en français et mon premier roman tout court, j’ai rendu mon écriture fluide au fil des pages même si au départ j’aimais bien l’aspect brut et maladroit. J’ai cependant commencé à comprendre que certaines structures étaient trop bulgares et cela pouvait être étrange et drôle mais également un peu lourd donc je me suis demandé ce que je pouvais garder de mes traces de langue maternelle et ce que je devais adapter pour que ce soit plus fluide et plus musical.
Pourquoi avoir choisi d’écrire ce roman en français ?
Je vis en France depuis quinze ans. C’est ici que j’ai commencé à penser à cette histoire. J’avais envie de raconter à mes amis ce que j’ai pu vivre en Bulgarie, d’autant que lorsqu’ils me racontaient leur adolescence, je me rendais compte de la différence des contextes dans lesquels nous avions grandi. On s’est construit dans des conditions très différentes. Pour leur raconter cette histoire j’ai spontanément décidé d’écrire en français. Il faut aussi, quand on écrit, être en lien avec la langue de tous les jours. C’est compliqué de se déconnecter. Quand je suis en France je vis en français, je pense en français et c’est ma langue vivante, celle de tous les jours. Il y a par exemple un chapitre qui s’appelle « Ta mère la patrie », c’est un idiome communiste que l’on entend dans beaucoup de discours mais quand on le dit en français ça peut résonner comme une insulte ou comme quelque chose d’argotique, ça peut faire entendre un langage de rue. Je n’aurais pas pu le faire en bulgare, tout comme d’autres jeux de mots comme celui avec « spatial » et « spécial ».
Que symbolisent la France, avec la figure de Sylvie Vartan, et la Grèce, avec la figure de Constanza dans le roman ?
L’étranger n’est pas du tout présent dans la vie des bulgares avant 1989. L’étranger est quelque chose que l’on imagine, que l’on rêve ou qui est interdit mais c’est quelque chose qui est en dehors de nous puisqu’on ne peut pas y aller. Puis, durant les années 1990, il y a en Bulgarie un grand rêve occidental, pas seulement américain, que les bulgares partagent. La norme de société qu’ils s’imaginent est la norme occidentale. Ils veulent être comme les américains mais ils veulent être aussi européens. Le rêve de l’Europe est très présent. La Grèce, les Etats-Unis, la France -avec le personnage de Sylvie Vartan- … sont des manières de signaler cet occident dans l’imaginaire bulgare.

J’aime beaucoup les performances textuelles. La première version de ce texte existait dans une performance que j’avais créée il y a longtemps, en 2011 ou 2012. Je racontais la première fois que j’avais vu mes parents s’embrasser, au moment de la chute du mur. Je racontais cette histoire pour un public, c’est donc d’abord un texte qui a existé dans son oralité. J’aime beaucoup penser le texte dans une logique de mise en espace, je l’imagine en dehors du livre, et comment il pourrait être dit à haute voix. C’est important pour moi car aujourd’hui la littérature n’est pas simplement dans une librairie, elle n’est pas cantonnée au livre. Elle est présente à différents moments, sur scène par exemple, mais aussi sous différentes formes. Ma première formation c’est le cinéma. Je suis d’abord cinéaste et je suis en train de terminer mon premier documentaire. Dans ce long métrage, il y a aussi une forme de littérature et d’ailleurs certaines phrases du roman se retrouvent dans le film, même si ce n’est pas la même histoire qui est racontée. J’aime donc beaucoup réécrire et penser le texte sous différentes formes.
Est-ce que le choix d’une narratrice très jeune était une contrainte pour le rythme du livre ?
Le langage dans la première partie était un peu à l’opposé du langage d’une petite fille. Les phrases sont longues et d’ailleurs au début je voulais écrire le roman avec de très longues phrases. Ça me faisait penser à ma façon de parler car j’ai toujours envie de raconter plein de choses dans la même phrase. Puis, je me suis rendue compte qu’au niveau du rythme ça ne fonctionnait pas, j’ai ressenti le besoin de couper court et d’insérer des phrases très courtes pour dynamiser le texte.
Pensez-vous que l’auteur soit la personne la plus adaptée pour lire son propre texte ?
J’aime beaucoup écouter des auteurs lire leurs textes s’ils sont de bons lecteurs. Cela peut parfois être un piège. Souvent je choisis de lire mon texte, j’aime beaucoup l’espace que prend le lecteur, qui n’est pas comédien, qui est entre les deux. Parfois j’aime bien l’aspect direct que l’on peut ressentir quand on est face à un auteur qui lit son propre texte.
Propos recueillis par Solène Reynier et Paula Prats pour Les Livreurs
- Les cosmonautes ne font que passer, Elitza Gueorguieva, Verticales, 184 pages, 16 euros 50, août 2016
- Programme Livres en Tête 2016 : http://www.leslivreurs.com/PgmLET2016.pdf