Zone Critique est allé à la rencontre de Benjamin Legrand, auteur de bande dessinée comme l’excellentTransperceneige, de polars haletants à l’image duCul des anges, et bien sûr, de science-fiction avecLa face perdue de la Lune. A travers une réflexion sur le genre, il nous offre quelques anecdotes sur son riche parcours. L’homme de toutes les lettres nous invite dans son univers.
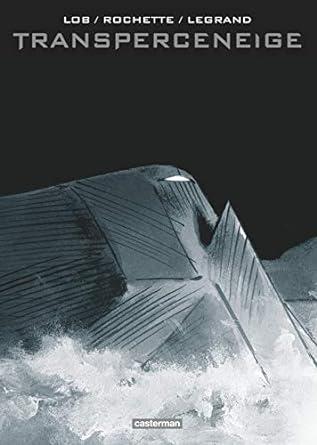
Zone Critique : Vous semblez avoir fait une entrée fracassante en littérature …
Benjamin Legrand : C’est plutôt votre entrée en matière, qui est assez fracassante, effectivement. On est direct dans la zone critique ! Non, je plaisante… En fait, c’est très bizarre la façon dont on devient écrivain. J’ai toujours écrit, même lorsque j’étais enfant. Ma mère m’a appris à lire à quatre ans. J’adorais, lire, écrire, dessiner et faire de la pâte à modeler. On faisait ça avec mon petit frère. On n’avait pas trop de jouets à l’époque. Et puis plus tard, on est passé de la pâte à modeler au rock and roll, à l’underground et aux années de folies ! Mais avant ça, je suis parti aux Etats-Unis quand j’avais 16 ans. Mon grand frère m’a embarqué parce que je déprimais terriblement (on était en 66) et je suis passé directement d’un monde en noir et blanc à un monde en couleur.
Ensuite, je suis rentré en France en février 68, parce que sinon je savais que j’allais jamais avoir mon bac ! Ça faisait deux ans que je ne foutais pas grand-chose au Lycée Français de Los Angeles, (J’étais le seul élève en terminale !) du coup je suis revenu à Paris, et heureusement ! Sinon j’aurais loupé mai 68, et tout l’après mai 68 surtout. Parce que l’agitation politique, elle, a continué pendant plusieurs années. C’était l’ultra-gauchisme, les bagarres contre des groupes d’extrême droite dans les facs, les manifs, les concerts. Il se passait des trucs en permanence. Avec des copains, on faisait des films underground, de la musique archi underground, (rire) on avait même un canard qui s’appelait Le Parapluie. Sexe, drogue, révolution : le tout, 3 francs ! Mais je vais pas vous raconter ça ma guerre plus que ça. Les anciens combattants, ça me fait chier. Du coup, j’ai longtemps hésité. Je voulais faire du cinéma quand j’étais jeune… D’ailleurs, j’ai commencé par être assistant réalisateur. Je voulais faire un film, après. Et puis la vie est arrivée. A 21 ans, je suis devenu papa. Il fallait travailler pour manger, et là je me suis aperçu que chercher à faire un film et travailler, c’est pas tout à fait la même chose. Orson Welles a d’ailleurs dit un jour dans une interview : « j’ai passé 98% du temps de ma vie à faire la pute et 2% à mettre en scène mes films ». Tu perds un temps fou avant de trouver de l’argent pour faire un film. C’est la croix et la bannière si tu n’as pas déjà fait un énorme carton avant. Alors que quand tu veux écrire, tu as un papier, un crayon ou une machine à écrire, donc ça ne coûtait pas grand-chose…
ZC : Et finalement, c’est au détour d’un séjour rocambolesque dans le Bronx que l’écrivain est né…
BL : Je suis en effet allé dans le Bronx pour écrire un film, une sorte de fiction-reportage dont j’étais le scénariste. Pendant que le réalisateur projetait ses films au gratin intello de Manhattan, avec l’assistant américain et l’assistant français, on avait commencé le boulot. Et puis il est parti à Paris chercher l’argent de l’avance sur recette…Là, on s’est dit qu’on allait lui faire son scénario avant son retour ! Et, on a suivi Indio partout : C’était notre contact dans le South Bronx, un ancien président de gang (The Seven Immortals), devenu récemment travailleur social. On a plongé dans sa vie et celle des autres gangs, le coin du block, les rites d’initiation, les bagarres, la dope, les vols de bagnole, les morts et tout le bordel. Et puis on avait interviewé des flics, des pompiers, des travailleurs sociaux, des psychiatres, des gens normaux, la famille d’Indio, ses petits frères, ses enfants, sa femme… Je me souviens avoir visité le plus grand hôpital psychiatrique de New York, au milieu du Bronx, d’avoir assisté à des séances de Family Therapy dignes des meilleurs épisodes de The Wire… bien avant l’heure ! On se « promenait » dans le South Bronx avec notre Chevrolet Impala 67 jaune citron pourrie qui ne démarrait pas souvent, et surtout pas quand il fallait ! On explorait l’endroit, sous toutes ses coutures, moi toujours la clope au bec. Parce que je fumais trois paquets par jour à l’époque. On voulait vraiment faire quelque chose de bien, de vrai. Alors la journée on partait à l’aventure, j’avais une petite caméra Super 8, très discrète, (avec des bobines de 3 minutes !) et la nuit j’écrivais. On ne dormait quasiment pas. Les assistants et moi, on ne jurait que par les lignes à écrire pour faire le meilleur scénario possible ! Et surtout pour ces gens qui comptaient sur nous et sur ce projet ! En plus, j’avais l’impression que ce phénomène de destruction des banlieues par une violence programmée allait faire tache d’huile… Et le film ne s’est pas fait. Le réalisateur a piqué une crise énorme en revenant de France, avec l’argent de l’avance sur recettes (il nous avait laissé tous seuls pendant un mois sans un rond à New York ! Heureusement qu’on avait des copains et des copines à Manhattan, sinon je ne sais pas comment on aurait mangé !) : alors qu’on lui livrait un scénario et une organisation de tournage clé en main, que tout était prêts, et que tout le South Bronx attendait ce film, il nous a accusés de vouloir lui voler son film, alors qu’on avait fait tout ça pour lui. Il nous a virés ! J’ai toujours le scénario… ça s’appelait « Nobody’s Children… ». J’ai fini par rentrer en France. Et j’ai ramené plein de trucs avec moi, des films Super 8, des disques de salsa. Personne n’écoutait de salsa à l’époque ! Ils étaient à peine arrivés au reggae, grâce à Clapton !… Alors la salsa… Les rockers se demandaient ce que c’était que ces musiques pleines de trompettes ! Et j’avais plein d’histoires à raconter. Et puis un jour on m’a dit : « Pourquoi tu n’écris pas un document de la semaine pour le Nouvel Obs, avec tout ce que tu as rapporté, tes notes, tes souvenirs, le scénario ! » Un très long article est paru. C’était génial. Et là on m’a dit : on en veut plus ! Pourquoi tu ferais pas un livre ? »
Et voilà, c’est comme ça que tu commences à écrire. Enfin, j’ai mis deux ans à trouver un éditeur. Personne ne voulait prendre le risque d’éditer un mec qui parlait de gangs, de cités si ravagées qu’on aurait cru Beyrouth, de dope et de dealers ! Ils ne savaient pas ce que c’était à l’époque un dealer, ni comment ça s’écrivait, le mot n’était pas encore passé dans le langage français ! D’ailleurs dans le Bronx, je l’utilise entre guillemets ! On écrit ça « dealeur » maintenant ! J’ai peut-être un peu contribué à l’existence du mot, c’est marrant… Quand j’ai trouvé enfin un éditeur, (qui ne croyait pas, comme beaucoup, que j’allais partir avec ma maigre avance et rester aux Etats Unis !) je suis retourné à New-York et là j’ai carrément habité six mois dans le nord du South Bronx, chez Indio, pour retraverser ces rues avec lui et sa famille. Et écrire mon premier livre. En revenant, je travaillais à Charlie Mensuel, je traduisais les BD américaines et anglo-saxonnes grâce à Dominique Grange qui m’avait coopté dans des circonstances tragiques. Et je peaufinais mon manuscrit en faisant chier tout le monde avec mon Bronx ! C’était la grande époque Choron, Reiser, Cavana, Wolinski, Cabu etc etc…Et au hasard des jours, j’ai rencontré Tardi. Qui a bien voulu faire la couverture de mon bouquin. Le premier livre, c’est fascinant : on se retrouve soudain avec une pile de livres identiques dans les bras. Je courais dans la rue avec pour les montrer à mes potes ! Les critiques étaient super bonnes, ça se vendait comme des petits pains, et vlan, l’éditeur a fait faillite ! C’est un milieu très dur, l’édition… Heureusement, le bouquin a été réédité ensuite, mais ils ont changé la couverture. A la place du dessin de Tardi, ils ont mis une photo de mon pote Indio. Alors qu’ils le rééditaient parce que je venais d’écrire ma première BD pour Tardi ! Le Tueur de Cafards, ça s’appelait. Et ça se passait dans le Bronx ! Ensuite j’ai fait un livre sur le métro parisien parce que j’avais un ami Hell’s Angel qui s’était jeté dessous un matin de novembre, pendant que j’écrivais le Bronx à New-York. Un beau livre avec des photos d’un copain qui bossait à Libé. Un peu plus tard, j’ai aussi sorti un petit polar, qui s’appelait Histoire d’un dealer.
ZC : Dans le titre même de ce polar on retrouve une référence à votre séjour dans le Bronx. Vous semblez accorder beaucoup d’importance aux lieux dans vos œuvres…
BL : C’est vrai que je m’attache beaucoup aux personnages et aux lieux. Mon rapport avec l’Amérique est très visible dans mes livres. Mais c’est normal. Quand je retourne en Amérique, j’ai l’impression de rentrer à la maison. Après 66/68, j’y étais retourné en 70, avec une caméra 16mm qui marchait à clé prêtée par mon grand frère. J’avais sillonné la côte Ouest du haut en bas, filmé des tas de communautés différentes, les grandes manifs pour la paix à San Francisco… Ces films ont brûlé dans un incendie quelques années plus tard, dommage… Ce sont des périodes de ma vie qui m’ont marqué, parce que j’y suis beaucoup allé, j’y ai vécu… plutôt intensément ! Mais ce n’est pas le seul pays qui m’a marqué. Je pense bizarrement à la Suisse. J’y avais fait un long séjour. Ça avait été un grand bol d’air face à la grisaille du Paris de 1965, lorsque j’avais 15 ans… Et à l’Afrique où j’avais écrit encore un reportage fiction en Guinée Bissau dans les années 80… Et l’Australie, dans les années 90 pour écrire une série TV pour la jeunesse… Et puis en Corée récemment… Et puis pour écrire, j’aime bien partir, alors ça joue peut-être un peu sur ce rapport aux lieux. Le voyage me fait penser autrement. Pour moi, la géographie façonne pas mal l’histoire… Et aide vraiment à écrire une histoire. Je me souviens d’une fois où j’emmenais ma fille à la danse, à Cannes, il y a quelques années. J’avais deux heures et demie à attendre ensuite. Et qu’est-ce que tu fais dans ces cas là quand t’es écrivain ? J’ai pris un carnet, je me suis mis à une terrasse de café et j’ai écrit. C’était le début du Cul des anges.
ZC : Au-delà d’un fort attachement aux lieux, vous exprimez, à travers vos œuvres, un regard sur le monde, qui est souvent sombre, pessimiste, alarmiste…
BL : J’ai juste toujours lu le journal, écouté la radio, regardé les chaînes d’info et internet. Je m’informe et je m’intéresse à la science, à la planète, à la politique, aux faits divers, à la vie des gens, et bien sûr, ce que je vois, je le retrace dans mes livres. Si tout ça avait eu lieu autrement, le monde aurait été différent. C’est comme le jour où on a choisi le nucléaire plutôt que le solaire. Ce sont des choix de société. Le problème c’est que ce sont des cons qui font le choix. Et c’est comme ça que l’on arrive à aujourd’hui. Une succession de mauvais choix. Nous sommes dans une civilisation fondée sur le profit et l’exploitation des autres, et qui asphyxie la planète… c’est invivable. On est en train d’en avoir la preuve de plus en plus vite et ça fait de plus en plus mal.
J’essaie de changer les choses en écrivant des histoires. Sans être didactique, je place des alarmes.
J’ai toujours été angoissé par le sort de notre misérable condition de petits humains. Je suis très anxieux quand je vois ce que le monde devient. Et ça, j’essaie de le sortir dans mes livres. Par petites touches. J’ai toujours été pessimiste. À New York, mes copains et mes copines m’appelaient Monsieur Négatif ! Faut dire que les Américains n’apprécient pas trop le sens critique des français ! Mais vous connaissez la différence entre un pessimiste et un optimiste selon Zinoviev, non ? Le pessimiste c’est quelqu’un qui dit que ça ne peut pas être pire, l’optimiste c’est celui qui répond : « si ! » J’essaie de changer les choses en écrivant des histoires. Je veux qu’elles fassent penser les gens à autre chose, même s’il n’y a pas toujours un petit morceau de message caché dedans, jamais didactique, il y a des alarmes.
ZC : En parlant d’écrire des histoires, vous êtes un auteur caméléon, vous vous promenez entre les genres. Vous avez toujours voulu tout faire ?
BL : Vous savez, il y a même eu un moment où je voulais être chanteur de rock ou acteur ! Mais ce sont les hasards qui m’ont poussé là où je suis. J’ai toujours rêvé de faire un film, et je ne l’ai toujours pas fait ! C’est vrai que c’est un peu difficile de me présenter, j’ai fait tellement de choses différentes. Et les gens, j’ai l’impression qu’ils n’aiment pas trop ça. Ils ne peuvent pas me ranger dans une case, j’ai les pieds dans plusieurs tiroirs et ça les perturbe ! Le hasard a fait que je me suis retrouvé avec plusieurs carrières, et tout ça se chevauche. Quand je ne suis pas en train de faire une traduction, je suis en train d’écrire un scénario. Sinon je travaille sur un roman ou une bande-dessinée. Mais je ne jongle pas entre les projets. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond. On peut manier les genres tout en s’y investissant tout autant ! Et puis, mes thèmes, mis à part la traduction, restent assez ciblés. Je suis toujours un peu dans le polar ou la science-fiction. Peut-être qu’un jour j’essaierai d’écrire complètement autre chose, pour voir ce que ça fait. Pourquoi pas un roman historique ? Je ne sais pas…
ZC : Vous maniez déjà la double casquette de scénariste, entre le cinéma et la bande-dessinée. Quel lien faites-vous entre la bande-dessinée et la littérature ?
BL: Les gens de la « littérature » avec un grand L ont un peu tendance à prendre la BD pour un truc de charlots, comme si ce n’était pas sérieux, alors qu’elle demande un énorme travail littéraire. Par exemple, quand j’ai écrit Requiem Blanc, c’était un vrai travail. Cette ambiance de fin de règne, de bord de lac, un peu sinistre. La BD, c’est très ouvert. On peut y mettre de la poésie, de l’humour… C’est comme dans la littérature, il y a plein de BD différentes, je ne vois pas comment on peut juger. Je ne suis pas sectaire. Mais il faut quand même dire que j’ai plus de copains dans la BD que dans la littérature. Sauf dans le polar. Mes vrais amis, ce sont plus des dessinateurs et des scénaristes. Ce sont Tardi, Druillet, Bilal, mais je ne vais pas les citer tous… La BD, quand elle associe un scénariste et un dessinateur c’est un peu comme faire un film à deux ! Et la figuration et les effets spéciaux ne coûtent que quelques traits de crayon de plus ! J’ai aussi fait beaucoup d’animation, qui est un peu le pont entre la BD et le Cinéma… Ce sont des dessins animés ! D’ailleurs avec Druillet, quand on faisait nos séries de science-fiction et qu’on s’éclatait, on aimait bien se dire en rigolant : « Créateur d’univers, quel beau métier » ! Bon, je m’égare un peu… Contrairement à un roman, dans une BD, on donne un visage aux personnages, on les impose au lecteur. J’ai remarqué aussi que quand il y a des images sans textes, le lecteur feuillette et va très vite. Il ne s’attarde pas. Il regarde juste le page dans son ensemble. Alors que quand il y a des choses écrites, on est obligé de les lire, et du même coup on passe beaucoup plus de temps sur l’image aussi. Mais c’est plus facile d’écrire une histoire que de la dessiner ! Ce qui est compliqué dans la BD par rapport au cinéma, c’est qu’il faut compenser l’absence de son, et notamment de musique. Et ça, c’est un des rôles du texte. Juste avec des mots, il faut compléter l’ensemble, alors parfois un peu de poésie, ça ne fait pas de mal. Je crois que mon petit quotient de poésie me vient de Bradbury et de Simak. Je les dévorais lorsque j’avais douze ans, et c’est une écriture très poétique. J’étais déjà à l’époque un fan absolu de science-fiction !
ZC : Vous n’êtes toutefois pas qu’un fan de science-fiction, mais aussi un auteur ! Si vous nous parliez un peu de l’écrivain…
BL : La partie science-fiction ne se retrouve pas que dans mes romans. Le Requiem blanc, Le Tribut, Le Transperceneige et Délirius 2 sont toutes des BDs de Science-fiction. Mais le roman, ce n’est pas comme la BD ou un film ou une série TV. L’écriture de roman est une expérience profondément solitaire. Comme la peinture. Tu es seul, tu parles à ton chat, et je crois que ça rend un peu fou ! Dans le roman, le plus important ce sont – of course – les personnages. Ce que j’aime, c’est attendre le moment où ce sont eux qui vont écrire à ma place. Car à un moment, quand ton histoire avance, tout-à-coup, les personnages eux-mêmes se mettent à jouer devant toi, à vivre par eux-mêmes. C’est ce qui me fascine dans l’écriture, c’est ce moment-là que je cherche. Et puis chaque genre permet une expression particulière. Dans la science-fiction, on pourrait voir un côté complètement décalé, un univers à créer. Mais parler d’un monde imaginaire, c’est quand même toujours parler du nôtre. Quand on parle du futur, on parle du présent. Et personne ne fait gaffe !
Le polar est une manière directe d’évoquer le présent, c’est une critique sociale
C’est dommage qu’aujourd’hui il y ait moins de SF qu’à une époque. C’est trop peu considéré, alors que les mecs, ce sont des génies ! C’est quand même Jules Verne qui a inventé le sous-marin ! La SF, c’est tous des visionnaires ! Même quand je vois Requiem Blanc… J’ai écrit ça il y a plus de trente ans, et je m’aperçois maintenant que l’histoire se passe dans 10 ans et qu’il y a des occurrences incroyables ! Ce vieillissement de l’Europe, ce virus qui tue… Et à la fin, le mec il a un iPhone à la main, alors qu’à l’époque on n’avait même pas inventé le téléphone sans fil ! Alors que le polar c’est différent. C’est une manière directe d’évoquer le présent. Le polar, c’est une critique sociale.
ZC : Vous maîtrisez parfaitement les codes de plusieurs genres littéraires, mais aussi le travail d’adaptation. Comment se passe la transformation d’une œuvre dans un nouveau genre ? Par exemple, Le cul des anges pourrait-il devenir un film ?
BL : C’est drôle que vous en parliez, car j’ai effectivement écris le scénario du Cul des anges. Je ne sais pas si le film se fera, mais le scénario est prêt et un jeune producteur que j’aime bien se démène pour le monter… Ce qui est amusant dans l’auto-adaptation, c’est que tu refais ton roman, mais autrement.
Les personnages sont comme des fantômes portant leur propre histoire.
Quand tu transformes un texte en scénario, ce qui ne change pas tellement, ce sont les dialogues. Et en général, il y a beaucoup de dialogues dans ce que j’écris. Le moment difficile par contre, c’est quand il s’agit de retranscrire ce qu’il se passe dans la tête des personnages. Leurs pensées. Parce que ça, dans le texte, tu peux y avoir accès. Sur l’image, non. Sauf en utilisant une voix off, mais bon… L’adaptation est difficile car tu es obligé de faire des choix, de raccourcir, de changer des choses ou même d’enlever carrément des personnages. De suggérer par l’image et pas par le texte. Mais ce qui est important, c’est de garder la même trame, les mêmes enjeux, la même émotion, de ne pas trop dénaturer le texte. Il faut garder l’esprit du récit antérieur et des personnages. Car ils existent, comme des fantômes portant leur propre histoire…
ZC : Pour finir, un petit conseil de lecture pour nos lecteurs ?
BL: Je vous conseille les deux BDs de Tardi Stalag 2B. Je viens de lire le tome 2, et c’est bien écrit , très bien écrit, avec des dessins à se flinguer !
Propos recueillis par Pierre Poligone et Ninon Legrand.
Bibliographie indicative
– Bande-dessinées
- Requiem Blanc,Legrand et Rochette, Casterman, 2014, 104 pages, 20 euros.
- Le Transperceneige, Legrand, Lob et Rochette, Casterman, 2013, 256 pages, 35 euros.
- Tueur de cafard, Legrand, Tardi, Casterman, 1984.
- Le Tribut, Legrand et Rochette, Casterman, 1996, 14 euros 95.
- Lone Sloane 2 delirius,Legrand, Lob, Druillet, drugstore, 2012, 18 euros.
– Romans
- Le cul des anges, Legrand, 2010, Seuil, 406 pages, 7 euros 50.
- Un escalier de sable, Legrand, 2012, Seuil, 286 pages, 19 euros 50.
- La face perdue de la lune, Legrand, 2001, Flammarion, 280 pages.
- Le Bronx, Legrand, 1984, Broché, 210 pages.
- Histoire d’un dealer, 1980, Encre.

















