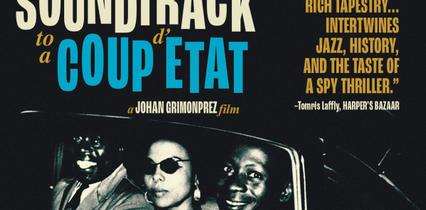Illustration par Julia Reynaud
Le parcours de François Bégaudeau est marqué par la littérature et la politique. L’auteur d’Entre les murs évite toute univocité idéologique et cherche à trouver une forme romanesque à même de dire la complexité du monde social. Son roman En guerre s’attache à penser le conditionnement auquel personne n’échappe, bourgeois ou ouvrier. De même, Histoire de ta bêtise, réinvestit une forme littéraire, celle du pamphlet, pour fustiger l’arrogance morale de la bourgeoisie.
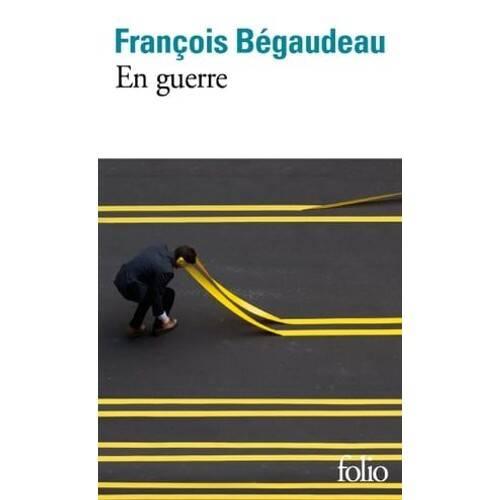
La neutralité est le lieu même de l’art.
Zone Critique : Bonjour François Bégaudeau. Tout d’abord, pourquoi avoir choisi le roman, notamment dans En guerre, pour décrire le quotidien des plus défavorisés ? Qu’est-ce que le roman apporte de plus que l’enquête journalistique ?
François Bégaudeau : C’est une question centrale depuis toujours, mais elle se pose avec plus d’acuité depuis dix ou vingt ans et la domination éditoriale de la non-fiction — y compris pour le meilleur, par exemple les succès d’auteurs comme Éric Vuillard, Patrick Deville, ou encore Emmanuel Carrère depuis qu’il a renoncé à la fiction. Un romancier contemporain ne peut pas s’épargner de se demander : « mais en fait pourquoi passer par la fiction ? Quelle est sa valeur ajoutée quand parfois raconter le réel suffit à faire un livre ? ».
D’abord, la réponse la plus simple et peut-être la moins intéressante, c’est que j’aime bien fictionner. J’aime inventer des personnages, des situations, élaborer des scénarios, etc. Ensuite, dans le cas d’En guerre, j’avais envie d’expérimenter la rencontre entre deux milieux opposés : je pars d’un personnage qui est un ouvrier, pour ensuite faire émerger deux autres personnages, la compagne de l’ouvrier et puis Romain, petit bourgeois qui va devenir son amant. Comment, malgré des conditionnements de classe, un Romain et une Louisa parviennent à se rencontrer ? Il faut bien que j’invente les conditions aléatoires et incertaines d’une rencontre qui n’advient jamais dans la vie : Romain se fait agresser, du coup, sa trajectoire de vie est court-circuitée. Il se retrouve ainsi dans une boîte de nuit dans laquelle il n’aurait pas dû se retrouver, et que Louisa fréquente. Là, la rencontre devient possible : elle est rendue possible par la fiction et sa latitude à tordre l’ordinaire, à bifurquer de la probabilité. Et la fiction inflige aussi à Louisa des faits exceptionnels qui la rendent plus aventurière sentimentalement qu’à l’habitude, et donc disponible à cette rencontre. Ainsi grâce à la fiction l’expérience peut commencer : une relation interclasse, ça donne quoi ?
Z-C. : Vous faites le choix d’une objectivité du narrateur, qui se garde bien d’indiquer au lecteur ce qu’il doit penser. Mais en décrivant avec précision des situations concrètes de l’existence vous faites apparaître l’injustice sociale. Pour vous, cette neutralité du narrateur permet-elle une meilleure efficacité de la dénonciation politique ?
F.B : Il faudrait nuancer ce terme, mais pour moi cette neutralité est le lieu même de l’art. Même si on n’arrive jamais neutre devant l’écriture, il faut éviter que les situations fassent démonstration d’idées préalables. Ce que j’appelais mettre « les compteurs à zéro » à l’époque d’Entre les murs, c’est de systématiquement voir la complexité d’une situation et d’éviter l’univocité idéologique. Pour cela, vous prenez un personnage qui a priori vous serait antipathique sociologiquement ou politiquement dans la vie, et vous essayez de saisir sa machine intérieure. Mon questionnement devant un personnage n’est jamais : est-il bon ou méchant ? Mais toujours : quelle est sa mécanique affective et sociale au sein d’une situation ? Bien que je me sente une certaine fraternité avec Ken Loach, ce qui me tient à l’écart de ses films, c’est que je ne comprends pas pourquoi systématiquement ses « prolos » sont gentils. Je pense que c’est une erreur majeure. D’abord c’est une erreur contre la vérité : ce n’est pas parce que vous souffrez et que vous êtes une victime sociale, que vous êtes quelqu’un de bien. Par exemple mon Cristiano, le mari de Louisa, j’ai plutôt de l’empathie pour lui, mais il est irrégulièrement digne de cette empathie. Il est à la fois con et sublime, immoral et vertueux ; d’une scène à l’autre il est modulable et n’a pas les mêmes affects : il peut très bien être violent avec sa copine et la scène d’après être un compagnon en or. Pour moi, un romancier ou un artiste doit avoir pour religion le réel, la justesse et la complexité. Pour finir et être tout à fait complet, bien sûr que je ne suis pas neutre : je suis particulièrement marqué politiquement et, évidemment, ça se ressent partout dans ce livre qui finit par faire démonstration de quelque chose. Toute l’alchimie est d’arriver à faire en sorte que ce qui est démontré semble se démontrer tout seul : voilà mon absolu artistique, les choses s’animent d‘elles-mêmes et non par l’action d’un grand démiurge politisé et idéologisé. En cinéma, j’aime que le réel parle de lui-même. En littérature il s’agirait plutôt de faire en sorte que les mots parlent d’eux-mêmes, sans qu’on ait l’air de les tordre.
Z-C. : C’est ce qui peut frapper à la lecture d’En guerre : tous vos personnages sont attendrissants, on a envie de croire à la relation entre Romain et Louisa, même s’il est lâche ou hypocrite, et Cristiano lui aussi a ses défauts, etc. La manière avec laquelle vous abordez les personnages fait naître de l’empathie chez le lecteur.
F.B : J’aborde un point important dans Une certaine inquiétude qui retrace ma correspondance avec un chrétien. Même si je suis non croyant, ce que je peux aimer dans le christianisme est sa capacité à ne pas juger. Ce n’est pas vrai dans toutes les branches du christianisme, mais je crois que tout être humain, tout être vivant même, mérite compassion, dans la mesure élémentaire où il est mû par des forces dont il n’a pas le contrôle. Dans En guerre, je fais dire au personnage de Paul Kremer, le grand patron bourgeois, qu’il est victime de sa propriété, un poids, une responsabilité testamentaire ingérable psychologiquement. Alors que si on le regarde uniquement de l’extérieur, comme patron, il ne mériterait que l’anathème, parce qu’il pérennise des injustices et bricole dans des business assez toxiques.
NOUS SOMMES DES ÊTRES PARLÉS PAR NOTRE CLASSE SOCIALE
Z.C. : Dans En guerre, l’utilisation du discours indirect libre sert-il à décrire le fossé qui sépare la classe moyenne de Romain et la classe défavorisée de Louisa ? Ne permet-il pas aussi de pointer la manière dont le langage conditionne les rapports de force ?
F.B : Oui, à condition qu’on entende aussi par langage celui qui traverse notre esprit. Ce qui est intéressant dans le style indirect libre, c’est qu’il permet de mettre sur le même plan les paroles prononcées et la petite moulinette de paroles qu’on a tous en tête. Nous sommes en permanence saturés d’énoncés. En guerre est un livre presque exclusivement en style indirect libre, où les paroles directes et le monologue intérieur sont mis sur le même plan. On est des êtres parlés, et d’abord des êtres parlés par notre classe sociale. C’est ce que je dis au début d’Histoire de ta bêtise : « tu es parlé, tu es pensé ». En gros : « toi le bourgeois ne te crois pas jugé dans ce que je vais te dire, parce que tu es parlé : des mots passent à travers toi, qui sont les mots de ta classe, les mots de ton époque ».
Z.C. : Par ailleurs, dans votre travail d’écriture, vous avez une manière particulièrement marquante de parler des conditions de travail. Dans En guerre, vous décrivez avec finesse, et humour, les paris en ligne de Cristiano, de même pour l’entrepôt Amazon de Louisa. Comment organisez-vous votre travail préparatoire pour parvenir à décrire aussi précisément ces conditions de travail?
F.B : Il y a deux manières de documenter un roman, tout d’abord ce que j’appellerais la documentation spontanée : c’est toutes les informations qu’on accumule sans faire l’effort de les accumuler (par exemple un reportage que j’ai vu à la télé ou au cinéma, une personne rencontrée…), par le seul fait d’une sorte de curiosité mécanique, en l’espèce celle que je porte à la chose sociale, et notamment à la vie des « prolos » , à la fois par tempérament et par méthode — je trouve qu’on comprend toujours mieux une société, ses contradictions, ses impasses, quand on la regarde du point de vue des classes populaires. Ensuite, il y a toute la documentation active : je lis des livres, des articles et je regarde beaucoup de documentaires qui viennent nourrir mon sujet. Pendant la période qui a précédé l’écriture d’En guerre, qui a duré 4 ou 5 mois, je me suis ainsi retrouvé à lire un livre sur un journaliste qui s’était inséré dans les entrepôts Amazon, à la fois pour comprendre le fonctionnement de ces monstres de tôle, et aussi pour étoffer mon récit de détails. Ce que j’appelle le détail qui tue.
Z.C. : Pour revenir à votre manière de superposer le discours et la réalité, il y a ce personnage de Romain qui se prétend féministe mais qui dans le fond ne refuse pas des relations de dominations sexuelles…
F.B : Votre remarque me fournit un exemple de ce que j’appelle l’esprit chrétien du romancier : Romain est habitué à avoir un rapport tout à fait égalitaire avec les femmes en raison de son conditionnement culturel et familial. Puis, dans le cadre de cette relation avec Louisa, il se voit traversé par des affects de domination, il est très séduit, elle l’appelle « Maître » par texto, ça l’émoustille. Qu’est-ce qu’on va conclure de ça ? On va dire : « ah là là quel imposteur ce Romain : dans les mots il est féministe et en fait dans les affects il est machiste ». Ben non ! Il est les deux en même temps. Et l’un n’invalide pas l’autre. Je pense qu’on se décontracte beaucoup moralement quand on commence à établir que, chez les humains, il n’y a pas de contradictions, mais des ambivalences ou des alternances, il y a des courants alternatifs. Et je pense que le roman peut être considéré comme le lieu du courant alternatif. Ainsi, Romain essaiera vraiment d’entendre la parole des femmes dans une réunion, il n’est pas insincère, mais il est aussi absolument sincère quand il découvre ce qu’il peut y avoir de sexy et d’excitant dans la domination. Pour moi, cela ne vaut pas condamnation du personnage, c’est simplement le restituer au sein de sa complexité. Il y a une disposition du romancier à faire accueil à toutes les modalités d’un individu, faire accueil, y compris à des choses que dans la vie on pourrait détester. J’ai souvent jubilé d’écrire des scènes qui, à vivre, m’avaient plutôt peiné. Et je me vois, comme romancier, capable d’une plus grande tolérance et d’une plus grande compréhension que je n’en ai dans la vie, où je peux être parfois très dogmatique, comme tout le monde. On n’arrête pas de juger, mais comme romancier, je pense qu’on peut arriver à ne pas juger.
Z.C. :Vos personnages, toutes catégories sociales confondues, sont pris dans des conditionnements qu’ils ignorent, et que vous vous amusez à dévoiler. Leur dévoilement est-il l’une des priorités que vous assignez à votre travail romanesque ? Et de quels outils dispose le romancier pour parvenir à cet objectif ?
Je voudrais préciser ce qu’a été mon parcours de romancier, car en réalité certains de mes écrits, romans ou pièces, sont beaucoup moins marqués par cette analyse du conditionnement social. Une amie m’en faisait récemment la remarque concernant mon roman Vers la douceur, paru en 2009 : « toi que je connaissais très sociologique et social, tu caractérises très peu tes personnages dans ce livre ». C’est aussi le cas dans la pièce Le Lien qui a été jouée cette année, où je mets plutôt la focale sur ce que j’appellerais les « affects purs », il est question de la filiation entre une mère et son fils, la donnée sociologique est là très mineure. En revanche, c’est vrai que depuis quelques années a monté en moi une colère devant la minoration des conditionnements sociaux présente dans certains discours anti-sociologiques d’intellectuels ou d’artistes. Les conditionnements sociaux sont mal traités ou sous traités, et ça fait revenir en moi des réflexes bourdieusiens, marxistes : En guerre est né de là, d’une envie de faire une sociologie complexe et fine des conditionnements. Contrairement à une vision grossière du conditionnement des ennemis de la sociologie fine : « tu es pauvre, donc tu deviens délinquant », c’est « tu es un grand patron, alors tu es conditionné à trouver légitime la propriété ou l’héritage ».
En fait, nous sommes tous conditionnés, il n’y a pas que les pauvres qui le sont. Et puis surtout, on est conditionné par des affects qui sont au croisement du social et du psychologique. Mon lieu c’est la psychosociologie : par où la psyché est empreinte de social, et par où le social devient de la psyché. C’est ça qui fait un roman je pense. Par exemple, si vous prenez le rapport de Louisa à sa mère, qui n’est pas énormément traité dans En guerre, mais qui l’est de façon intermittente, c’est de la psychosociologie.
Parce que c’est sa mère, leur rapport est très affectif, sanguin, filial. Louisa voit sa mère se tuer le dos à faire des ménages pendant vingt ans. Ça conditionne en elle un affect social puissant qui est : « j’accepterai tous les boulots sauf celui d’employée de ménage », on voit bien que dans cet affect-là il y a beaucoup de choses : il y a l’amour de sa mère, et en même temps du mépris, il y a les deux. Ce micmac affectivo-social, voilà la chair du roman ! C’est mon lieu.
En fait le conditionnement m’intéresse si on le voit comme un écheveau indémêlable de stimulations sociales. Par exemple, dans Histoire de ta bêtise, j’ai mis au jour un conditionnement psycho-social dont on ne parle jamais je crois, qui est : « qu’est-ce que ça veut dire être fils de fonctionnaire ? ». En hypokhâgne, ce qui caractérisait énormément ma bande – qui est restée ma bande d’amis – c’est qu’on était à peu près tous fils de profs, en tout cas, tous fils de fonctionnaires. Et ça nous déterminait énormément : à faire du rock, à être de gauche, à être en hypokhâgne, à épouser des filières plus ou moins sous-valorisées, comme la psychologie, la philosophie, l’histoire, etc. Ce n’est que récemment que j’ai mesuré que cet atavisme fonctionnaire avait des conséquences bien plus profondes. Ce n’est pas un conditionnement du genre « je suis fils de fonctionnaire, donc j’ai de la sympathie pour la fonction publique », non : ça inscrit en vous, profondément, des raisonnements non marchands, ce qui évidemment façonne un paysage idéologique, fait d’adhésions (à l’autonomie) et de refus (d’être marchandisé à son tour).
On est un écrivain social, non pas parce qu’on fait des livres sur le prolétariat ou qu’on s’intéresse à une thématique sociale, mais lorsqu’on pense puissamment que le corps d’un personnage est largement façonné par le corps social.
LE MONDE SOCIAL EST UN VECTEUR DE PUISSANCE ROMANESQUE
Z.C : Pensez-vous que, pour écrire un bon roman, l’art romanesque doive s’assujettir à un engagement social ? Certains écrivains vont placer la littérature au-dessus même de toute ambition sociale, où vous placez-vous ?
F.B : Tout d’abord, je pense qu’il y a des romans qui s’assujettissent eux-mêmes à une cause politique, et qui ne sont alors pas de bons romans, et Dieu m’en préserve. Quand un romancier écrit, s’il se place sous tutelle d’une cause, forcément il restreint son champ d’écriture, et corsète son talent. En revanche, s’il se donne comme Dieu, la complexité, l’intensité, l’intérêt, la puissance, alors quelque chose peut se déployer. Il ne faut pas se verrouiller. En fait, je préfère un roman qui tourne sur lui-même et qui devient une hypothèse formelle, plutôt qu’un roman dont je sens qu’il est à toutes les lignes sous tutelle politique, ou, pire, sous tutelle morale (beaucoup qualifient de « politique » des œuvres qui ne font qu’édicter une morale). Alors évidemment, les grands romans ils font les deux. Flaubert dit qu’il écrit des livres sur rien, sauf qu’il écrit des livres sur quelque chose. Il écrit sur quelque chose et rien à la fois. Il a ce génie absolu de faire une phrase qui tient toute seule, indépendamment de ce qu’elle raconte, et en même temps, il charrie du réel, il charrie le XIXe siècle, il charrie une figure féminine qui est depuis devenue un nom commun. Et je pense que c’est ce qu’on trouvera chez tous les grands romanciers.
Inversement, un écrivain qui dirait : « non, je n’ai pas envie de parler du réel social, ce n’est pas mon truc », je lui dirais de ne pas se forcer, que chacun à son tempérament, mais qu’il se prive tout de même d’un sacré matériau. Et en ce qui me concerne, franchement, je ne me sens pas enjoint moralement de mettre du réel dans mon livre, et je pense qu’un livre n’a aucun devoir de rendre compte du réel social, aucun. En revanche, je sais à quel point c’est un vecteur de puissance : penchez-vous sur la vie des « prolos », c’est passionnant, elle est constamment soumise à un système de contraintes. La vie de Cristiano est bien plus passionnante à écrire que pourrait l’être ma propre vie. Pour la mienne, il y aurait des situations, j’en ai même tiré un roman qui s’appelle La Politesse, mais comme j’évolue dans une relative distance avec le corps social, on en ferait vite le tour. Donc, ce n’est pas tant qu’il y aurait une prescription morale et politique à parler des vies populaires, c’est qu’il y a un grand intérêt pour la littérature à se pencher sur ces vies, et à en faire la chair du roman. Je crois qu’En guerre est, de mes romans, mon préféré, et une des raisons pour lesquelles je l’aime bien, est que je le trouve vraiment vivant, et la vie lui vient très largement du périmètre prolétaire dans lequel il déambule.
Z.C : Dans Histoire de ta bêtise vous revendiquez une position d’intellectuel, avec tout le cortège d’images sartriennes que peut véhiculer ce mot. Quelle tâche assignez-vous à l’intellectuel face à la crise sociale ?
F.B : Alors, j’ai de l’ambivalence sur la position de l’intellectuel, déjà je n’aime pas le mot et je résiste beaucoup à m’étiqueter comme ça. Si l’intellectuel, qu’il soit philosophe, penseur ou même écrivain ou artiste, est cette catégorie dont on dit qu’elle est née avec l’affaire Dreyfus, et se définit par ses interventions sur la place publique pour défendre des causes, alors je me garde bien d’être ça. Alors parfois, il se trouve qu’on m’a amené à l’être, par exemple Histoire de ta bêtise est sorti pendant le mouvement des Gilets jaunes, donc presqu’à chaque fois que je vais à la télé, à la radio, j’ai le droit à une question à ce propos. En somme on m’accule à intervenir sur l’actualité…
Bon, je joue le jeu et je réponds, ne serait-ce que parce que je suis sympathisant de ce mouvement, auquel j’ai un peu participé, mais ce n’est pas la raison pour laquelle je vais à la radio. Donc on se retrouve souvent malgré-soi mis en demeure d’avoir une opinion sur tout. Il y en a qui font ça allègrement, on sait bien que certains auteurs ou pseudo-philosophes n’ont que ça à vendre : des opinions sur tout… En revanche si on considère l’intellectuel comme une notion sociologique, je suis un intellectuel. Je gagne ma vie en bricolant des phrases et non du mortier, cela fait de moi un intellectuel.
Après pour revenir sur l’action politique, je trouve qu’il n’y a aucun devoir pour quiconque d’intervenir dans l’espace public, je n’aime pas cette pression morale qu’on fait parfois peser sur les intellectuels (le fameux « silence des intellectuels ? » etc.). Le monde de la culture, c’est-à-dire le monde du théâtre et du cinéma, a été pas mal incriminé à une période du mouvement des Gilets jaunes : « où sont-ils ? ». Comme s’il était presque de leur devoir d’intervenir, mais en réalité, s’ils ne sont pas intervenus, ce n’est pas parce que ce sont des gens immoraux qui manquent à leur devoir de citoyenneté, mais simplement parce qu’ils ont une antipathie pour ce mouvement. La question n’est pas morale. C’est une question de classe, ou une question sociale, une question de conflictualité politique. Je connais bien le milieu de la culture, le milieu théâtral notamment, je sais qu’il est gorgé de macroniens, de bourgeois de gauche, c’est-à-dire de gens structurellement conservateurs et progressistes pour faire genre. Ces gens-là étaient programmés pour développer une répulsion presque physique à l’endroit des Gilets jaunes. On voit bien que la question n’est plus de savoir si un intellectuel a le devoir ou pas d’intervenir, c’est : « En a-t-il envie ? Est-ce que son tempérament le porte à intervenir ? À soutenir un mouvement, une grève, etc. ». En fait, dans ce cas d’espèce comme en général, personne n’obéit à une prescription morale, chacun suit sa pente, et pour ma part, comme souvent mes affects sont politisés, alors j’agis. Quand l’éditeur de François Ruffin me demande de faire un texte pour soutenir sa publication, eh bien je suis content de le faire, parce que je me sens une fraternité avec Ruffin, et parce que j’aime bien ce livre.
LE MONDE EST TRAGIQUE, SAUVAGE ET BRUTAL,
MAIS IL EST DRÔLE
Z.C : Dans Deux singes ou ma vie politique vous abordez les relations entre la politique et le corps. Pouvez-vous développer cette idée-là ?
F.B : Là encore, nous sommes dans de la psychosociologie, au croisement de l’intime et du social, de la famille et de la classe, de la psyché et des idées. Je m’oppose à l’hypothèse morale sur ce qui peut impulser un engagement à gauche, de type : « je suis une cellule neutre, je constate l’injustice et donc je deviens de gauche ». Pour moi, ce n’est pas comme ça que ça se passe : les idées de gauche sont des projections d’une sorte de tempérament de gauche qui s’est façonné de mille manières depuis des siècles, et qui construit un certain rapport au monde. Les premières injonctions ont toujours à voir avec le corps. Par exemple une question que je me pose dans Deux singes ou ma vie politique, c’est : « pourquoi ne suis-je pas devenu un stalinien pur jus alors que j’étais conditionné à le devenir ? » Eh bien, parce que se sont mises en place chez moi des particules anarchistes, des particules libertaires, qui sont apparues dans des sphères très affectives, comme dans mon rapport à ma mère par exemple. À...