Après Renée Vivien, Jean Grenier, Antoine Blondin, Jean Malaquais ou encore Louis Guilloux, notre rubrique « Peut-on encore lire ? » revient ce dimanche sur l’œuvre protéiforme d’Henri Béraud. Figure du Paris des années 1920 et 1930, ami de Joseph Kessel et d’Albert Londres, journaliste au Canard enchaîné, récipiendaire du prix Goncourt, Béraud est aujourd’hui principalement connu pour son roman Le Martyre de l’Obèse ainsi que pour ses engagements politiques qui lui valurent une condamnation �à mort à la Libération. Tout à la fois grand reporter estimé, chroniqueur des humbles, romancier à succès, mémorialiste génial et pamphlétaire redoutable : peut-on encore lire Henri Béraud ?
Le nom d’Henri Béraud résonne encore vaguement aux oreilles de quelques amateurs d’histoire de la Seconde Guerre Mondiale, des friands de la littérature de l’entre-deux guerres ou des bibliophiles. Dans tous les cas, ce patronyme sent le soufre. D’aucuns s’offusquent de voir ce nom cité au détour d’une page : Béraud ne serait que ce violent pamphlétaire d’extrême-droite, farouchement anglophobe, anticommuniste et antisémite tardif, rédacteur de Gringoire, dont la plume est tachée du sang de Roger Salengro, qui s’est compromis dans la Collaboration, et a été condamné à mort avant d’être gracié. D’autres, animés d’un amour coupable pour les auteurs réprouvés, s’arrachent ses ouvrages, dont certains à prix d’or, sur le marché du livre ancien. D’autres enfin, plus rares, conservent de Béraud l’image de cet écrivain au physique imposant et à la faconde tonitruante, auteur du Vitriol de lune ou du Martyre de l’obèse qui remportèrent tous deux le prix Goncourt en 1922. Pour la grande majorité du lectorat, l’œuvre de Henri Béraud n’évoque plus rien. Dès lors, pourquoi sortir ce nom de l’oubli ? Ce long plongeon dans l’Anténore, pour reprendre une terminologie dantesque, n’est-il pas mérité ?
La chasse au lampiste

Littérature et politique ne font pas bon ménage. Or, on a fait de Béraud un écrivain politique, un auteur de livres engagés, du bon côté jusqu’en 1930, puis du mauvais à partir des années suivantes, ce qui a valu condamnation irrévocable. Or, certaines œuvres de Béraud résistent à l’épreuve du temps et se lisent toujours aussi bien aujourd’hui, pour la simple raison qu’elles ne se sont pas compromises dans un éphémère engagement.
À partir de 1945, l’opprobre s’est donc abattu sur la mémoire de Béraud, sans réelle perspective de réhabilitation. Tout juste peut-on assister à de timides rééditions : Le Martyre de l’obèse chez Albin Michel, Le Flâneur salarié chez Bartillat ou la récente édition des articles de Béraud reporter chez Séguier. Or, l’œuvre de romancier, et même de journaliste, de ce dernier n’a rien à voir avec son engagement.
Il existe en effet plusieurs Henri Béraud : le romancier, le reporter, le polémiste, le peintre de la vie lyonnaise, l’écrivain de l’île de Ré. Si l’on ne demande pas de relire, hormis à titre documentaire, ses articles écrits dans Gringoire dans lesquels il laisse éclater son hostilité envers les Britanniques (on parlerait de nos jours d’« anglophobie », enclins que nous sommes à tout psychiatriser) ou son ouvrage Faut-il réduire l’Angleterre en esclavage ? au titre évocateur, il faut pouvoir se plonger avec délices dans les pages empreintes de nostalgie et qui sentent la terre, le labour et le pain sorti du four du Bois du templier pendu ou de La Gerbe d’or. Béraud n’est pas Chateaubriand, Proust ou Céline. On ne trouvera pas de monument de la littérature dans sa bibliographie oubliée. Cependant, il doit être lu comme un des auteurs d’importance des années 1920 et 1930. Il est de la race des écrivains disparus, à la plume fluide, au style classique et au vocabulaire fouillé.
Le chantre de Lyon
Béraud est avant tout le chantre de la ville de Lyon, de son atmosphère brumeuse et de ses habitants taciturnes. Il est l’enfant du pays, le gone dont les racines sont plantées depuis des temps immémoriaux dans le sol du Dauphiné de Viennois. Qu’est-ce que Lyon ? Béraud semble, dans la quasi-totalité de son œuvre, se poser la question sans jamais vraiment pouvoir apporter une réponse définitive. Lyon est un mystère, qu’il tentera de percer à maintes reprises, notamment dans Qu’as-tu fait de ta jeunesse ?, qui évoque ses premiers pas de jeune homme dans la vie active :
« Cette ville murmurante et blême, où mon âme cherche encore ses chemins, la connais-je moi-même ? […] Que penser d’un lieu tant de fois et si vainement décrit ? Qu’est-ce que Lyon ? Vieille question sans réponse. Est-ce la lourde cité lombarde aux fumées rêveuses où la passion cherche l’ombre des églises ? Est-ce le labyrinthe des cours mitoyennes et des maisons à deux issues, propice aux adultères et aux crimes, où traîne on ne sait quel reflet sans lueurs de l’Italie de Stendhal ? Lyon, ma ville étrange, es-tu la cité stricte où les esprits positifs ne verront jamais qu’un carrefour du trafic ? […] Est-il seulement un Lyon véritable ? »
Lyon, cité aux multiples visages et origines, obnubile Béraud qui laisse éclater ses talents de peintre pour décrire sa grisaille, ses bourgeois ridicules ou sa physionomie faite de rues biscornues et de petites places héritée des temps médiévaux qui s’effacent peu à peu devant la modernité architecturale des Haussmann lyonnais. La ville est le personnage principal de la première période, dite « lyonnaise », de Béraud, de 1903 avec son recueil Poèmes ambulants jusqu’en 1919 avec Le Mémorial de la rue Sainte-Hélène.
Parmi ces écrits d’un auteur en gestation mais déjà fort productif (quinze livres en seize ans), sélectionnons un recueil de nouvelles drôles et enlevées, Voyage autour du cheval de bronze, dont le titre reprend plaisamment celui de l’ouvrage majeur de Xavier de Maistre, Voyage autour de ma chambre. Ces historiettes se déroulent tantôt à Saint-Jean, tantôt à la Croix-Rousse ou à Perrache et, sous des dehors moqueurs brocardant les bourgeois ridicules, constituent une longue déclaration d’amour déjà empreinte de nostalgie. Le recueil débute sur une tonalité comique et ce, dès l’introduction ; Béraud se présente comme un amoureux des voyages, rêveur et contemplatif devant « les vitrines [contenant] des alpenstocks, des casques de liège, des bottes ferrées, des costumes de yackting, des fourrures de chauffeurs » mais se croit incapable de quitter la ville qui l’a vu naître et se contente en « pèlerin hasardeux [de visiter] des quartiers divers et [d’accomplir] plusieurs fois la traversée de la Saône. » Doué d’un sens de l’autodérision qui ne le quittera jamais, il se tourne lui-même en ridicule :
« Dès que j’ai perdu de vue la statue de Louis XIV, je ne suis plus moi-même. Avec une âme de nomade, je vis dans l’inertie casanière d’un percepteur de province. J’aime l’aventure mais j’ai peur des risques. Je tiens à la fois du corsaire et du petit rentier, hésitant entre la brigantine et les pantoufles. »
Béraud ne sait pas encore, au moment de coucher ces lignes sur le papier, qu’il deviendra reporter international dix ans plus tard et qu’il parcourra le monde.
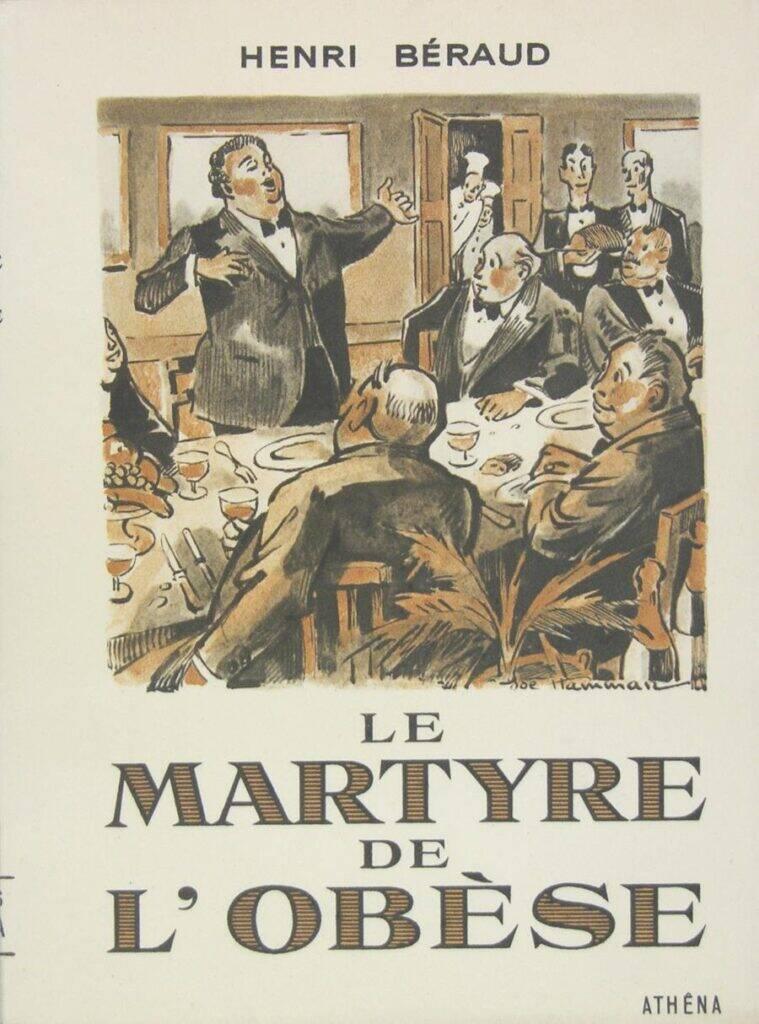
Retenons de ce recueil deux nouvelles. La première, intitulée L’Âge d’or, est du registre comique. Elle décrit le déroulement d’une fête déguisée grotesque à la mode antique organisée sous les auspices de la municipalité d’Édouard Herriot, désireuse de célébrer la concorde et la bonne entente (nous sommes deux ans avant la Première Guerre mondiale et ce n’est pas un hasard). Avec plus de cent ans d’avance, les bourgeois bouffis d’importance de Lyon célèbrent la volonté d’union et de rassemblement au-dessus des partis avec beaucoup de sérieux et de componction. Mais cette communion artificielle des contraires finira bien sûr en pantalonnade et bouffonnerie. « Les griefs s’envolaient. Pas d’ennemis à droite et pas davantage à gauche. Les mains se tendaient, fraternelles, de Saint-Just à Pierre-Bénite, de Saint-Clair à Oullins. La concorde de nos fleuves n’était plus, comme jadis, une vaine image mais, au contraire, symbole de réalités. On célébrait la Fête des Réconciliations. » Plus de querelle de clochers, tous les bourgeois de Lyon (politiciens, fonctionnaires, libéraux…) qui autrefois se dévoraient les mollets deviennent le temps d’un défilé sur une journée les meilleurs amis du monde. S’ensuit une longue énumération des grandes personnalités de l’époque toutes ennemies entre elles, dont les noms ont bien sûr sombré dans l’oubli depuis, et qui tombent finalement dans les bras les uns des autres en défilant deux par deux. Certains coups de griffe sont, au passage, acérés : « Enfin, tout seul, absolument seul, le front serein et comme apaisé, marchait M. Léon Sentupéry, qui s’était réconcilié avec la grammaire. » Évidemment, Béraud n’est pas dupe et tout dérape quand l’orage, produit du temps capricieux et maussade de Lyon, éclate : « Un typhon de colère lui succédait, un ouragan vengeur, qui emportait dans ses tourbillons toute la miséricorde et toute la tolérance de l’Âge d’or. Au souffle de cette âpre bise, les vieilles haines renaissaient. » La nature reprend ses droits et il s’en sera fallu d’un simple coup de vent pour que les nouveaux amis s’entre-déchirent de nouveau. L’assassinat de François-Ferdinand et le 3 août 1914 ne sont plus très loin…
Une seconde nouvelle, au ton radicalement différent, annonce le Béraud mémorialiste désabusé des années 1940 et 1950. Intitulée Une Aventure nocturne, ce récit émouvant et joliment écrit, malgré quelques maladresses, décrit la rencontre entre Béraud et le fantôme de François Vernay, peintre et figure de Lyon mort quinze ans plus tôt. L’entrevue se déroule dans la bonne humeur autour d’un verre de beaujolais, le fantôme reconnaissant le vieux Lyon qu’il avait quitté et se rassurant sur la déférence des jeunes générations pour les anciens : « Ce qui est admirable chez nous, c’est le respect que l’on a de l’ancien temps. Les ancêtres pourraient revenir qu’ils retrouveraient un Lyon reconnaissable, à peine défiguré. » Mais le narrateur le détrompe rapidement et lui apprend la démolition prochaine du Pont de la Guille.
« Alors Vernay pleura. Et il me sembla, tandis que je regardais pleurer ce spectre bénévole, qu’une cohorte de disparus pleurait sur ses traces ; il me semblait que tous les gones des temps révolus, tous ceux qui traversaient au crépuscule le géant de pierre en écoutant gronder le Rhône sous ses arches, se pressaient lamentables et plaintifs ainsi que des ombres au bord du Styx. […] Et le pont noir s’arcboutait de toutes ses forces, comme pour résister aux coups qu’on lui destinait. »
De cette période lyonnaise, nous pouvons retenir aussi le court roman La Petite Place, récit des combines politiques d’un groupe de propriétaires bourgeois qui s’écharpent au sujet de la rénovation d’un quartier de la ville, ce qui conduira à une alliance inédite, un barrage républicain entre conservateurs, socialistes et bourgeois contre les radicaux anarchisants relégués derrière un cordon sanitaire.
Un romancier célébré
La célébrité de Béraud éclate en 1922 avec l’attribution du Goncourt pour ses deux premiers véritables romans, Le Vitriol de lune et Le Martyre de l’obèse. S’ouvre alors la période qui aboutira à son projet le plus ambitieux : la « trilogie du pain ». Le prix, en plus de lui procurer la reconnaissance du monde des lettres, lui assurera une aisance financière qui lui permettra d’acheter plusieurs propriétés sur l’île de Ré, dont il deviendra l’une des figures emblématiques.
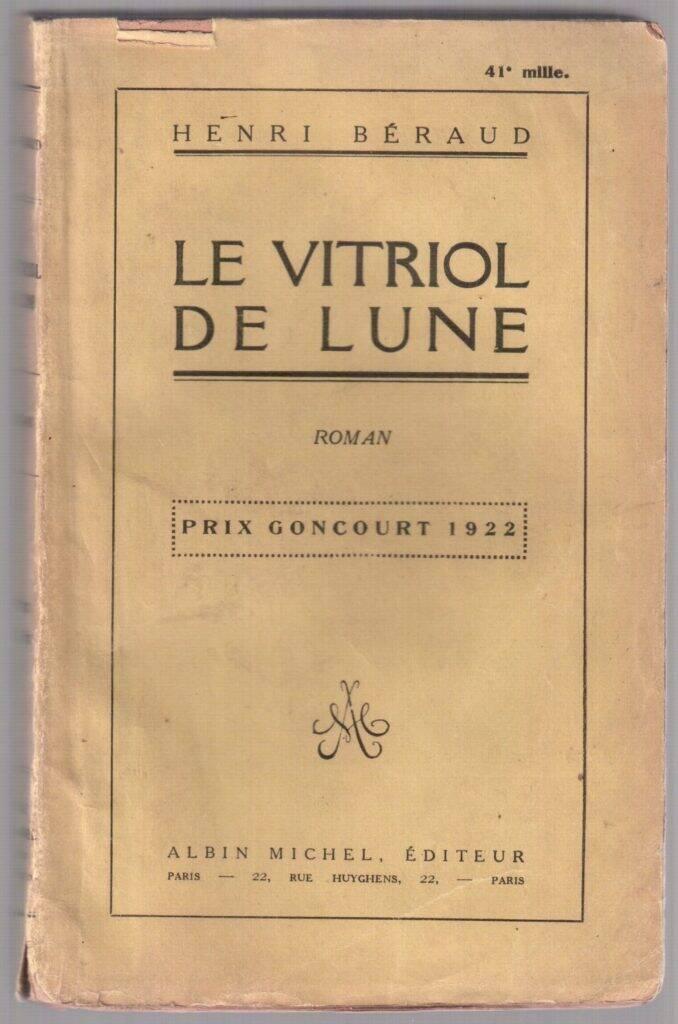
Que valent vraiment ces deux ouvrages primés ? Le Vitriol de lune est un roman historique plaisant à la façon de Paul Féval ou de la Théophile
Gautier dont l’action se déroule au temps de Louis XV, avant et après sa tentative d’assassinat par Robert-François Damiens, qui apparaît en tant que personnage secondaire. Le supplice de Damiens, resté célèbre dans l’Histoire par sa cruauté est le morceau de bravoure de l’œuvre. La description détaillée s’étend sur une dizaine de pages et soulèvera le cœur de plus d’un lecteur sensible. La trame du récit, classique dans la forme, dépeint les tribulations du jeune Blaise et de son oncle Giambattista, un bellâtre italien idéaliste et vindicatif, dans les rues d’un Paris blafard et interlope. Animés du désir de venger Damiens, ils se perdront dans un complot ourdi par les jésuites contre la Du Barry et dont l’issue sera, bien sûr, tragique. L’ouvrage se lit rapidement mais se distingue par sa richesse documentaire et la capacité qu’a Béraud de faire revivre « comme si l’on y était » la vie quotidienne des petites gens au temps des Lumières qui s’estompent. Ce talent se vérifiera avec brio dans les récits purement historiques de Béraud, tels que Le 14 juillet, chronique haletante des quelques jours précédant la prise de la Bastille, ou Mon Ami Robespierre. Le Martyre de l’obèse, à la tonalité comique, voire farcesque, est un des livres les plus connus de son auteur. Il est représentatif de sa capacité d’autodérision évoquée plus haut, Béraud se mettant en scène avec humour et sans illusion derrière le personnage du narrateur, un « bon gros » de cent kilos égaré dans les quiproquos amoureux d’un couple de petits bourgeois. Il y a du Feydeau dans ce récit cruel qui verra le narrateur humilié et martyrisé par la péronnelle dont il est amoureux.
Soyons honnêtes : ces deux romans, bien qu’ils soient écrits irréprochablement, ne méritaient pas l’attribution d’un double prix Goncourt, sauf si la finalité visait à encourager un jeune auteur désireux de se lancer dans une carrière littéraire. D’autres romans suivront rapidement, comme Lazare ou Au Capucin gourmand, mais c’est surtout sa « trilogie du pain » qui constitue l’apogée de sa production de romancier. C’est à cette trilogie que Béraud a consacré sa vie et sa carrière, et il n’abandonnera le roman que contraint et forcé par les événements de l’actualité qui le pousseront à s’engager dans la folle embardée du polémiste.
Les titres qui composent cette trilogie sont Le Bois du templier pendu (1926), Les Lurons de Sabolas (1932) et Ciel de suie (1933). La phrase d’ouverture du premier volume place d’emblée le décor : « Je raconte une histoire pour les gens d’ici. » Béraud s’inscrit dans l’espace et le temps du village de Sabolas (quasi-homonyme de « Satolas », le village dont sa famille est originaire) et de ses habitants, des paysans bourrus, têtus, mais laborieux qui, de Philippe le Bel à Sadi Carnot, traverseront durant ces trois ouvrages les coups du sort et autres vicissitudes de l’Histoire : guerres, épidémies, industrialisation… Béraud y chante l’enracinement barrésien, la fidélité à la terre des ancêtres, le bon sens du paysan à la tête dure qui encaisse les coups du seigneur local ou du patron tyrannique, dédaigneux et paternaliste jusqu’à la révolte.
Le Bois du templier pendu débute comme un conte fantastique : un chevalier du Temple, lynché par la foule et pendu à l’arbre d’une clairière, dans le bois de Sabolas, serait à l’origine d’une malédiction qui s’abattrait sur le village et ses habitants. Puis le récit se concentre sur la vie quotidienne, au fil des siècles, ponctuée de malheurs, de violence et de drames en tout genre, pour aboutir, en 1789, à la révolte des paysans contre le pouvoir oppresseur. De serfs quasi-esclaves ils deviennent alors propriétaires de vastes terres agricoles, et c’est à l’aube du XIXe siècle que s’achève le premier volume. Roman régionaliste à la façon d’Alphonse de Châteaubriant ? Peut-être, mais Béraud va bien au-delà car c’est aussi le portrait réaliste des mouvements populaires et de la lente évolution de l’histoire des mentalités qui l’animent.
Les Lurons de Sabolas reprend l’histoire du village et des familles précitées à l’époque de Louis-Philippe, le « roi bourgeois ». Les anciens paysans sont devenus des propriétaires terriens soupçonneux et avides. L’esprit de famille perd de sa vigueur, l’individualisme progresse et l’appât du gain se fait toujours plus pressant. Le récit suit le destin conjoint des deux lurons de Sabolas, Pétrus et Nicolas, les compagnons du devoir dont l’appartenance à cette confrérie symbolise la perpétuation de la tradition et de la lignée. Le destin de ces deux frères de cœur inséparables basculera quand l’un paiera de longues années de bagne sa participation à la révolte des canuts de Lyon de 1831 alors que l’autre préférera oublier cet épisode pour louer ses services au baron de Sabolas, qui a participé au massacre des canuts et à qui il a sauvé la vie. Au retour du banni, les deux compagnons se dévoreront tels de nouveaux Etéocle et Polynice, et cela marquera alors le terme de leur fraternité mais aussi la fin d’un monde, celui de l’entraide et de la solidarité fondée sur une même appartenance de classe. Le monde paysan laisse place au monde ouvrier, tout aussi dur, et à celui des bourgeois. Voyons ce passage digne d’un roman de Jules Vallès :
« Dans ce faubourg abrupt, vingt-cinq mille travailleurs ruminaient les souvenirs de 1831, et plus d’un, au fond de son galetas, cachait un drapeau noir. Partout la misère tendait sa face hagarde. Tous attendaient le signal de l’émeute. Ils étaient le peuple, le vrai, celui qui besogne pour le pain, les rabougris, les mal rasés, les profils de loup, les épouvantails à repus, enfin la canaille, les canuts, ceux qu’une bourgeoisie repue et poltronne devait bientôt surnommer les Voraces… ».
La communauté de canuts est comme « [une] tour de Babel dans la brume, un véhément caravansérail sur le vieux mont des travailleurs et des pauvres… ». Le monde ancien n’a plus sa place : « Durant ce bref instant, deux races, deux castes, deux époques s’affrontèrent. Là, dans cette haute chambre, au milieu des plaines submergées d’ombres et de vent, l’homme des charrues, l’ancien, toise le nouveau, l’homme des machines. Et, pour la première fois, le nouveau rend à l’ancien son regard. » Il ne faudrait pas voir ici une œuvre littéraire « engagée » au message politique explicite mais plutôt un exemple de roman populiste dans la lignée d’Eugène Dabit, André Thérive ou Henry Poulaille.
Enfin, Ciel de suie délocalise l’action à Lyon intra-muros, « la ville où l’argent est maître » et où règne l’esprit boutiquier :
« Lyon leur appartient. Vingt mille immeubles leur suent des rentes ; leurs châteaux déserts règnent sur des lieues de vignes, de blés, d’étangs et de bois ; leurs coffres regorgent ; ils pourraient dominer le monde et vivre comme des princes, et ils sont là, chaque jour, souvent seuls, dès l’aube et tard dans la nuit, même le dimanche. Ils ignorent la joie. Ils se refusent le moindre plaisir. Une seule passion les dévore, la plus ardente et la plus opiniâtre, celle qui ferme dans l’effort d’une suprême convoitise les doigts crochus de leurs moribonds. »
Si le lieu est plus vaste, le récit, lui, est ramassé sur un noyau familial, celui de la branche légitime des Chambard, des bourgeois parvenus, sots et prétentieux en lutte contre la branche illégitime, composée de jeunes idéalistes et artistes qui sont bien sûr bridés dans leurs aspirations par les premiers et pour lesquels il n’est « pas question de lire Murger au lit en prenant son chocolat ». L’histoire prend les dimensions d’un drame amoureux tragique qui clôt, au cours d’une partie de chasse à l’homme dans la forêt de Sabolas, près de sept siècles de la vie du village et des habitants, maudits par le templier pendu.
Mémorialiste et journaliste
Cette œuvre fait le lien avec ses trois volumes de souvenirs : La Gerbe d’or (1928), sur son enfance, Qu’as-tu fait de ta jeunesse ? (1941) sur ses débuts dans la vie active et Les Derniers beaux jours (1953) sur l’entre-deux-guerres. Le Béraud mémorialiste a enfin trouvé son identité et sait quel homme il est : un homme amoureux de la terre, un fils de boulanger et de ménagère qui, quelle que soit sa réussite sociale, restera fidèle au sol qui l’a nourri et dont est issue la « gerbe d’or », qui est aussi le nom de la boulangerie de son père. « J’aime la terre – la terre, vous entendez, pas la vie champêtre. La terre. Je la convoite. Celle qui m’appartient, je la frappe du pied avec une joie franche et forte ; je me retiens de la prendre à poignées, dans les champs et mes vignes, pour la flairer, comme on fait chez nous. Cela m’est venu à quarante ans et c’est depuis lors que je vois clair. À présent, je connais l’homme que je suis. »
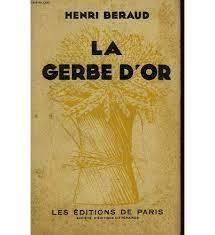
S’il fallait ne choisir qu’un extrait de l’œuvre complète de l’auteur, ce serait la superbe et émouvante fin de La Gerbe d’or dans lequel un Béraud dans la quarantaine rend hommage à son père décédé, véritable héros du livre, boulanger parti de rien et dont les sacrifices pour assurer à son cancre de fils unique une situation enviable auront finalement porté leurs fruits, sans qu’il le sache.
Les Derniers Beaux jours, qui est aussi son dernier livre, aborde la carrière de reporter de Béraud. Comme une boucle qui se ferme, le jeune Béraud de 1912 qui craignait le risque et l’inconnu devient reporter puis, comme une suite logique, polémiste engagé dans les combats de son temps, ce qui signera le glas de sa carrière et de sa vie publique. Il travaille d’abord au Petit Parisien et à Paris-Soir, avant de rejoindre Gringoire en 1928, ce qui lui permettra de parcourir le globe, en partie avec ses amis Albert Londres et Joseph Kessel, et d’en tirer des reportages dont il composera des livres : Ce que j’ai vu à Moscou, Ce que j’ai vu à Berlin, Ce que j’ai vu à Rome, Émeutes en Espagne, Dictateurs d’aujourd’hui… Et surtout Le Flâneur salarié, série de reportages des années 1920, originaux dans leur ton et la présentation des faits, et qui restituent avec acuité le climat politique avant-coureur des futures catastrophes.
Bien avant Gide et son Voyage en URSS, Béraud, homme de gauche, voire d’extrême-gauche à ses débuts, revient d’Union soviétique horrifié et farouchement anticommuniste. Lui, le pacifiste intégral traumatisé de la Grande Guerre, qui refusait le conflit à tout prix, tourne casaque et fustige incessamment sa cible favorite, l’Angleterre, dont il accuse les dirigeants d’être des fauteurs de guerre. Son soutien à Vichy sera motivé par ces éléments : anticommunisme, antiparlementarisme, anglophobie, amour viscéral de la terre. L’antisémitisme viendra plus tard. Lui, le dreyfusard, l’ami de Kessel, rejoindra les rangs. Peut-être par opportunisme ?
Les raisons d’une mise au silence
Peut-on encore lire Henri Béraud polémiste ? Oui, pour se rendre compte des talents d’une plume assassine, à l’image de celle d’un Léon Daudet. Dans ce cas, la lecture de Trois ans de colère (1936) peut suffire. Béraud, devenu homme de droite, laisse éclater sa colère après l’affaire Stavisky et le 6 février 1934 tout au long de deux cents pages à l’égard des gouvernements et des parlementaires de la IIIe République, qu’il juge corrompus, affairistes et sans scrupules. Certaines lignes sont tristement prémonitoires :
« Nous ne faisons point de difficulté pour reconnaître que voleurs et fusilleurs attendent encore leur châtiment. Mais nous demeurons assurés que l’heure de la justice sonnera – et c’est sans crainte aussi bien que sans impatience que nous voyons tourner l’aiguille… ».
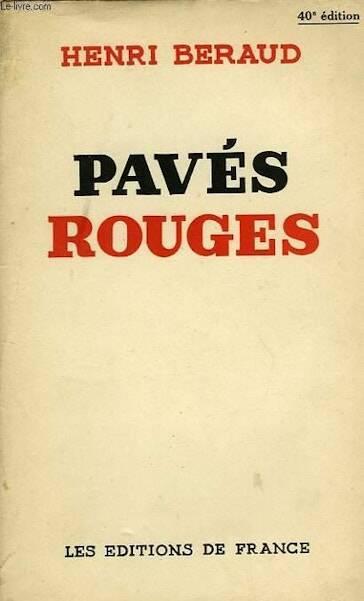
D’autres lui vaudront une rancune tenace de ses ennemis, qui ne le rateront pas en 1944. Ainsi ces lignes de Pavés rouges (1934), qu’il reprend dans Trois ans de colère : « Vous avez glissé dans le sang. Il s’agit à présent de régler votre compte… Il vous fallait « notre peau ». Nous réclamons la vôtre. Et vite. Pas de Haute Cour, non ! La Cour martiale s’il vous plaît, car on vous a trouvé les mains noires de poudre. »
Il y a, en effet, un aspect visionnaire chez Béraud ; qu’on en juge à la lecture de ces lignes :
« Demain peut-être, ô dérision terrible ! des millions d’hommes mourront pour sauver les mandats d’un millier de bavards que, de Londres à Paris, chacun rêve de clouer par la langue. Grouillez, intriguez, pérorez, hâtez-vous, malheureux ! On frappe à la porte. La mort est là, suivie d’un homme noir qui brandit la torche. Le sang des justes va couler. Et quand ce sera fini, lorsque, dans l’éternel silence d’un monde foudroyé se dispersera la fumée du dernier canon, peut-être vous tairez-vous enfin ! ».
Enfin, Béraud, c’est ce style enlevé qui nous donnera l’occasion de citer un dernier extrait, la description d’une assemblée de radicaux-socialistes assistant à une conférence de Daladier :
« Un bien beau spectacle. Huit cents délégués fumant comme des soupières et considérant la Pipe avec un mélange de crainte mystique et de fureur sacrilège. Les chers barbus, les chers ventrus ! Ils arrivaient à pleines barbes, à pleins bedons, des quatre coins du territoire. Il en venait du bistro, il en venait de la gargote, il en venait du claquedent. Ils rayonnaient. Au dire de chacun, tous étaient plus rouges que l’andrinople des tentures. On doit cependant reconnaître que l’éclat de votre célèbre cramoisi éteignait sans efforts celui de tant de rubicondes digestions. »
Béraud paiera cet engagement contre les combinards au prix fort. Ses anciens ennemis ne pardonneront jamais ses attaques qui fragilisaient les fondations d’une République vacillante. Béraud est-il allé trop loin ? Assurément. Néanmoins, il est évident que la peine capitale, infligée après un procès bâclé en deux jours, était un châtiment disproportionné pour un homme dont Mauriac a dit : « Grâce à Dieu, Béraud n’a pas trahi. »
Une meilleure connaissance de Béraud passe par une réédition a minima de ses romans, récits historiques et reportages qui n’ont rien à envier à ceux d’Albert Londres. L’appel aux bonnes volontés est donc lancé !
Bibliographie sélective :
Béraud, Henri, Le Martyre de l’obèse, Albin Michel, 1922
Béraud, Henri, Le Bois du templier pendu, Éditions de France, 1926
Béraud, Henri, La Gerbe d’or, Éditions de France, 1928
Béraud, Henri, Le 14 juillet, Hachette, 1929
Béraud, Henri, Qu’as-tu fait de ta jeunesse ?, Éditions de France, 1941
Béraud, Henri, Les Derniers beaux jours, Plon, 1953
Butin, Jean, Henri Béraud, ELAH, 2002

















