Entre fiction et réalité, Jakuta Alikavazovic dessine une mère et sa fille, raconte l’une tout en laissant transparaître la seconde, la poésie et d’autres langues uniques les réunissant d’un bout à l’autre du temps, d’une vie de désirs et de mots – « vouloir changer le monde, et vouloir faire l’amour, est-ce que ce ne sont pas deux vœux à la hauteur d’un vers ? »
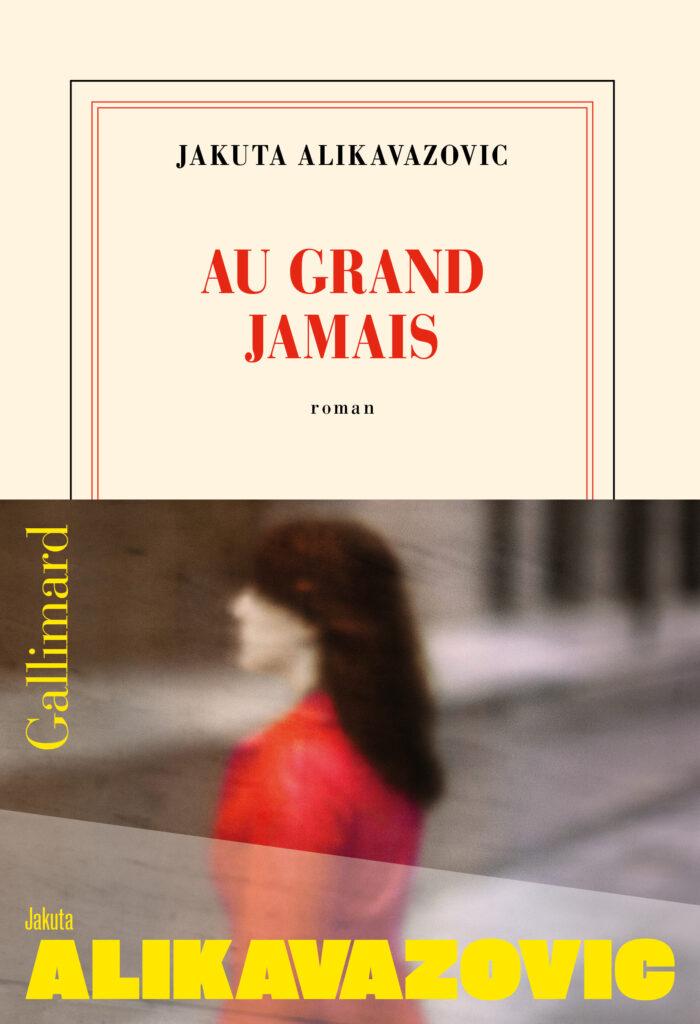
La mère en fumée bleue
Dans ce livre sont emmurés des enfants et des souvenirs, des yeux d’azur et des nuits trop vastes, des silences « spacieux » et des couleurs éblouissantes. « Comme une goutte de bleu colore tout un verre d’eau, une goutte de fiction suffit à faire roman », conclut Jakuta Alikavazovic, rendant vacillantes toutes certitudes au sujet de ce texte, déjà aussi fragiles que de la dentelle.
De ses phrases longues ou heurtées, qui se poursuivent d’un point à l’autre, semblant déborder du cadre grammatical pour créer leur propre grammaire poétique, elle y raconte une mère, peut-être la sienne, peut-être un personnage fait de faits réels et inventés, silhouette aussi vaporeuse que la « fumée bleue, lente, mais lente à la façon de quelque chose qui se réveille et s’étire, ou alors lente comme quelque chose qui attend son heure ». Dans les années 1980, cette fumée l’enveloppe elle et ses amies, tandis qu’elle a toujours une cigarette entre les lèvres, qu’elle habite un nuage, celui, incarné, de la nicotine, et celui, évanescent, de la poésie. Arrivée de Yougoslavie en 1972, s’installant à Paris où elle dérobe à une famille bourgeoise des gestes et des attitudes, des moues et des intonations, cette femme est un mystère qui a fait sienne « l’élégance des mélancoliques ». Elle arbore des « trésors », s’accorde le droit d’en acheter un nouveau tous les dix ans et ne porte qu’une « pièce authentique » à la fois, robe d’un rose « si vif qu’il doit imbiber même l’épuisement, même les songes » ou sac à main précieux. Elle fait alors naître des vers, peut-être pour se sentir libre, s’échapper de la dictature ou pour y jouer un rôle qui restera imaginaire ou incertain. Outre le nuage où elle évolue, elle vit dans un appartement où le temps n’a plus cours, où les heures sont figées, où le clair-obscur adoucit les ombres et les nuits intérieures. Pourtant, elle a abjuré la poésie, a arrêté d’écrire, faisant de la vie de sa fille son « œuvre » ultime, sa poésie devenant celle du monde, en « quatre dimensions ».
« Même quand elle n’est pas là, elle est là : elle est dans l’atmosphère de notre appartement, elle est dans le moindre meuble, elle est dans cet espace feutré, tamisé, qui est mon monde. Elle est cet espace. Elle est mon monde. Elle est la texture qu’il a pour moi. Par sa douceur, sa façon de ne jamais élever la voix, de tourner des pages jusque tard dans la nuit. Par les tissus qu’elle choisit pour mes vêtements, mon linge de lit, et qui m’enveloppent dans un cocon qui est elle […] ; elle est le coton, la laine, le velours sur lequel je trace des dessins, des signes secrets que j’efface d’un revers de main, d’une caresse. […] Elle est la façon dont un rayon de soleil passe entre deux voilages. Elle est ces voilages, elle est ce soleil. Elle est les abat-jour des lampes, en verre dépoli, en soie bleutée, et elle est leur disposition dans les pièces, et elle est le chemin que font, au sol, les cercles poudrés de leur lumière. »
“De ses phrases longues ou heurtées, qui se poursuivent d’un point à l’autre, semblant déborder du cadre grammatical pour créer leur propre grammaire poétique, elle y raconte une mère, peut-être la sienne, peut-être un personnage fait de faits réels et inventés”
Il est possible que ma vie […] soit sa dernière œuvre
Cette femme existe par elle-même mais aussi par sa fille qu’elle a modelée, à qui elle a donné sa liberté, à qui elle a transmis ce qu’elle semblait ne pas pouvoir lui transmettre. Cette enfant devenue adulte, la narratrice, laisse par instants deviner l’autrice, écrivaine qui convoque, fait apparaître et disparaître, cache entre ses mots tout ce qu’elle a de plus cher, tout ce qu’elle a « aimé, désiré et convoité ». Elle est fille et elle est mère, elle est une enfant qui ne quitte pas Thomas, une adolescente aux jambes nues, une jeune femme qui revoit cette silhouette oubliée, ces yeux bleus plus bleus qu’elle ne le pensait, d’une nuance « plus sombre, plus subtile, plus adorable et plus triste que celle dont [elle] croyai[t] se souvenir », une amante qui s’égare dans le ciel et dans l’ombre d’une porte-cochère, les lèvres sur un cou dans une morsure ou un baiser.
Au grand jamais est ainsi une ode à une mère aussi insaisissable qu’immuable, mais aussi à la nuit de nos vies. Ce livre à la toile complexe, décousue, souligne avec une douce dureté poétique l’aspect composite de toute existence – ce passé dont on hérite et qu’on renferme, l’Histoire et l’histoire, la nôtre et celle de nos parents, les regrets et les remords qui nous dévorent, le poids des souvenirs et des disparitions qui nous pourchassent.
- Jakuta Alikavazovic, Au grand jamais, Gallimard (2025).
- Crédit photo: © Maia Flore

















