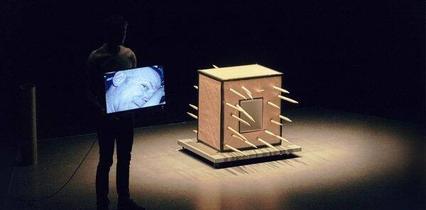C’est l’image d’un soleil couchant qui pourrait figurer sur l’affiche du dernier Terrence Malick : film sublime comme les rayons de l’astre, bouleversant pour les sens, mais toutefois répétitif. Reprenant effectivement de nombreux codes à The Tree Of Life, qui avait eu la Palme d’Or en 2011, et à A la merveille, Malick semble s’enliser dans un systématisme cinématographique malgré l’intensité poétique qui se dégage de son nouveau long métrage. Mais voilà, il est ici question de Malick, avec un grand M (ou plutôt un grand Aime), alors on lui pardonne, parce qu’une fois de plus, touchés par la pureté des plans, on ne sort pas de la salle de cinéma indemne.
Qui suis-je, moi qui suis ?
Le premier plan du film est celui d’un homme en quête de sens, écartelé entre son être pur et son être social façonné. Face à l’immensité d’un paysage naturel, le regard du personnage, accompagné par un travelling latéral, se déplace en direction d’une route, métaphore de la voie à choisir. C’est sur ce déchirement interne que repose Knight Of Cups, le déchirement d’un scénariste, Rick (interprété par Christian Bale), prisonnier du système hollywoodien et égaré dans un monde fait de chimères, cherchant le bonheur entre les femmes et les coupes de champagne.
Cette poursuite identitaire se développe donc au sein de Los Angeles, ville tentaculaire du rêve américain où l’homme ne peut que perdre sa propre trace. Il est effectivement question de songe ici car c’est l’éveil que cherche Rick, somnambule parmi les somnambules, raison pour laquelle l’injonction « Réveille-toi ! », proférée par divers personnages, scande le film de manière régulière. A Los Angeles, Rick s’est accroché à un fil d’Ariane emmêlé entre les tours. Comment trouver un sens dans cette architecture répétitive moderne qui anesthésie tout et ne laisse plus de place à la méditation ? Que Rick ouvre une fenêtre, il ne verra pas un ciel infini permettant à l’âme de vagabonder pour mieux se trouver, mais la façade de la tour d’en face obstruant toute réflexion vers un au-delà du quotidien. Les tours silencieuses étouffent le regard et empêchent l’homme de penser.
Le personnage est étranger aux autres mais avant tout à lui-même et si Malick se plait à filmer les mains de manière rapprochée c’est bien pour mettre en valeur cette volonté d’attraper, de saisir le flux d’une vie sans cesse en mouvement
Le personnage est étranger aux autres mais avant tout à lui-même et si Malick se plait à filmer les mains de manière rapprochée c’est bien pour mettre en valeur cette volonté d’attraper, de saisir le flux d’une vie sans cesse en mouvement. Rick, noyé dans l’effervescence citadine, ne peut atteindre le sens de l’existence car la vie elle-même est enfermée dans des tours, dans des voitures, et échappe à des yeux qui la sollicitent. Les plans multiples sur l’eau (qui apparaissaient déjà à de nombreuses reprises dans ses deux derniers films) étayent ainsi cette notion de submersion. De façon récurrente, les personnages engloutis sont filmés la tête sous l’eau après avoir plongé dans une piscine, plans rappelant au spectateur que leur vie superficielle, au-delà des paillettes d’Hollywood, n’est qu’asphyxie. Dans le monde des illusions, les hommes jouent la comédie entre eux et finissent par se confondre avec leur propre masque. « Tu vis dans un monde imaginaire n’est-ce pas ? », demande ainsi une stripteaseuse à Rick.
Une esthétique du contraste
La nature, dans son immortelle splendeur, est dépeinte comme un espace permettant à l’homme de trouver des réponses. Ici, un dialogue est possible car l’homme et la nature se retrouvent dans une même étreinte originelle. La mer, qui apparaît à plusieurs reprises dans le film, est certes limite spatiale mais aussi miroir d’immensité où l’homme « contemple son âme », pour reprendre un vers de Baudelaire. La solitude et le calme sont présentés comme des critères régénérants qui permettent à l’être humain de se construire. Pour illustrer cette idée fondamentale, Malick joue abondamment sur le changement de rythme.
A la frénésie de la ville, s
La spiritualité comme moyen d’éclaircissement
Le recours à une narration décentrée par le biais d’une voix-off (procédé caractéristique chez Malick), offre au spectateur un regard surplombant l’existence de Rick. Les voix narratives, celle de Rick ou encore des femmes qu’il rencontre sur son chemin, s’entrecroisent par-dessus les plans pour laisser entendre un discours métaphysique axé sur une recherche de soi. « Le véritable amour est dur à trouver ? Où est-il ? », telles sont les questions posées solennellement par ces voix narratives.

En outre, la perception omnisciente que confère la voix-off au spectateur et qui permet une introspection du personnage, place le film de Malick dans une dimension profondément spirituelle. Elle nous rappelle qu’au-dessus de nos têtes se trouve un œil divin qui voit tout et peut guider nos pas, ce long métrage devant bien sûr être considéré dans une perspective religieuse. Il semble signifier que Dieu est toujours là, d’où les nombreux plans en contre-plongée sur le ciel ou le soleil (rappelons ici que le terme soleil est issu du latin sol, solis signifiant l’ « astre » mais aussi la « divinité »).
Les maîtres spirituels, comme les bouddhistes, les voyantes ou les prêtres, vers lesquels Rick cherche conseils, sont présentés comme étant à même de lui donner des réponses. Par la communication qu’ils mettent en place avec une nature qu’ils savent écouter, ils semblent détenir un savoir sur elle qui échappe à l’homme moderne toujours en quête d’action et oubliant d’écouter les battements du cœur terrestre. « Le monde est un marais qu’il faut survoler », déclare ainsi la voyante de manière lucide.
Ah, la merveille ! Fidèle à la magnificence de son talent, Malick nous plonge encore une fois dans une expérience sensorielle qui relève bien plus de l’art photographique que du film traditionnel. Que le nouveau spectateur en soit averti ! On ne va pas voir Knight Of Cups comme n’importe quel long métrage. Ici, pas de véritable construction narrative, ou d’évolution purement linéaire, mais des plans travaillés qui se succèdent pour le plaisir des sens, du cœur, et de l’âme.
- Knight Of Cups, de Terrence Malick, avec Christian Bale, Natalie Portman et Cate Blanchett.