S’il fallait faire une déclaration d’amour, c’est sans doute en offrant directement celle de l’auteure Anne-Fleur Multon à Sara : Les Nuits bleues, cet hiver aux éditions de L’Observatoire. Une déclaration jouant des implicites et laissant les amantes retrouvées parler pour nous.
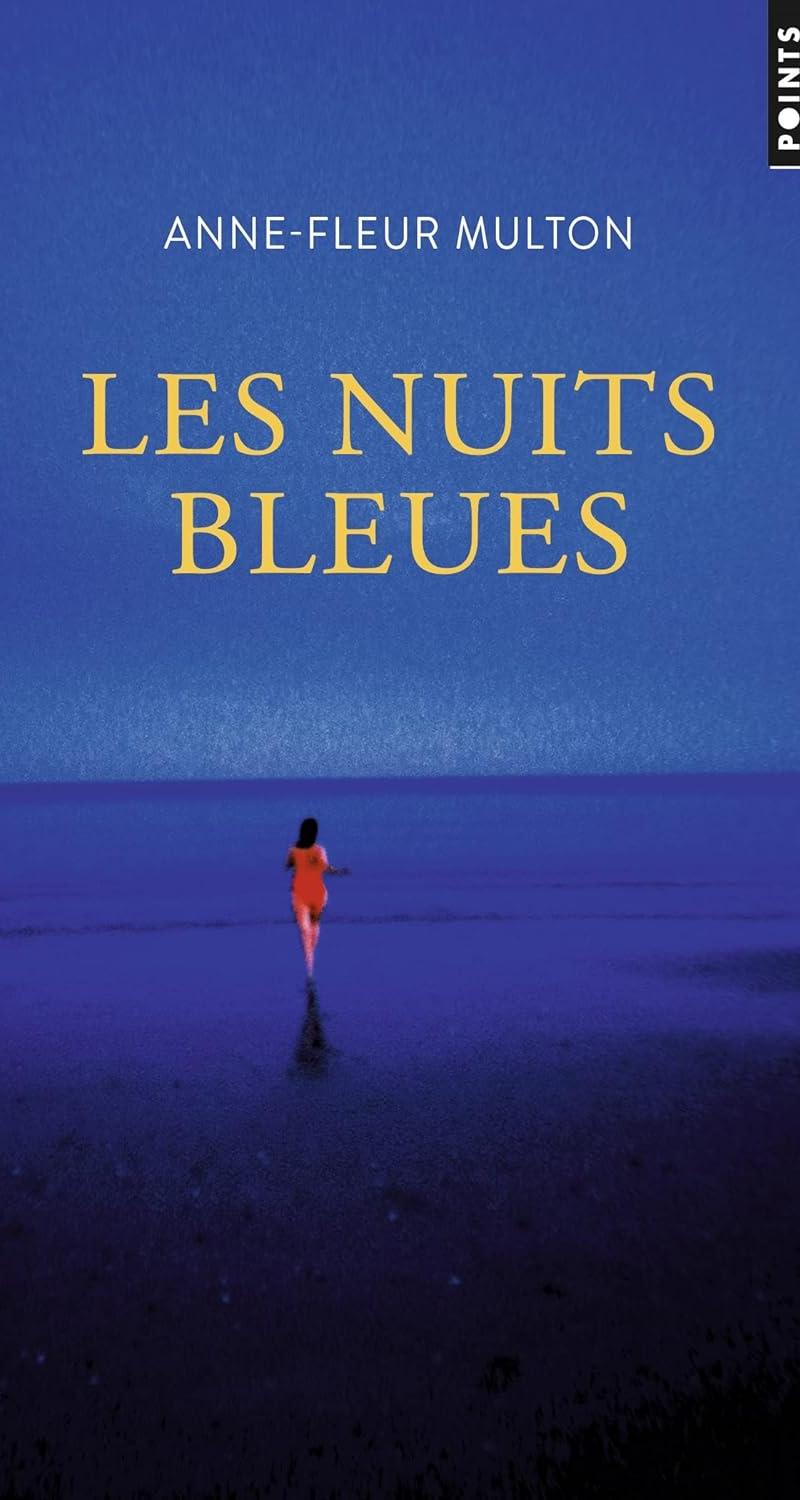
Après tout, c’est bien le printemps qui débute et le ventre qui cogne de se préparer au trouble d’aimer. Où s’accumulent les images de la rencontre, de l’amour, du désir. Haïr Montparnasse quand l’être aimée s’en va dans sa Bretagne natale, vous quitte pour un ciel côtier, rêver crêpes et cidre et se faire femme de marin, haïr les gares qui séparent et les solitudes d’être celui ou celle qui demeure dans la nuit où l’amour a eu lieu, admirer dans les draps l’odeur d’une rencontre, rêver à la suivante et faire de l’attente un supplice comme un délice car déjà « tous les jours te ressemblent ».
« Il faudra bien que tu t’avances… »
Dans un monde que l’on connaît trop bien, d’avant ou d’après, fait de rues vides, de casseroles aux fenêtres et de distances de dupe, il aura bien fallu ménager une scène à l’amour. Voilà précisément où se jouent la rencontre amoureuse et l’exploration du désir dans le roman d’Anne-Fleur Multon. Et nous fait même le bonheur de ne pas prononcer le mot honni de Covid, parce qu’ici tout n’est que bulle, tumulte et soif. Ou comment s’aimer dans les confinements où tricher, mentir et jouer, s’offrir un peu de romanesque pour asseoir les ponts du désir et les points indéterminés du besoin de se trouver. S’imaginer à deux dans les rues interdites. S’offrir la nuit à laquelle l’on n’a plus accès et fracturer les distances pour mieux rejoindre l’autre. Car en effet, si « Dehors, le monde [est] immobile » dans cet intérieur de l’amour, un monde infini s’ouvre au sein duquel il faut apprendre à construire la langue commune qui donne forme au désir, qui l’incarne et le perpétue, rêver à des draps où se silhouettent les corps à la conquête d’une pudeur de la cohabitation. Parce que s’aimer à distance c’est déjà vivre ensemble pour qui veut vivre l’amour. C’est faire l’épreuve précipitée d’un espace commun du désir, obligé par les circonstances.
Ce texte, d’une justesse précieuse et d’une fantaisie adorable nous plonge donc dans le discours amoureux de qui s’amourache de Sara, mais s’amourache avec force et passion, s’amourache pour aimer vrai, d’un amour qui prend racine et se construit d’abord – après le hasard d’une rencontre – à distance. Parce que l’amour à distance commence par les écrans, les images, les messages, l’attente. Et là une construction foisonnante où le lecteur s’ouvre aux SMS, aux pensées, aux narrations qui le plongent à toute allure dans l’urgence de s’aimer et dans l’instantanéité du désir.
« Il faut que je te raconte, il m’arrive un truc. »
Longtemps se découvrir sans même se connaître et pourtant s’attacher à ce qui se joue dans une intimité désincarnée. Et peut-être d’ailleurs est-ce cette désincarnation primitive qui stimule le besoin impérieux d’une incarnation manifeste, immédiate, intransigeante, totale.
J’ai rencontré quelqu’un, quelqu’un que je ne connais pas encore mais que j’aime déjà et dans ce cœur en commun qui se précipite je voudrais dévorer la naissance de l’amour, courir à l’incarnation d’une intuition de l’autre. Voilà ce qu’il y aurait à raconter, tout en manoeuvrant les difficultés de la distance comme ses réjouissances. Longtemps se découvrir sans même se connaître et pourtant s’attacher à ce qui se joue dans une intimité désincarnée. Et peut-être d’ailleurs est-ce cette désincarnation primitive qui stimule le besoin impérieux d’une incarnation manifeste, immédiate, intransigeante, totale. Parce que ces amours-là sont des amours qui ne cessent de se rêver et de s’impatienter de la peau, de la matérialité absolue. Et des amours qui ouvrent à une rêverie intempestive.
« que tu la désires que tu hausses les sourcils amusée de sa bêtise que simplement tu penses à elle
et dans la pluie d’attention elle a cherché la tienne
au milieu des autres dont elle se foutait un peut-être soudain
un cœur de toi
elle ne se trouve même pas ridicule de l’avoir attendu espéré de l’avoir eu en tête avant même de plonger
un cœur de toi
la récompense valait bien le risque de l’amende »
« …si tu veux combler la distance, entre nous »
Alors, il faut faire avec la distance. Avec ce qui sépare et ce qui rapproche et c’est bien la parole d’une projection qui vient déjà susciter le désir, assumer son fantasme comme une promesse. Car dans la distance, énoncer le désir c’est conjurer son impossibilité immédiate, faire étinceler sa puissance, abattre l’éloignement comme l’on retire l’épée entre Tristan et Iseult : « Si j’étais avec toi là je passerais mes lèvres sur les tiennes, tout doucement ». C’est ainsi que s’enchainent les épiphanies d’une possible présence – fantasmée d’abord – de l’autre.
« Et alors je crois que je respirerais un peu fort tellement je serais pleine du désir de toi, de ta peau intime et je verrais dans tes yeux que tu me veux ».
Rêver le corps d’autrui et le faire danser contre le notre, accumuler les motifs du désir, les scènes imaginées, le goût des peaux et des bouches, et exciter dans l’attente ce qui comblera la distance, géographique comme temporelle, jouer avec l’irrémédiable indépassable :
« Délice d’imaginer l’autre attendre la réponse, c’est son tour le supplice
Délice de lire ce matin le désir caché dans la question
qui est au fond la même
que celle qu’on a coincé dans le bas-ventre. »
Car il ne faut pas s’y tromper, si le roman laissera enfin une part belle à l’exploration de la rencontre et à ses poursuites, il n’occulte pas le paradoxe d’une absence lourde que les amantes cherchent à tout prix à compenser par l’omniprésence virtuelle, écranique comme fantasmagorique, sorte d’imprésénce permanente de l’autre, présence fantomatique, qui creuse, nourrit et excite le besoin de l’autre, inconnue-trop-connue, avenir désirable et encore désincarné. Et si « C’est l’absence peut-être qui nous rend folles, plus folles que si on avait pu se voir vite », c’est pour qu’en qu’enfin éclate la pulsion qui rogne le ventre, qui crépite sous les doigts, au moment de la rencontre :
« Le sexe trempé
Remplies du désir de l’autre
On jouit
ensemble »
« Rencontre. […] Le premier ravissement »
La rencontre se joue allègrement des atermoiements énamourés, d’une pudeur et d’une inquiétude touchantes, où s’accumulent nos propres angoisses, confrontées aux fantasmes construits et à l’histoire intime.
« Et si,
je ne te plais pas
c’est gênant
on ne sait comment se saluer
je me perds et je ne trouve pas ton appartement
tu me fais la bise
tu es déçue
je n’arrive pas à mouiller »
Parce qu’après tout, tomber amoureux, vraiment, sans s’en rendre compte, laisser s’échapper les trois mots qui surgissent, se glisser dans le vertige qui nous surprend nous-même, c’est toujours rejouer une pureté de l’amour, délestée de l’histoire, rejouer la nudité de sa propre émotion, ouvrir sa fragilité heureuse, pétrie de crainte et plus vivante que jamais :
« J’ai l’impression d’être la première.
La première du monde à aimer. »
Rejouer encore la maladresse adolescente, rougir d’une jeunesse déjà passée, bégayer quelques mots, effleurer la joue d’un visage que l’on voudrait terriblement embrasser, …
Rejouer encore la maladresse adolescente, rougir d’une jeunesse déjà passée, bégayer quelques mots, effleurer la joue d’un visage que l’on voudrait terriblement embrasser, découvrir ce regard qui se pose sur nous et nous déjoue, chercher la coïncidence de l’être fantasmé et construit dans une communication vive et fournie mais virtuelle et cette chair qui prend forme, s’incarne, marche, en mouvement : « on a une soif de la peau de l’autre de ses replis de ses secrets de son poids même », une soif intarissable de dévorer l’incarnation tant attendue, une insatiété de l’autre.
Et derrière les craintes et la panique, l’épiphanie du vu qui s’élève et nous prend, là où le trouble quitte l’angoisse pour rejoindre la joie souriante :
« Et moi je voyais enfin
ton épaule
ta nuque
tes cuisses
en mouvement
Toi qui n’es plus en fragments
Toi entière devant mes yeux »
Comme l’intuition d’une évidence
« Parfois un éclair de lucidité entre nous on sait que c’est rare,
qu’on s’est trouvées,
que ce n’est pas comme ça
avec tout le monde. »
Le ravissement de la première rencontre, comme dirait Barthes, car ce qui ravit est toujours un rapt à soi-même et un étourdissement lumineux.
« Et moi, l’œsophage serré,
le coeur serré,
moi envahie transpercée de sa présence trop douce de sa présence trop bonne
envahie
transpercée
débordée je dis
je dis
Je t’aime
Je t’aime Sara »
Parce que s’aimer devrait toujours être un refuge, le lieu où s’effondrent l’orgueil et l’ego, l’espace commun d’une nudité en partage et d’une sensibilité offerte. S’aimer un refuge où revenir et se reconnaître soi-même, similaire et autre :
« elle dit
Ton odeur de cou c’est ce qui m’a manqué, j’ai eu des nuits agitées, ici je mets ma tête dans ton cou et c’est déjà le sommeil, c’est la maison, c’est la sécurité, la tête dans ton cou, ta nuque, la peau tendre pour se blottir ».
Épopée amoureuse et effrénée, portée par la fougue et la soif d’aimer à nouveau, le roman d’Anne-Fleur Multon rejoue la tombée en amour quand la distance force le fantasme et qu’enfin le fantasme se soumet au réel et rêve la vie à deux, où trouver la douceur d’un cou-refuge et sourire de son propre ravissement ému.
Bibliographie :
- Multon, Anne-Fleur, Les Nuits bleues, éditions de L’Observatoire, 2022.

















