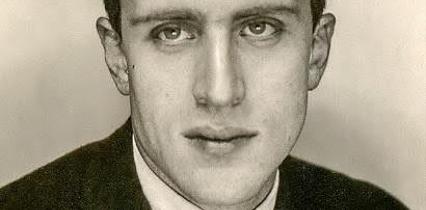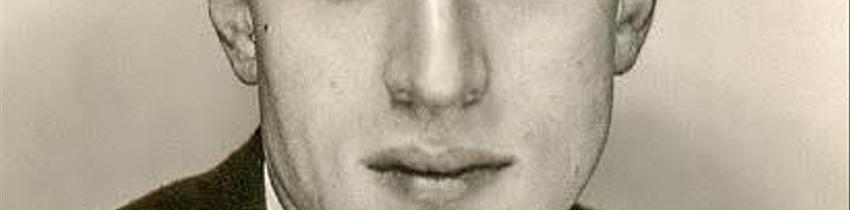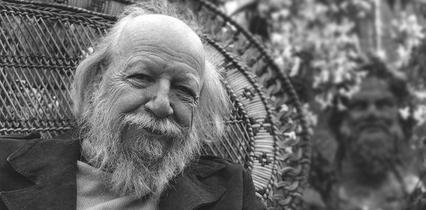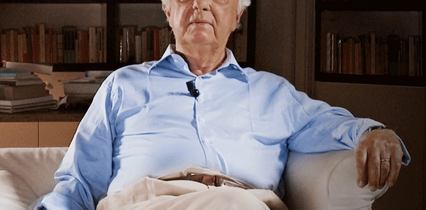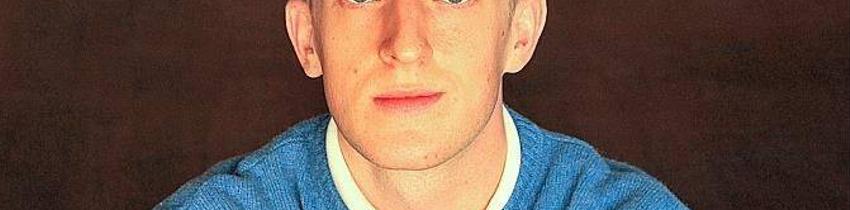Dans les cinq parties de L’inventaire des rêves, traduit par Blandine Longre, Chimamanda Ngozi Adichie navigue entre les décennies, entre l’Afrique et l’Amérique, ses quatre héroïnes semblables à des « feuille[s] sèche[s] pourchassée[s] par le vent » – l’harmattan, sans doute.
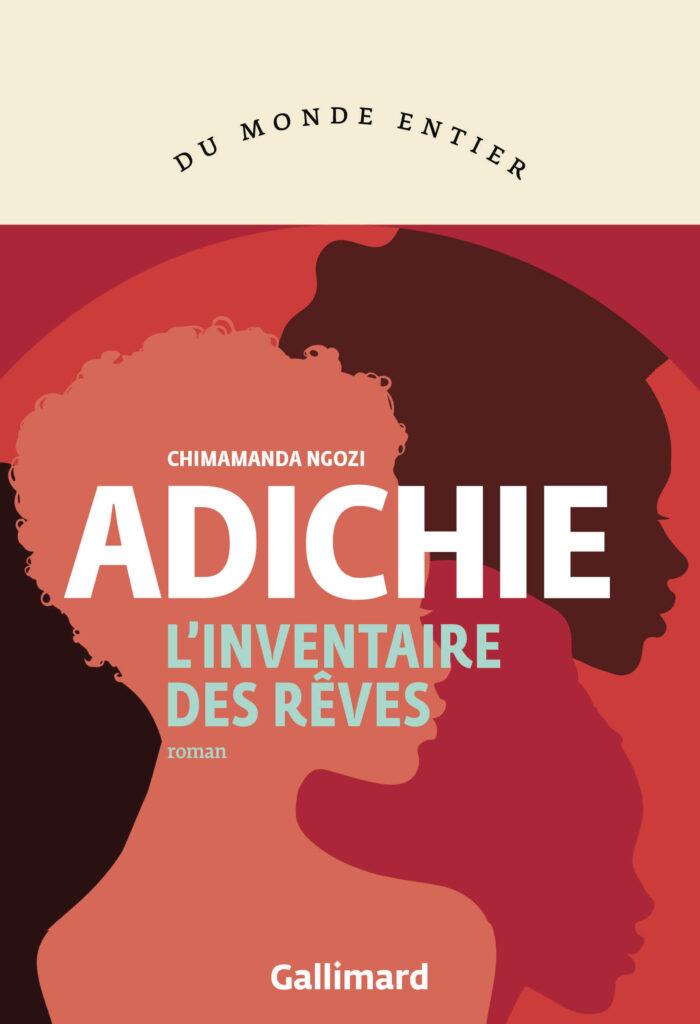
Zikora et Chiamaka, deux amies, vivent aux États-Unis. Elles se sont rencontrées au Nigeria, dans un lycée que fréquentait également la cousine de Chia, Omelogor. Celle-ci est restée sur sa terre natale, changeant simplement de région, ce qui équivaut pourtant pour elle à un inconfortable déracinement – elle aussi a foulé la terre étoilée mais en a fui dès qu’elle a pu, le vent mauvais qui y soufflait distillant en elle les germes de la dépression. Toutes trois sont igbos et viennent de l’État d’Anambra, comme Chimamanda Ngozi Adichie – Omelogor et Chia s’expriment d’ailleurs à la première personne, laissant présumer une part d’autofiction. La quatrième protagoniste, Kadiatou, est née en Guinée. Elle y a grandi, s’y est mariée, y a donné naissance, y a souffert, encore et toujours – et elle est partie. Les États-Unis sont pour elle un refuge, pays de toutes les promesses, de tous les rêves, aussi humbles soient-ils. Si son histoire est née de l’imagination de l’autrice, les revers qu’elle subit ont été inspirés par ceux vécus par Nafissatou Diallo, la femme de chambre qui a accusé Dominique Strauss-Kahn de violences sexuelles. Tandis que les charges ont été abandonnées à cause d’inexactitudes dans la demande d’asile de Nafissatou Diallo, Chimamanda Ngozi Adichie prend soin de souligner l’importance du souvenir, le rôle que peut jouer la littérature en tant que garante d’une certaine justice et porte-voix d’une certaine parole.
« L’élan créatif peut être insufflé par le désir de redresser un tort, même très indirectement. Dans ce cas précis, de redresser, au moyen de l’écriture, l’équilibre des récits. »
Misandrie à peine voilée
Le corps de Kadiatou est donc profané par un homme – par plusieurs, en réalité –, mais là n’est pas la seule exaction que le sexe soi-disant fort commet dans ce livre. L’autrice fait de presque tous ses personnages masculins des présences absentes ou décevantes, souvent menaçantes, qu’elles soient là où non. Aucun n’est une épaule, mais quasiment tous sont sources de tracas, de chagrins, de douleurs.
“Ses héroïnes aiment, accouchent, allaitent, avortent, saignent, sont recousues, excisées, opérées, examinées, violées – leur chair vit, subit plus qu’elle ne jouit, sans fausse pudeur, mais sans crudité.”
Chia est amoureuse de l’idée de l’amour, qu’elle comprend « de manière rêveuse » elle attend le prince charmant, pas tout à fait consciente qu’il ne s’agit bien que d’un fantasme. Première et dernière narratrice de ce livre en cinq parties, elle se remémore ses peines de cœur, reconvoque les silhouettes qui ont compté plus qu’elles n’auraient dû, rappelle les mesquineries et les attentes vaines, les humiliations – inventaire des rêves qui t...