
L’écrivain Christian Oster, auteur de 16 romans parmi lesquels le très remarqué Mon grand appartement, nous est revenu en cette dernière rentrée littéraire avec un très joli livre, En ville, qui a raflé le prix Landerneau du meilleur roman le 12 février dernier. L’occasion pour Zone Critique de se pencher sur les errances de la “multitude solitaire” que met en scène l’auteur.
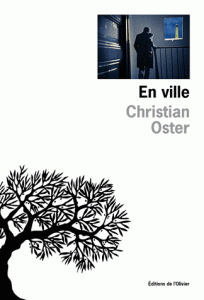
Voilà un groupe de cinq amis, qui part en vacances ensemble depuis trois ans. La cinquantaine, voire la soixantaine, parisiens, assez bobos, sans enfants, Jean, l’éditeur, Georges, le journaliste, William, le retraité en surpoids, Paul, le médecin, et sa femme Louise, la restauratrice de meubles, se sont trouvés un peu par hasard, aux portes de la vieillesse, et se sont habitués les uns aux autres. Au début du roman, ils se réunissent chez Louise et Paul, pour dîner et décider de leur prochaine destination de vacances, la Grèce, pourquoi pas l’Italie ?
Tout est comme d’habitude, mais plus pour longtemps. Georges, qui vient d’être quitté par Christine, va tomber amoureux d’une étourdissante agente immobilière, Sam ; William, qui vit en face d’un hôpital, va être victime d’une embolie pulmonaire, qui l’emportera bientôt ; Paul et Louise décideront de se séparer, mais pas avant la fin des vacances ; enfin, Jean, le narrateur, apprendra qu’il attend un enfant de Roberta Giraud, une femme plus jeune qu’il n’aime pas, et à laquelle il n’aura cédé que par ennui et par paresse. Le projet d’un départ n’en sera pas moins maintenu, dont ils ne parleront plus qu’avec gêne et appréhension.
Ici, l’on se demande un instant si, par le plus grand des malheurs, Marc Levy a adapté sous pseudonyme Les petits mouchoirs de Guillaume Canet en livre. Fort heureusement pour le lecteur, son portefeuille et, surtout, le bien-être de la littérature française, il n’en est rien. Christian Oster (prix Médicis 1999 pour Mon grand appartement, aux Éditions de Minuit), dont En ville est le seizième roman, signe une chronique urbaine sombre et angoissée, aux personnages aussi troubles qu’insaisissables, aussi insignifiants que très envahissants. Il les saisit au moment précis ou leur vie, leurs certitudes et leurs repères basculent, et les suit, comme autant de fils d’Ariane, jusqu’au dénouement final, tragique de banalité.
« Raconte-moi comment tu vas depuis la dernière fois. »
Dès les premières pages, il apparait que sous le vernis de leur amitié, les personnages ne se connaissent pratiquement pas. Ils ne savent pas grand-chose de leurs vies personnelles et professionnelles, ne s’informent que du minimum exigible, ne savent pas où habitent les uns et les autres et, quand ils le savent, n’y sont jamais allés ; ils ne se rencontrent que dans des lieux publics, ou chez Louise et Paul, qui s’imposent comme le centre de gravité du groupe.
Leurs conversations sont aussi banales que dénuées de saveur ; faites davantage de silences, de petites méfiances que de confidences. Avant le malaise de William, le groupe ne sait même pas que celui-ci a un fils, qu’il ne rencontrera qu’au chevet de son père : « (…) il nous apprenait qu’il en avait un, mais nous avons dû faire comme si, évidemment, nous le savions déjà, eu égard à Bastien, qui devait seulement penser qu’on nous le présentait. De sorte que nous avons réagi sobrement, alors que nous étions très surpris et que, pour ce qui me concernait, j’éprouvais fugitivement la sensation, quand William en sortait, d’entrer de plain-pied dans le non-dit. »
Ils parlent peu et de pas grand-chose, de leurs sexualités déprimées, de leurs sentiments étranglés, mais de l’important, presque jamais, et toujours trop peu ou trop mal
Le non-dit, justement. Même parvenus à cet âge cardinal où l’on tend à s’épancher, par crainte du tarissement de l’émotion et de la mémoire, ils parlent peu et de pas grand-chose, de leurs sexualités déprimées, de leurs sentiments étranglés, mais de l’important, presque jamais, et toujours trop peu ou trop mal. L’auteur décrit un quotidien où règne la dissimulation, et tout cela est assez déprimant, finalement. En cela, ce roman est réussi, car l’auteur parvient à mon-trer nue la profonde solitude qui habite le citadin ; nous vivons de plus en plus nombreux dans les grandes villes, les moyens de communications sont de plus en plus évolués et diversifiés mais, en comparaison, nous sommes de plus en plus seuls ; nous nous voyons, certes, mais nous ne nous rencontrons plus ; la vie urbaine nous a rendus, comme les personnages d’Oster, égoïstes, égocentriques, inaptes au bonheur simple. La ville est une prison dont ils sont les cellules, et si la perspective d’une évasion plane sur l’ensemble du récit, l’on ne la quitte vraiment jamais – à l’exception d’une escapade en RER – et les personnages sont à l’image de celle-ci, ils sont des illusions de grandeur et de liberté quand, au vrai, ils demeurent cernés dans leur périphérique étriqué.
« Quant à moi, je suis resté froid. »
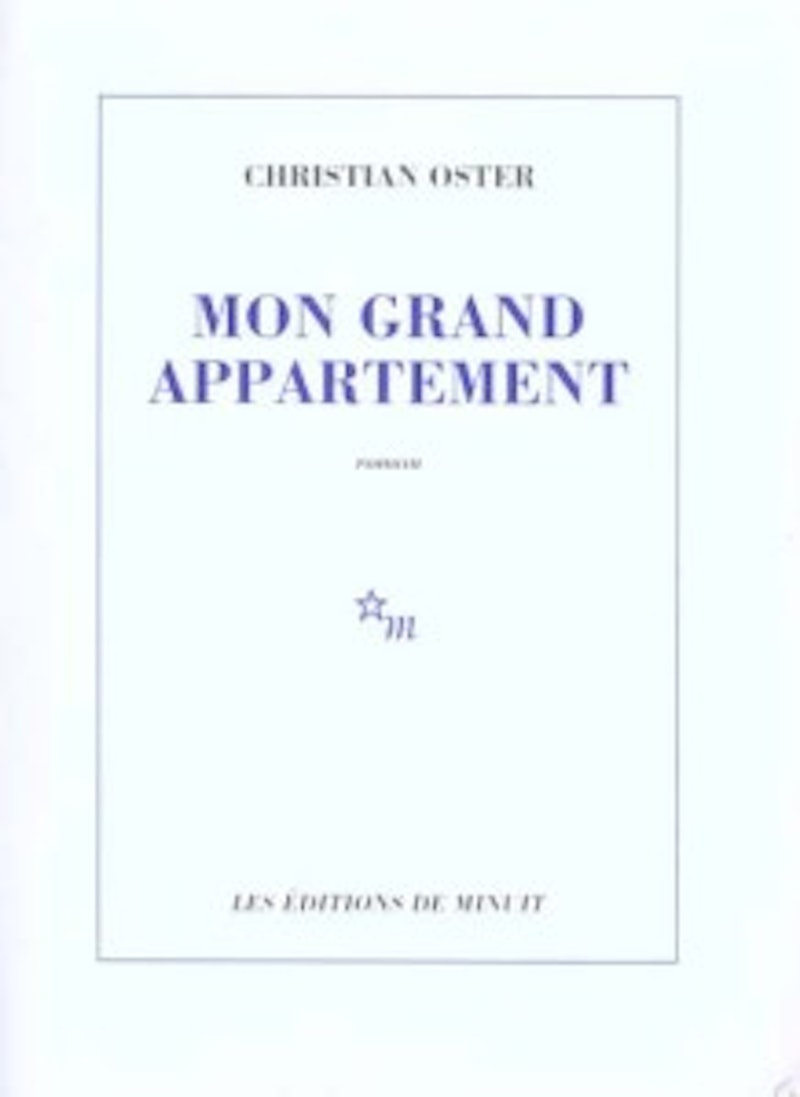
Peu d’écrivains dans le paysage littéraire français excellent autant que Christian Oster dans l’art de disséquer le moindre état d’âme des personnages, avec une précision somme toute chirurgicale. Seule Christine Montalbetti (auteure entre autres du bouleversant L’évaporation de l’oncle, P.O.L, 2011) démontre une virtuosité au moins équivalente dans la description lente, précise et ramifiée du tout, du rien, du n’importe quoi et du pas grand-chose.
Cependant, là où celle-ci n’hésite jamais à convoquer le lyrisme le plus exalté, Oster demeure froid et mesuré. L’on a l’impression, parfois – souvent, à dire le vrai – , de lire un long procès verbal de police, comme s’il s’interdisait le moindre accès d’onirisme. Certes, il y succombe par moments, comme dans cette description enlevée de la visite du nouvel appartement de Jean, conduite par Sam : « Au gré de ses déplacements, elle brouillait nos appréciations, anéantissait toute appréhension sensée de la surface habitable, ouvrait les fenêtres comme si elle allait s’y envoler. » Mais ce n’est que pour mieux tuer cet élan dès la page suivante : « Puis je l’ai entendu [Georges] demander à Sam ce qu’il en était des charges (…) Ça m’a paru trivial, même duplicable à quelques centaines d’exemplaires, Sam méritait mieux que ça. Surtout, Georges parvenait à la banaliser, ce qui me désolait, même pour lui. (…) Elle avait beau s’être contentée de répondre et de faire son métier, elle avait répondu, et à mes yeux c’en était à peu près fini d’elle, qui ne pouvait pas ne pas avoir conscience de la préméditation de Georges et qui, louvoyant pour s’y soustraire, voire pour s’y soumettre, venait d’adopter une pose certes professionnelle, mais dévalorisante. Ça ne collait plus. (…) »
Une autre prouesse de l’auteur est d’être parvenu à faire coller son style au plus près de la personnalité contemplative et autocentrée de Jean, un style que d’aucuns pourraient, du reste, taxer de nombriliste – quand Jean apprend par exemple la grossesse de Roberta Giraud, la seule chose qu’il se dit est qu’elle « était toujours blonde, avec les mêmes seins pour l’instant. » L’on pourrait même pousser la perfidie jusqu’à dire qu’un tel roman ne pourrait être écrit que par un parisien, sur des parisiens et pour des parisiens.
Si vous n’êtes en rien gênés qu’un auteur consacre plusieurs pages aux tribulations d’une boîte à gâteau dans un ascenseur, ce roman est pour vous
La phrase d’Oster est ample, détaillée, souvent interminable ; le fait que les dialogues soient directement intégrés au corps du texte peut en dérouter plus d’un ; mais si, comme votre serviteur, vous n’êtes en rien gênés qu’un auteur consacre plusieurs pages aux tribulations d’un homme et d’une boîte à gâteau dans un ascenseur, ce roman est pour vous ; si en revanche vous goûtez peu les tétracapillisécations, un conseil : fuyez et ne vous retournez pas.
L’on pourra regretter aussi un certain manque de poésie, qui plonge le roman dans un climat général de froideur – mais, après tout, c’est peut-être là aussi une autre de ses forces, car cette écriture lyophilisée agit comme un miroir, qui nous renvoie, à nous autres des grandes villes, l’insoutenable spectacle de notre propre déshumanisation.
Christian Oster,En ville, Editions de l’Olivier, 180 pages, 18 euros.
Yann Solle
Si vous avez aimé cet article:

















