
C’est Paul Morand qui l’affirme : « L’histoire, comme une idiote, mécaniquement se répète. » Rien n’est plus vrai, il suffit d’observer la rentrée littéraire. Chaque année, fin août, c’est la même histoire. Avec la régularité d’un catéchumène fraîchement converti, la rentrée littéraire dépose sur les étagères de nos libraires le premier effort d’un jeune romancier inconnu au bataillon, télégénique de préférence, que l’on nous vend ensuite à grand renfort de dithyrambes et de superlatifs.
Bernard Grasset, où qu’il se trouve, doit s’en sentir flatté, lui qui a pratiquement inventé tous les principes du marketing littéraire moderne : tirages conséquents, promotion ravageuse, services de presse mieux organisés qu’un régiment de l’armée de terre, intelligences diverses et variées avec les critiques…Chaque année donc, c’est la même histoire, l’automne dépossède les arbres de leurs feuillages et les éditeurs parisiens s’affrontent sans merci dans la course au titre de celui qui fera le plus beau coup médiatique de la saison. Parfois pour le meilleur, souvent pour le pire. À la rentrée passée, Grasset remportait une victoire sans appel dans la grande guerre du buzz avec l’extraordinaire Marien Defalvard. Cette année, Gallimard tient sa revanche avec le très photogénique Aurélien Bellanger.
La Théorie de l’information est incontestablement le livre dont on a le plus parlé cet automne. Les faveurs de l’actualité, sans doute, car on le dit largement inspiré de la vie de Xavier Niel, patron de Free, qui venait de réaliser un des plus gros coups marketing de l’histoire de la téléphonie française avec Free Mobile. Au même moment, le minitel, largement évoqué dans l’histoire, tirait sa révérence. De là à ce qu’il fût qualifié avant même sa sortie de meilleur roman de la rentrée par une critique extatique (assertion aussi outrancière que contestable par ailleurs, car 640 romans sont sortis cette année, et on peut raisonnablement douter qu’ils aient tous été lus dans les rédactions), il n’y avait qu’un pas qui fut allègrement franchi ; je suis pour ma part très loin de partager cet enthousiasme.
Mais peut-être faut-il d’abord dire un mot de l’auteur. En consultant sa page Wikipédia, on apprend qu’Aurélien Bellanger a trente-deux ans, qu’il a étudié la philosophie à l’École des hautes études en sciences sociales, où il a commencé puis abandonné une thèse au titre singulièrement houellebecquien : La métaphysique des individus possibles, avant de devenir libraire dans le cinquième arrondissement de Paris. Contrairement à ce que j’ai pu laisser entendre plus haut, il n’est pas nécessairement inconnu au bataillon, puisqu’il a publié, il y a deux ans, un essai très remarqué : «Houellebecq, écrivain romantique» (Léo Scheer).
Je dois avouer ici et maintenant qu’un écrivain qui consacre deux cent pages et quelques à hisser Michel Houellebecq au pinacle ne pouvait d’emblée que me paraître suspect. Mais il en est de la littérature comme de la vie : il faut apprendre à se méfier des idées préconçues, elles empêchent parfois de découvrir des trésors. D’ailleurs, un ami m’avait offert le roman, que j’ai donc lu avec d’autant plus de distance que je n’aurais eu, le cas échéant, rien d’autre à regretter que mon temps.
C’est l’histoire de Pascal Ertanger que l’auteur se propose de nous conter, et le moins que l’on puisse dire, c’est que les choses commencent assez mal pour lui. Il est coincé dans une adolescence ennuyeuse à Vélizy-Villacoublay, dans les Yvelines (est-ce un hasard si l’auteur situe le début de l’action dans une commune qui a reçu le label Ville Internet – @@@ ?) Il est l’archétype du geek effarouché, égaré dans sa peau, dans sa famille, dans son lycée. Il ne comprend pas la société et la société ne le comprend pas. Wilde dirait de lui qu’il se contente d’exister. Ce nom d’ailleurs, Ertanger. On ne peut s’empêcher de penser à l’Étranger de Camus, car Pascal est étranger à tout, à sa propre vie surtout. Un ordinateur le tirera de ces limbes, un Sinclair ZX81 plus précisément. Pascal se révèle en génie de l’informatique ; et cela va plus loin encore : il entretient avec les machines un rapport organique, presque charnel. Quand Pascal programme, il vient à la vie. Que le reste de sa vie soit alors consacrée à l’informatique ne relève pas d’un choix. Deux options s’offrent à lui : programmer ou mourir. Il programmera.
Il commence à bâtir son empire dans le Minitel rose. 3615 TURLU, 3615 CHAUDE, 3615 EROTIK, ça ne mange pas de pain. À mesure que son succès grandit, il gagne en assurance et en cynisme : « Les lycéennes avaient été un coup de maître : elles avaient donné à CHAUDE une connotation littéraire terriblement sexy. Mais, il l’avait expérimenté le soir de la fête, c’étaient des filles assez limitées. Elles déliraient bien et construisaient des fantasmes solides, mais s’étendait trop sur les préliminaires. On sentait qu’elles manquaient de pratique. Ils allaient dorénavant recruter des filles dans des sex-shops et des boîtes de strip-tease. »
Le minitel a fait de Pascal un millionnaire à Porsche. Internet en fera un milliardaire à manoir. Doté d’un flair certain, d’une approche utilitariste des relations humaines et d’un sens moral opportunément congru (par exemple il n’hésitera pas à s’associer avec un proxénète de la rue Saint-Denis), Pascal va au fil des années se transformer en véritable prédateur économique. Il créera Ithaque (comprendre Iliad) et Démon (comprendre Free), qui sera le caillou dans le soulier de « l’ogre monopolistique » France Télécom.
Dévoré par l’ambition et la soif de reconnaissance, il devient un des hommes les plus riches de la planète. Ses dernières paroles seront d’ailleurs : « J’ai réussi. » Le petit Pascal Ertanger de Vélizy-Villacoublay a pris sa revanche sur le monde. Il le marquera de son empreinte d’une manière dont lui-même n’aurait jamais osé rêver. Mais le succès, à cette échelle, a toujours un prix, celui de la solitude. Pascal n’y échappera pas : « Il découvrit d’abord Chatroulette, un chat vidéo inventé par un jeune russe, qui permettait, peut-être pour la première fois, de communiquer réellement avec le monde entier, grâce au mode de sélection aléatoire des interlocuteurs (…) Il se faisait néanmoins invariablement nexter au bout de quelques secondes, sa présence, alors qu’il avait largement dépassé l’âge moyen des usagers du site, était perçue comme malsaine, d’autant qu’il restait silencieux et manifestait quelque chose de triste, voire de suppliant. » Et cette solitude le conduira à des actes qui pourraient bien avoir des conséquences dramatiques pour l’humanité (voir pour cela les dernières pages, assez glaçantes).

La Théorie de l’information c’est donc d’abord la success-story d’un misfit qui se forge, à force d’audace, une destinée légendaire. Mais il n’est pas question que de cela. L’auteur retrace avec brio sept décennies de l’histoire de l’économie numérique en France, ses succès et ses errances. C’est sans doute pour cela qu’il a eu l’idée peu originale mais pleine de bon sens de diviser son livre en trois parties : « Minitel », « Internet » et « 2.0 ». Ses chapitres sont entrecoupés de courts exposés scientifiques intitulés «steampunk» dans la première partie, «cyberpunk» dans la seconde et«biopunk» dans la dernière, qui retracent l’évolution des nouvelles technologies depuis la thermodynamique à nos jours, et se veulent autant une présentation qu’un approfondissement, fort captivant par ailleurs, de la «Théorie de l’information» de Claude Shannon.
Ambitieux, ce livre l’est donc à bien des égards. Mais s’il a pour lui un intérêt documentaire certain, son intérêt stylistique, lui, est malheureusement proche du néant. C’est à dessein que je faisais plus haut référence à Wikipédia. Bellanger tient sa plume avec tant de platitude et de prévisibilité qu’on a l’impression persistante de lire un empilement de pages de l’encyclopédie collaborative. Il reconnait même y avoir eu largement recours pour débloquer le processus d’écriture. Utiliser Wikipédia, pourquoi pas, ça n’est pas un crime et nous le faisons tous. Mais faire le choix d’écrire près de 500 pages en style Wikipédia, c’est prendre le risque de produire un monument d’ennui.
Plus grave, on ne ressent dans cette écriture aucun plaisir, aucun désir même d’écrire, comme si l’auteur essayait péniblement d’étirer une de ses dissertations de l’École des hautes études en sciences sociales sur des centaines de pages. À l’arrivée on a un pensum sociologique assez indigeste, qui bascule, par moments, dans une franche infatuation. Il n’est que de voir les citations dont l’auteur a cru bon de coiffer tous ses chapitres.
Certaines laissent songeur (Warren Buffet, en tête du vingt-sixième chapitre) ; d’autres sont franchement dispensables (Paul-Loup Sulitzer (!), en tête du premier chapitre) ; les autres sans intérêt. Certains auront vu dans ce style froid, factuel et machinal la marque d’une certaine poésie. Restons prosaïques : le but premier de la poésie est de susciter une émotion, et d’émotion, je n’ai trouvé nulle trace dans ce livre. En 34 chapitres, voici l’extrait le plus incarné que l’on puisse proposer : « Pascal ne supportait pas que des hommes aient pu avoir Émilie pour de l’argent. L’idée qu’il existe des films d’elle en circulation lui était également douloureuse. Il ne pouvait la voir autrement que comme un être vulnérable et pur, qu’on s’était acharné à salir. Plus Émilie lui racontait les détails de sa vie passée, plus Pascal l’aimait. » Ah, avais-je oublié de signaler que ce livre est aussi un chapelet sans fin de clichés ?
La place du style dans un livre est, je crois, affaire de préférence ; j’en fais très grand cas. On ne fait pas forcément un bon roman avec une bonne histoire, mais on fait nécessairement un bon roman avec de bons mots. Parce qu’il y a toujours, me semble-t-il, deux histoires dans un roman. Celle de la narration, bien sûr, le héros, sa vie, son œuvre, ses tribulations. Mais aussi celle que nous racontent les mots, quand ils se détachent de l’action et vont vivre leur vie propre indépendamment d’elle. Le roman est une guerre sans merci entre l’histoire et les mots, tout l’enjeu est de savoir qui l’emportera sur l’autre. Seulement, quand les mots sont aussi faibles et insignifiants que ceux d’un catalogue de vente IKÉA, la bataille est gagnée d’avance par l’histoire. À titre personnel, je n’aime pas venir au secours de la victoire.
Pâle victoire, du reste, car on l’impression que l’histoire elle-même n’est qu’un alibi à l’étalement d’informations ; très vite, elle perd tout intérêt. La psychologie des personnages n’est certes pas le souci premier de Bellanger (d’ailleurs, il méprise sans réserves le nouveau roman, courant psychologisant s’il en est), mais dès le deuxième tiers du livre, Pascal Ertanger perd graduellement en consistance, jusqu’à devenir, dans la dernière partie, franchement évanescent. En général, quand après 200 pages on n’en a plus rien à faire de qu’il adviendra du protagoniste, ce n’est jamais très bon signe. Le dernier sursaut d’intérêt est consommé quand on apprend, sur la fin, que Pascal Ertanger rédige un manifeste intitulé, je vous le donne en mille, « La Théorie de l’information ». Et tout cela se réclame de Balzac et de Houellebecq. La vérité est que même Houellebecq ne mérite pas une telle comparaison. Balzac, n’en parlons même pas. Elle est aussi qu’il faut détromper Paul Brulat : il ne suffit pas d’avoir quelque chose à dire pour bien écrire.
Certains ont pu se demander si ce livre était réellement une œuvre de littérature ; je n’ai pas de doute qu’il le soit. La littérature ne se résume pas aux œuvres de fiction. Quelques uns des monuments de la littérature française n’en sont pas (ex. : les Mémoires d’outre-tombe de Châteaubriand). D’autres, présentées comme telles, s’inspirent largement d’évènements et de personnes réels (ex. : l’Histoire amoureuse des Gaules de Bussy-Rabutin). Ce qui caractérise vraiment la littérature, c’est une recherche stylistique dans l’écriture ou dans la construction narrative. La Théorie de l’information remplit au moins un des deux critères.
On peut en revanche se demander s’il s’agit bien d’un roman, et on éprouve quelque difficulté à le qualifier ainsi. Il est vrai qu’on a aujourd’hui un brouillage des lignes avec de plus en plus de livres qui n’intègrent qu’une part négligeable de fiction mais sont tout de même estampillés « romans », car enfin, cela est tout de même nettement plus vendeur qu’ « essai » ou « document ». Quelques exemples parmi tant d’autres : HHhH de Laurent Binet (Grasset), C’est une chose étrange à la fin que le monde de Jean d’Ormesson (Robert Laffont), ou, plus proche de nous, Rien ne s’oppose à la nuit de Delphine de Vigan (JC Lattès), trois « romans » remarquables par ailleurs. Nous sommes en présence de créatures hybrides, ni oiseau ni rat, chauve-souris donc. Ce ne sont pas vraiment des essais. Ce ne sont pas non plus des romans. Des essais romancés alors ? Ou des romans-essai ? La question n’a pas fini d’être posée. En tout état de cause, je n’ai aucun autre reproche à faire à ce genre de livres que celui d’être, parfois, des objets de marketing avant d’être des objets littéraires.
Ceci étant, la seule chose qui importe vraiment au lecteur lambda est de savoir si La Théorie de l’information est un livre plaisant. Pour qui recherche exclusivement une information sur les sujets traités, il ne fait aucun doute que c’est un livre fort recommandable. Pour les autres, il n’y aura, je le crains, aucun plaisir. Pas parce que le livre serait mal écrit. Tout le paradoxe de ce livre est qu’on ne peut même pas lui reprocher d’être mal écrit. Il n’est tout simplement pas écrit.
Aurélien Bellanger ouvre son livre par cette citation de Shannon : « I’m a better poet than scientist. » Je succomberai à une dernière facilité en affirmant que lui est bien meilleur scientifique que poète.
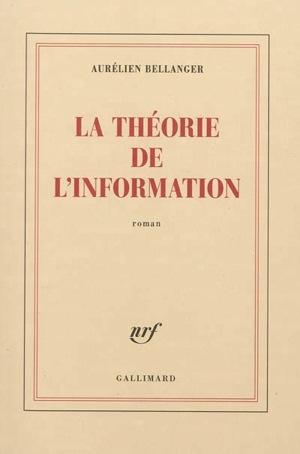
Yann Solle

















