Dix ans après la mort de sa mère, Youssef – professeur de français à Paris depuis plus de 20 ans – retourne à Salé, ville marocaine qui l’a vu grandir. Là-bas, il se retrouve confronté à ses souvenirs. Ceux d’une enfance homosexuelle et de toute la violence à laquelle elle a été confrontée, ceux d’une vie familiale remplie de femmes partagées entre traditions et refus de se conformer à certaines règles mais aussi ceux d’un amour de jeunesse dont le fantôme vient le hanter de nouveau. Dans ce nouveau roman d’Abdellah Taïa, Le bastion des larmes, paru aux éditions Julliard et pré-sélectionné pour le Goncourt 2024, nous voilà confrontés avec une certaine cruauté au passé et au présent d’un personnage tiraillé entre vengeance et pardon, le tout dans des rues marocaines que des décennies ont vu changer, ou pas.
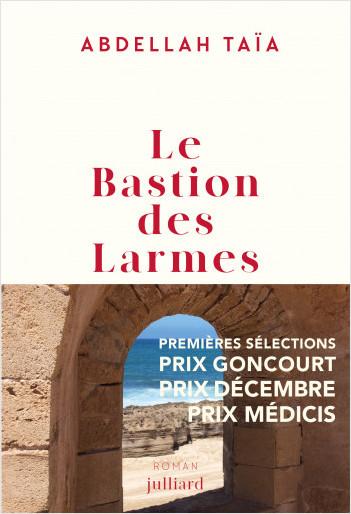
La mère de Youssef est morte hier. Comme le veut la tradition, ses six filles iront dans toute la ville à la recherche des dettes qu’elle a pu laisser avant de partir.
Pour ce faire, il faudra à ces femmes arpenter la ville, questionner l’histoire et les personnes qu’a pu fréquenter leur mère pour rendre à chaque personne son dû. Youssef, lui, n’accompagnera pas ses sœurs, comme le veut la tradition.
Dix ans plus tard et encore bien vivant, c’est sa propre histoire que l’homme vient questionner de retour sur sa terre natale. À mesure que son voyage approche, le narrateur se retrouve nez à nez avec les fantômes de son passé et notamment Najib, son premier amant devenu dealer de drogue. Avec son souvenir, d’autres arrivent : les violences physiques et sexuelles, le poids des insultes et de la honte que lui ont fait porter les autres pour son homosexualité. S’impose alors à lui deux possibilités, celle de la vengeance ou du pardon. Déambulant de nouveau dans les rues de Salé comme dans ses rêves, le narrateur répare les non-dits et les tabous de son enfance, pose enfin des mots sur ce qui était jusqu’alors entouré de silence.
Et malgré la violence, il se souvient aussi, de la tendresse parfois, du soleil de la ville qui l’a vu naître, et des textes qu’il lisait adolescent, ceux-là même qui lui ont donné l’envie de venir écrire en France. Alors, comme un instant de douceur volé à la dureté de ce récit, l’auteur nous laisse, nous aussi, apprécier un instant un poème d’Abou Firas al-Hamdani ou une chanson de Najet Essaghira.
Mon nom est ton nom, habibi,
ma ville, mon histoire,
ma maison, mon voyage.
Le monde entier ...

















