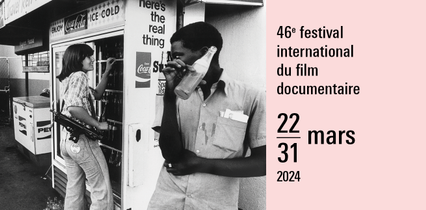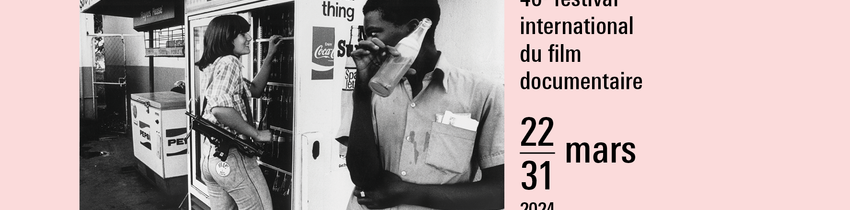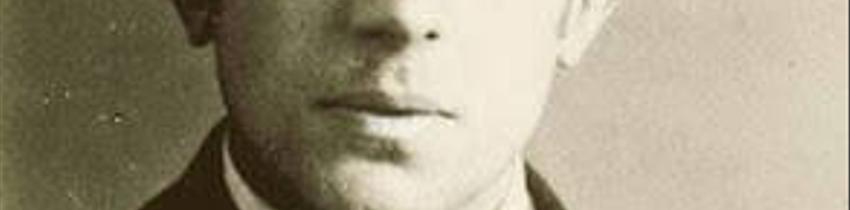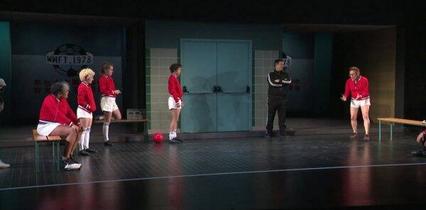Publié aux éditions du Castor Astral, On m’a jeté l’œil est le premier roman d’Anya Nousri. Remarqué au Québec, ce livre à l’écriture morcelée se dévoile comme l’affirmation d’une identité plurielle et mouvante. Entre les rituels religieux, l’érotisme latent et la tendresse infinie, la narratrice déplace sans cesse les injonctions sociales et familiales. Un détournement poétique, qui nous fait de l’œil.
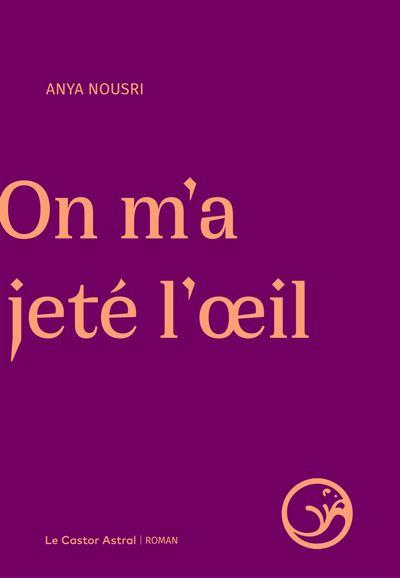
Écrire un chaos contenu ? Anya Nousri n’écrit pas pour mettre de l’ordre, ni pour soulager la malédiction. Elle ne cherche pas à emprunter les chemins que l’on a sillonnés pour elle, ni à insérer du sens ou de la rationalité à ce qui semble en manquer. Par sa forme fragmentaire et sa langue hybride, On m’a jeté l’œil revendique une voix intermédiaire, composée d’aspérités et de luttes.
À travers l’histoire d’une femme en proie au mauvais œil, que l’on cherche de force à lui retirer, l’autrice tisse un récit intime, habité par la honte d’un corps toujours perçu comme étranger. Algérienne et québécoise, la narratrice se meut d’un continent à l’autre, transportant à chaque fois avec elle le bagage de l’exil, empli de traditions, de dissonances et de violences. Que ce soit dans sa maison en Kabylie, chez sa tante à Paris ou à Montréal en compagnie de ses amies ou de ses crushs dits « Olivier », elle craint constamment d’être perçue comme différente, « pas normale ».
« Je supplie Allah de défaire mes boucles et de m’offrir une belle chevelure aussi lisse et soyeuse que celle de mon amie Lara. Je l’implore de me donner un accent québécois, de faire de moi une fille comme les autres, mais en même temps une musulmane irréprochable. Ya Rabi, accorde-moi le pardon et l’assimilation. Amin. »
En proie à tous les regards
Cette tension entre assimilation et tradition se cristallise autour de « l’âyn ». Attisé par la jalousie et la malveillance, le mauvais œil est cette cause extérieure qui expliquerait tout : la haine, la dépression, la maladie, l’éloignement, la libido débordante… Les superstitions vont de pair avec les rituels et les prescriptions. Pour échapper aux vices et à la malchance, les femmes qui entourent la narratrice cherchent sans relâche à la « purifier » au travers de gestes et de prières. Le livre s’ouvre ainsi sur une série de recommandations, aux allures d’avertissements.
« Fais attention. Quand t’es invitée chez quelqu’un, ne mange pas ce qu’on t’offre. On pourrait te s’hour avec de la nourriture. Évite de boire; si tu n’as pas le choix, essuie toujours le bord de ton verre pour ne pas laisser ta salive. »
La narratrice grandit « dans la méfiance de <s>es tantes maternelles ». Une méfiance qui pourrait se lire de deux manières : un scepticisme envers les croyances ancestrales, mais aussi une défiance à l’égard de ces femmes, qui utilisent le mauvais œil comme un prétexte pour maintenir un contrôle sur les corps. Guérisseuses ou sorcières, elles sont celles qui observent chaque comportement et scrutent le moindre mouvement, à la recherche de la présence cachée des « djnoun ».
« Je vais fondre du plomb et de la pierre d’alun. Tu seras nettoyée de la magie noire et du mauvais œil. Ma grand-mère observe la scène, très fière de sa fille et des savoirs qu’elle a pu récolter pour soigne...