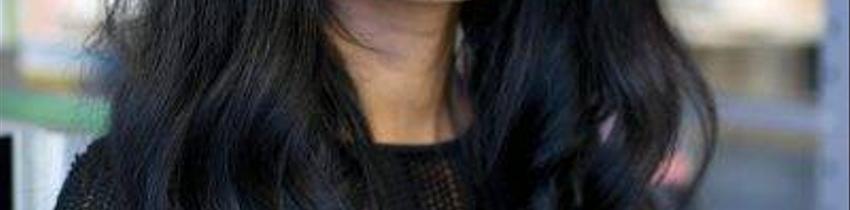Comment écrire aux frontières de la violence ? Où trouver le souffle pour dire la douleur de la perte qui se répète à l’infini ? Dans quelle mesure le poème peut-il saisir et transcender l’absence ? Les poètes palestiniens connaissent très bien ces questions qui hantent et façonnent leur écriture. Dans la poésie palestinienne d’aujourd’hui, celle qui raconte les tourments des Palestiniens de l’intérieur et de la diaspora, la voix de Raed Wahesh se distingue par une poétique de l’incarnation, à la fois lucide et inventive.

Né en 1981 à Damas et ayant grandi dans un camp de réfugiés, Raed Wahesh vit depuis 2013 en Allemagne et travaille comme rédacteur en chef pour la culture au journal en ligne Ultrasawt. En 2021, suite à son invitation au Festival de poésie “Voix Vives, de Méditerranée en Méditerranée” à Sète, les éditions Al Manar ont publié son recueil bilingue Jusqu’à la fin des fins, traduit par Antoine Jockey. L’occasion de découvrir un univers poétique qui résonne de manière glaçante avec l’actualité.
La beauté égarée
Le recueil de Wahesh s’ouvre sur un sentiment d’incertitude incarné par un poète qui peine à déchiffrer son environnement immédiat. Le temps, l’espace, les êtres et les objets baignent dans une violente confusion, accentuée par les thèmes de la captivité et de la réclusion : « Le soleil est otage / Des nuages / Et la lumière qui filtre ne peut payer la rançon ». Pris en tenailles entre le passé et le présent, le poète a perdu ses repères. Tout est « présomption », hypothèse, questionnement. D’une rue à l’autre, tous les chemins mènent à la terre palestinienne spoliée, à ses vallées et ses montagnes perdues : « Qui perd sa montagne / ne vit que dans son mirage ».
La poésie de Wahesh martèle que l’être palestinien est condamné à une forme de dissociation permanente. Le mirage est inscrit aussi bien dans la géographie que dans les corps et les regards :
Tu es quelqu’un d’autre lorsque tu t’avises d’être ici
Alors que ce que tu vois est un mirage
Et que ceux qui te voient, te voient tel un mirage.
Dans l’expérience palestinienne, nous dit Wahesh, le dépaysement et l’aliénation forment un dense brouillard qui avale tout sur son passage. Même la beauté devient synonyme de malédiction, d’anomalie : « À présent, je crains les belles femmes plus que les postes de contrôle / Les obus et les avions de guerre ». Comme d’autres poètes de la nouvelle génération, Wahesh a le don de condenser l’angoisse de l’être palestinien dans des images troublantes de justesse et de lucidité. La beauté n’a plus de place dans un quotidien réduit à une succession de cauchemars et d’élégies. Chaque présence physique est dépassée par l’image obsessive de sa disparition.
Écrire l’absence
Dans ce contexte, le poème devient une adresse au lecteur, un besoin de partager le paysage macabre d’une existence en suspens : « Je t’écris à la lisière du carnage / L’air a des relents de sang / le silence nocturne la saveur d’une haine desséchée… » La poésie palestinienne n’a peut-être pas vocation à transformer le monde, encore moins à le sauver, mais elle est là pour rassurer le poète, pour lui confirmer qu’il est toujours en vie et qu’il peut continuer de clamer ses droits et son désarroi.
Je t’invoque en t’écrivant
Non pas pour que tu répondes ou que tu viennes,
mais pour m’assurer que je peux encore t’invoquer.
La poésie devient un lieu de confidences et de murmures par-delà la perte
Hanté par l’absence sous toutes ses formes, le recueil de Wahesh donne la parole à la fois aux morts et aux endeuillés. La poésie devient un lieu de confidences et de murmures par-delà la perte. Face aux linceuls blancs, la parole poétique réinterprète la mort : « Chaque jour ils nous attendent / Dans leurs vêtements propres / La barbe rasée / Comme pour un rendez-vous galant ».
Pour incarner les déchirements de la guerre en Syrie dont les échos traversent le recueil, Wahesh imagine un dialogue à distance entre un prisonnier torturé et ses parents contraints à quitter leur terre. La violence de la torture crée un sentiment d’extrême détachement : « Ce que je croyais être ma peau est mort / Et devenu pareil au carrelage de la cellule / Et à ses murs ». Pendant que l’âme du prisonnier quitte son corps meurtri, ses parents prennent le chemin de la mer mais périssent lors de la traversée, « incapables de crier / Car la voix aussi se noie ». Le résultat est une double déchirure, « une mort familiale intime », des retrouvailles sous le signe de l’effacement : « Nous n’avons que faire des noms / Seul nous importe d’être ensemble ».
Déplacements poétiques
Face aux multiples visages de la guerre, la poésie de Wahesh enchaîne les portraits plus ou moins décalés : les belles filles jalousées par le ciel, la mère qui tombe enceinte « de peur pour [ses] enfants », les petits qui s’obstinent à sortir « en tenue de fête », la femme du poète qui danse au rythme des bombardements, le fils des voisins qui évoque le matelas des déplacés, ou encore le soldat qui constate que « tous les cœurs sont de la poudre à canon ». Il y a autant de guerres que de déchirements, autant de douleurs que d’expériences prises dans le tourment de la violence.
Comme un écho aux célèbres « passants parmi les paroles passagères » de son aîné Mahmoud Darwich, Wahesh décrit les déplacés comme des passants qui « marchent pour restaurer le trottoir de leurs pas ». Car comment survivre au désastre de la guerre sinon dans le mouvement continu et éphémère ?
Comme dans toute poésie palestinienne, la résilience s’organise aussi à partir des territoires de l’imagination. Au détour des pages, le poète se rêve en oiseau tourné vers les nuages, en cheval galopant dans le vent, en fleuve débordant ses rives, autant de manières de dire le besoin impérieux de transcender le drame, de se projeter sans cesse vers l’avenir : « Si j’étais un arbre, je ne cesserais de pousser / Jusqu’à atteindre un point où je ne verrais plus ce que je fus ».
Traces de fantômes
Pour continuer à vivre, nous dit Wahesh, il faut en finir avec les souhaits, apprendre à se méfier des images, restituer le sens d’une mémoire entravée. À la frontière du réel et du songe, le recueil se referme sur un dialogue insolite entre deux « fantômes pendus aux arbres ». Dans cet échange aux accents beckettiens, l’existence palestinienne et diasporique atteint le paroxysme de la précarité.
On nous tue et on laisse des potences libres
Potences sans cadavres
Pour qu’elles chassent nos fantômes.
La déshumanisation de l’être palestinien a quelque chose de tenace qui dépasse les limites de l’imagination et appelle, à son tour, une poésie de l’impossible. Les fantômes qui se balancent sur les branches « jusqu’à la fin des fins » ne disent rien d’autre que cette douleur qui se répète à l’infini, repoussant sans cesse les limites de l’écriture. Un processus que prolonge la traduction limpide d’Antoine Jockey qui suit la poésie de Wahesh au plus près, comme pour réduire l’écart entre l’arabe et le français.
Dans l’Anthologie de la poésie palestinienne d’aujourd’hui publiée l’année dernière par le poète marocain Abdellatif Laâbi aux Éditions Points, les poèmes choisis de Raed Wahesh se referment sur ces vers éloquents :
Nous qui nous absenterons d’ici peu
nous avons appris de nos prédécesseurs
à ne pas laisser de trace
À nos successeurs, nous apprendrons
à ne pas venir.
Plus que la résignation ou l’amertume, il y a dans ces vers une manière subtile de contenir la douleur. La seule trace possible est celle du poème qui réunit les générations autour de l’absence devenue, par la force des choses, une forme de présence. Dès lors, le long cortège des disparus et des déplacés reprend vie et s’avance vers le lecteur, guidé par cette poésie résolue qui dévisage les guerres et creuse des sillons de dignité au cœur de la souffrance.
- Raed Wahesh, Jusqu’à la fin des fins, trad. Antoine Jockey, publié aux éditions Al Manar, 2021.
Crédit photo : Raed Wahesh © Melad Atfeh