Comment remettre la pensée d’un philosophe au goût du jour, plus de huit siècles après sa disparition ? Que peut l’écriture face à la chape de violence, d’ignorance ou d’incompréhension qui pèse sur l’héritage du passé ? Paru au Maroc en 2017 et réédité en France en 2019, Au détroit d’Averroès est une enquête ouverte sur le devenir d’une figure qui a marqué l’histoire de la civilisation islamique et fortement influencé la philosophie occidentale.
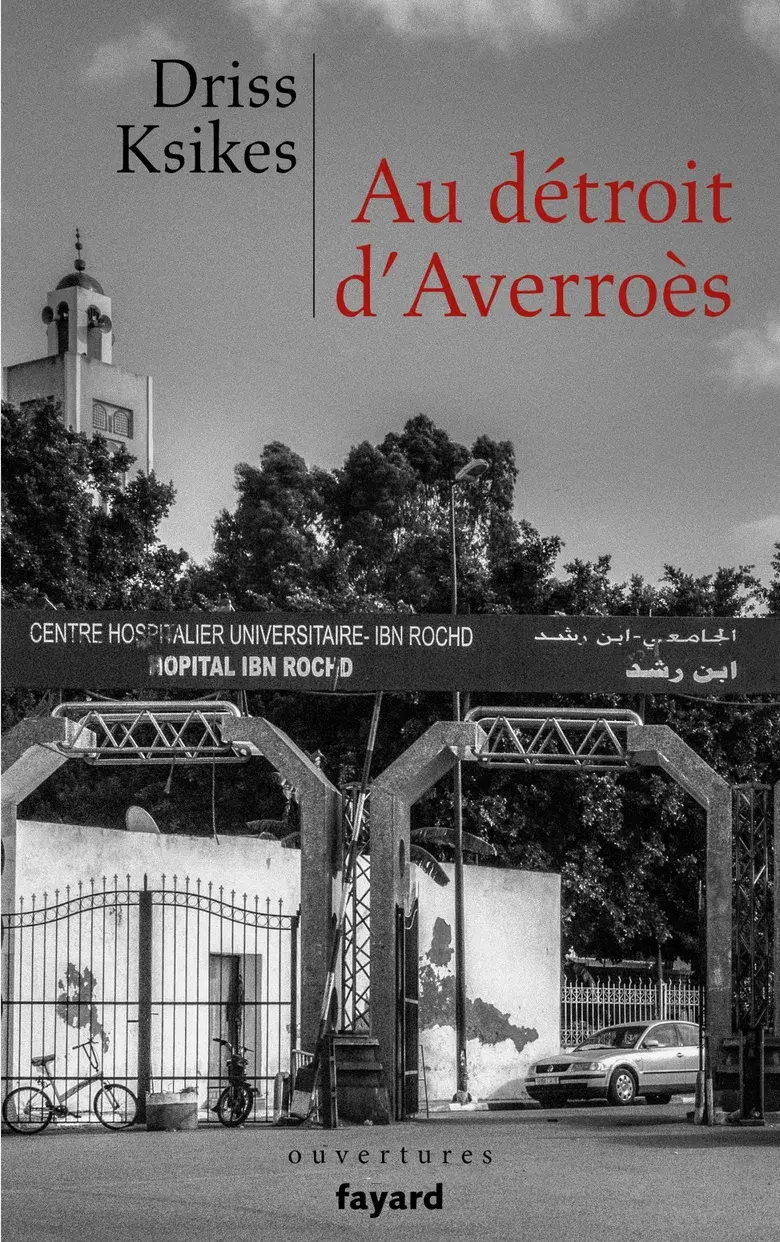
Fracture et ouverture
Le roman de Ksikes s’ouvre sur une fracture évocatrice, une blessure inscrite dans la double désignation arabe et latine du philosophe andalou : « Ibn Rochd. Averroès. Les deux noms dans cet ordre-là. Deux noms superposés. Ils indiquaient deux directions. Deux rives. Deux langues. Deux temps. Et un même homme ». Tirant sur les ficelles de cette séparation, Ksikes prolonge la quête d’« un astre perdu » qui continue de susciter l’intérêt des créateurs de tout bord. Du célèbre film Le Destin (1997) de Youssef Chahine au roman Averroès ou le secrétaire du diable (2017) de Gilbert Sinoué, en passant par la Lecture personnelle d’Averroès (2014) de Fouad Laroui, le philosophe est l’objet d’approches éclectiques qui dépassent le domaine strictement philosophique ou académique. Tout se passe comme si une autre manière de poursuivre le dialogue avec la pensée d’Averroès consistait précisément à varier les angles d’approche et renouveler le champ des relectures et des réinterprétations.
Né en 1126 à Cordoue et mort en 1198 à Marrakech, Averroès, qui fut entre autres juriste, théologien, médecin et mathématicien, reste associé à une pratique philosophique fondée sur le rationalisme critique, à l’image de ses célèbres commentaires d’Aristote. Juge suprême à Cordoue, homme respecté mais dérangeant, il doit faire face à une campagne de diffamations puis à un exil forcé. Réhabilité vers la fin de sa vie par le sultan almohade Yaacoub El Mansour, il meurt au Maroc où il est initialement enterré avant que sa dépouille et ses manuscrits ne soient transférés à sa ville natale. « Pour nous donc, qui sommes riches d’un savoir amer », écrit l’universitaire marocain Abdelfattah Kilito dans un essai paru dans La langue d’Adam (1999), « les funérailles d’Averroès constituent un moment dans l’histoire de la Méditerranée, un moment où la philosophie est refoulée vers le nord ».
Refoulement et héritage
Le roman de Ksikes s’attaque précisément à ce refoulement : au « transfert de l’esprit et du corps du philosophe » en 1199, répond un second transfert dans l’autre sens, une contre-expédition littéraire, un dialogue contemporain avec une pensée souvent dénigrée, incomprise ou reléguée aux pages poussiéreuses de l’histoire. Pour interroger « l’inconsolable schisme entre Averroès et Ibn Rochd », le roman évoque le détroit de Gibraltar, lieu de passage et de séparation, point nodal entre l’Orient et l’Occident. Si Ibn Rochd est « un ancien savant, constitué par notre imaginaire », Averroès « a d’abord été dans l’Europe médiévale, un être en papier », objet de relectures, de réimpressions et de traductions. Entre les deux, un mouvement de va-et-vient accompagne la construction du roman, comme s’il fallait faire osciller l’écriture entre les deux rives du détroit, faire de la traversée le signe même du dialogue fictionnel avec le philosophe.
Pour éveiller le « legs dormant » d’Ibn Rochd, Ksikes imagine un récit à plusieurs entrées où la pensée du philosophe fait l’objet d’autant de tentatives d’approche et de réinterprétation. Adib, professeur de philosophie à Casablanca, s’évertue à déterrer la pensée d’Averroès et perpétuer sa mémoire dans ses cours mais aussi dans des chroniques à la radio. La démarche d’Adib se veut un prolongement de celle de son mentor Hassan, un autre professeur de philosophie, « un esthète du verbe qui engage », rayé de l’enseignement « pour hérésie et incitation à l’athéisme ». Passionné au « talent d’orfèvre », animé par un irréductible « sens du devoir » hérité de son aîné, Adib fouille les textes anciens, recueille les traces dans les manuscrits, rassemble les indices et les nœuds de la pensée, cherche « des relais attentifs avec lesquels il serait possible d’entrevoir la renaissance d’une vertu collective». L’un de ces relais est le narrateur principal, interprète-traducteur engagé de son côté dans un projet de thèse visant à examiner le devenir d’Averroès à partir des modes de réception et de transposition de sa pensée.
Les premières pages du récit emmènent le lecteur à Cordoue où se tient un colloque consacré à l’héritage du philosophe andalou. Les débats illustrent la diversité des lectures de l’homme et de son œuvre. Aziza, l’« illustre représentante de la population tatillonne des historiens », rappelle les circonstances de l’émergence et du développement de la pensée d’Averroès. Dr Brown, universitaire aguerri, dresse le portrait paradoxal d’un philosophe « d’une inquiétante étrangeté », à la fois « rassurantparce qu’il croit en l’homme » et « angoissant parce qu’il ne parle pas à tous les hommes ». Comme le montre la suite du récit, Ibn Rochd/Averroès est le double signe d’un héritage complexe dont le propre est de générer les débats et de déchaîner les passions. Les titres des différentes parties traduisent cette profusion : la controverse accompagne la narration, le savoir est hanté par le souvenir, l’écriture est un tâtonnement rythmé par les doutes et les appréhensions.
Comme le montre la suite du récit, Ibn Rochd/Averroès est le double signe d’un héritage complexe dont le propre est de générer les débats et de déchaîner les passions.Les titres des différentes parties traduisent cette profusion : la controverse accompagne la narration, le savoir est hanté par le souvenir, l’écriture est un tâtonnement rythmé par les doutes et les appréhensions.
Séquences dialogiques
Cette dynamique se reflète dans le recours de Ksikes à des séquences narratives qui revisitent ou font écho à la vie du philosophe. Un dialogue imaginé en 1189 entre Ibn Rochd et la poétesse Hafsa bint al-Hajj, dite Al-Rakuniyya, est l’occasion de rappeler l’engagement précurseur du philosophe en faveur de l’égalité des sexes mais aussi d’interroger la possibilité de côtoyer, voire de servir, le pouvoir tout en défendant une « éthique du dire-vrai ». Dans une autre séquence, le témoignage du célèbre savant juif et théologien cordouan Maïmonide sur la disgrâce de son confrère permet de réaffirmer leur commune « aversion envers les clercs obtus » et de balayer les rumeurs ayant entouré l’identité d’Averroès. Sauvegardés grâce à leur traduction en hébreu, certains livres du philosophe portent dans leur trajectoire le signe de la mobilité et de l’ouverture qui caractérisent sa pensée. Enfin, une correspondance entre Averroès et son aîné Ibn Tofaïl, autre philosophe andalou célèbre pour son ouvrage d’initiation Hayy ibn Yaqdhan (L’Eveillé ou le Philosophe autodidacte) permet de sonder la question des rapports entre le philosophe et la Cité, entre l’exercice solitaire de la pensée et sa diffusion ardue au grand public, nécessitant la création d’un cercle vertueux de transmission et de dialogue, « une ruche où l’échange entre tous l’emporte sur le pouvoir de quelques-uns ».
Dans le roman, cette dimension dialogique résonne également à travers l’élément linguistique. En effet, le récit est parsemé de termes en arabe (« hikma » pour sagesse ; « falsafa » pour philosophie ; « turat » pour patrimoine) comme s’il fallait, là encore, prolonger la dynamique de la quête dans ce va-et-vient implicite entre la langue du philosophe et celle de l’écriture, une autre manière de combler la séparation entre Ibn Rochd et Averroès. L’attention de Ksikes à la question de la langue fait écho, chez son personnage Adib, à « cette vieille manie qui consistait à décortiquer les noms propres ». Par son nom complet (Aboulwalid Ibn Rochd), le philosophe incarne « ce père de la raison et fils de la sagesse » qui figure « une synthèse de la continuité de l’espèce et de la distinction de l’intellect ». Partant, le dialogue de Ksikes avec la vie et la pensée d’Averroès est aussi un appel subliminal à prolonger l’effort de lecture et d’interprétation dans le champ pluriel du langage. La traduction des signes semble inscrite dans les plis du récit, comme un écho à la fois au destin de l’œuvre d’Averroès et à la trajectoire discontinue de sa transmission.
La pensée et son horizon théâtral
Plus que la reconstitution historique, les séquences dialogiques retenues par l’auteur fonctionnent comme des scènes évocatrices où retentissent la voix et la pensée du philosophe. Connu pour son œuvre théâtrale, Ksikes fait du théâtre l’horizon même de son dialogue avec Averroès. Tout au long du roman, la pensée du philosophe est littéralement « remise en acte » et en scène par le travail d’écriture. Le narrateur, par exemple, ayant découvert le philosophe andalou à travers Borges et sa nouvelle « La quête d’Averroès » dans L’Aleph, entreprend une adaptation de cette dernière en cinq « tableaux » où la solitude du philosophe est relue à la lumière d’un « théâtre de rue ». Cet horizon théâtral est aussi une manière de repousser les limites d’une démarche tributaire du contexte et des sources de son époque. Comme le rappelle Kilito, Averroès travaille sur la Poétique d’Aristote à partir d’une traduction arabe du syriaque où les notions de « tragédie » et de « comédie » sont incorrectement traduites par « panégyrique » et « satire ». Le résultat est qu’Averroès, dans les mots de Kilito, « n’avait aucune notion du jeu théâtral. Son commentaire de la Poétique est ainsi basé sur un malentendu tragi-comique, peut-être le plus grand de toute l’histoire littéraire, en tout cas le plus lourd de conséquences ».
L’horizon théâtral du récit de Ksikes permet donc de revisiter, et peut-être de dépasser, ce malentendu en repositionnant la pensée du philosophe dans un théâtre de tableaux qui fait appel à l’histoire du genre. Ainsi, à l’image des autres dialogues qui rythment le récit, l’échange entre Ibn Rochd et la poétesse Hafsa a des allures de « dialogue shakespearien ». Le théâtre est le carrefour où se rejoignent l’élan de la pensée et le souffle de la poésie. Les chroniques radiophoniques d’Adib sont enregistrés « sur fond de musique jajouka », comme si le retour à Averroès éveillait la question du rapport au patrimoine culturel. Comme dans le film de Chahine, la musique, autre élément-clé de la mise en scène, est un signe d’ouverture et de dynamisme face à l’immobilisme ambiant. De la philosophie à la musique, en passant par le théâtre, la question centrale demeure celle de la transmission : « Comment traduire l’ineffable, le sensible, l’imperceptible dans un langage intelligible ? ».
De la philosophie à la musique, en passant par le théâtre, la question centrale demeure celle de la transmission : « Comment traduire l’ineffable, le sensible, l’imperceptible dans un langage intelligible ? ».
Amateur de jazz, Adib compare la relation d’Ibn Rochd avec les clercs religieux à celle « qu’entretiendrait un soliste de jazz virtuose, insolite, inégalable de son temps, avec le seul orchestre disponible qui jouerait dans une vieille gamme, monotone, inchangée depuis la nuit des temps ». Par-delà la métaphore, le roman interroge les modalités d’accès et de renouvellement de la pensée, ouvrant le récit de manière théâtrale à des personnages secondaires mais non moins révélateurs, à l’image de Ba Allal, le gardien « humble et cultivé » du mausolée ayant abrité le tombeau originel d’Averroès et occupé désormais par un saint, ou de ce « sage anonyme » qui ne cesse de surgir pour rappeler à Adib les limites de sa démarche et de ses ambitions. La quête d’Ibn Rochd est une partition qui se joue également en dialogue avec une constellation de figures issues de la littérature ou de la philosophie arabo-musulmane, du grand poète Al Mutanabbi (915-965) au maître soufi Ibn Arabi (1165-1240), et du théologien mystique Al Ghazali (1058-1111) à son confrère traditionaliste Ibn Taymiyya (1263-1368). Au détour des pages, on feuillette même le célèbre dictionnaire Lisan al-arab d’Ibn Manzûr et on s’arrête sur un article de la revue culturelle influente Al Naqid.
Relues à partir de l’horizon théâtral, ces variations intertextuelles rappellent l’aveu de Borges à la fin de sa nouvelle : « Je compris qu’Averroès s’efforçant d’imaginer ce qu’est un drame, sans soupçonner ce qu’est un théâtre, n’était pas plus absurde que moi, m’efforçant d’imaginer Averroès, sans autre document que quelques miettes de Renan, Lane et d’Asín Palacios ». C’est dire que seule une écriture théâtrale et dialogique, ouverte sur le jeu des correspondances et des médiations mais consciente de ses limites et de ses angles morts, permet de saisir et de restituer la complexité d’une pensée philosophique. Ressusciter Averroès, semble suggérer Ksikes, nécessite un travail de relecture critique en profondeur et à plusieurs niveaux, une traversée dynamique et exigeante des courants ayant guidé ou influencé la compréhension des liens entre le sacré et le profane, entre le révélé et le rationnel. Dans ce contexte, le théâtre, espace d’action et de distanciation, offre un horizon effectif pour la renaissance d’Ibn Rochd. L’écriture est tendue vers la transformation, difficile et incertaine, de la pensée d’un philosophe en « idée motrice remise en acte sur scène ».
Le Maroc au miroir d’Averroès
Dans sa quête d’Averroès, le roman dresse aussi en filigrane le portrait du pays qui l’a vu mourir. Au fil des pages, le Maroc se lit au miroir du philosophe et de son absence. L’ombre des « années de plomb », cette période de l’histoire postcoloniale du Maroc marquée par la répression brutale des opposants, plane sur le récit. Evoquant ces « luttes qui faisaient disparaître régulièrement les professeurs dissidents », Ksikes redonne vie à des « militants aux regards torves et aux barbes naissantes », emportés dans le tourbillon d’« une époque coriace, sans clémence ». Dans le Maroc des années 1970, l’enseignement de la philosophie subit les foudres du pouvoir, la filière étant soupçonnée de nourrir la dissidence et la rébellion. Adib fait partie de la dernière cohorte qui bénéficie d’un enseignement philosophique digne de ce nom, comme un ultime témoin avant le cortège des générations sacrifiées. La mémoire du pays est ce terrain miné par les séquelles de l’oppression et de l’étouffement. Dans les cours d’histoire, les hommes de science et de culture sont « absents, gommés, sans même une indication sommaire sur leur demeure, en vie ou après la mort ». L’oubli d’Averroès, nous dit Ksikes, est l’arbre qui dissimule une forêt de manquements, de vides et de blessures.
Parsemés tout au long du roman, les fragments d’un discours critique investissent les secteurs de l’éducation, de la culture ou encore de la santé. A Rabat, l’hôpital qui porte le nom d’Averroès est une « bâtisse délabrée » que fréquentent des malades « venus des abords de la métropole pour y quémander un brin d’attention ». A Marrakech, la place Jemaâ El Fna souffre en silence de « la désertion, volontaire ou imposée », de ses conteurs, seuls garants de ces « échos de temps enterrés, de légendes sans date, de mémoires sans lieux ». A Casablanca, l’établissement où enseigne Adib est « un lycée miteux » dont les professeurs sont plus préoccupés par des « banalités qui meublent leur quotidien » que soucieux de penser la transmission du savoir ou la conciliation des sciences et des humanités. A la radio, la programmation est soumise au « règne du marketing » et à la logique de l’audimat, dominée par les « experts de la consommation » et les « vendeurs de formules de bien-être ».
Ici et là, le récit fait référence à une classe dirigeante prise dans les « jeux de sérail », tantôt condescendante et cynique, tantôt égocentrique et détachée, une élite isolée ayant abandonné l’effort de la pensée au profit des intérêts personnels et de la culture des préjugés. Seule la jeunesse semble échapper à ce tableau sombre. Pleine d’entrain et d’initiative, elle n’a pas « l’illusion de changer le monde, juste l’envie de le rendre plus habitable ». Mais est-ce là un aveu de faiblesse ou un signe de lucidité politique ? Comment transmettre l’héritage d’Ibn Rochd à des jeunes qui « n’ont pas de figure à ressusciter » ? Comment faire fleurir les graines du savoir dans un monde guidé par la logique du pouvoir et la loi de la consommation ?
Une restitution difficile
Au fil des pages, le lecteur en vient à percevoir la difficulté d’une restitution, voire même d’une appréhension, de l’héritage d’Averroès. La pensée du philosophe est tantôt « une relique culturelle déplacée » et « une promesse à réactiver », tantôt « une énergie fossile » à extraire et « un moteur longtemps éteint à remettre en marche ». Ibn Rochd lui-même est à la fois « une pièce manquante, une case vide à remplir, une pensée barrée à réhabiliter d’urgence », mais aussi « une belle plante qui n’a pas réussi à fleurir dans sa terre d’origine », condamnée à une forme d’arrachement inexorable et douloureux. Cette accumulation de définitions et de métaphores révèle autant la richesse irréductible de l’héritage du philosophe andalou que la difficulté de le réactiver et de le dire au présent.
C’est qu’il y a quelque chose d’Averroès, personnage à la fois fascinant et intimidant, qui demeure de l’ordre de l’insaisissable. Par moments, la quête du philosophe s’apparente à une voie sans issue. Des questions lancinantes hantent le récit. Comment maintenir la distinction entre la foi et la science ? Comment concilier « la faiblesse de croire et la force de raisonner » ? Comment maîtriser cette persistante « tension entre savoir et pouvoir » ? Les personnages de Ksikes semblent pris dans le piège de leurs démarches. Le narrateur, par exemple, écoute les chroniques d’Adib de manière rituelle et avoue être « aimanté » par « sa manière singulière de raconter les détails de son rapport intime à Averroès ». De son côté, Adib, hanté par le souvenir de son aîné Hassan, finit par admettre qu’il a été « l’obligé de son rêve », que l’ambition de perpétuer l’héritage de son mentor a été « une manière aussi d’en rester prisonnier ». Ainsi, l’effort et la lucidité de la relecture philosophique sont constamment perturbés par l’utopie de la reconstitution obsessive, déroulée à mi-chemin de l’histoire et de la fiction.
Au final, le philosophe retrouvé semble se confondre avec le personnage inventé : « la vie passée par Ibn Rochd à écrire s’est transformée en roman à recomposer », un peu comme celui de Ksikes dont les fragments ne cessent de se chevaucher et de s’entrecroiser. En cherchant à raviver la pensée d’Averroès, l’auteur interroge les limites de tout travail de transmission intellectuelle. De même, face au déchaînement de la violence et de l’insouciance, Adib se sent « parfois comme un Don Quichotte tentant de réinsuffler de l’air, du vent, là où d’autres dressent constamment des temples de préjugés ». La démarche serait-elle aussi périlleuse que vaine ?
Politiques de l’écriture
Par-delà la quête d’Averroès, le roman de Ksikes est une ode à l’éclatement des lieux et des formes d’écriture. Dans une structure foisonnante et faite de variations permanentes, le roman alterne les dialogues fictionnels, les discours rapportés, les échanges épistolaires, mais aussi les confessions, les emails et les extraits de journaux ou de carnets de bord. La lecture s’apparente à une navigation entre divers genres et plusieurs niveaux de commentaires, prolongeant en filigrane l’oscillation entre la tentation du roman historique et le désir d’un témoignage au présent. A la radio, les chroniques d’Adib s’apparentent à « des contes » qui donnent accès à « un passé aux réverbérations infinies ». Au détour des pages, entre deux méditations philosophiques, on croise une slameuse qui fonde un groupe de « néo-muatazilites » en référence au célèbre courant théologique et rationaliste du septième siècle.
Si le roman tente ainsi, et à de nombreuses reprises, de jeter un pont entre le passé et le présent, il s’emploie également à dénoncer les dérives d’une époque contemporaine où les débats sont marqués aussi bien par « la rapidité et la virulence des réactions » que par le « simplisme des arguments ». Le récit est aussi une reconstruction des malentendus et des incompréhensions qui empêchent désormais l’effort et le renouvellement de la pensée, une reconstruction menée notamment à partir de l’opposition entre la bulle déchaînée et incontrôlable des réseaux sociaux et le monde exigeant et tourmenté de la philosophie.
La perspective politique de la pensée d’Averroès est un autre point de tension ou du moins d’interrogation. Et si le philosophe andalou était « un antihéros politique », pris dans le double piège de sa proximité avec le pouvoir et de ses critiques envers les gouvernants ? Dans le roman, un interlocuteur anonyme estime que « quand un philosophe rêve de politique, il peut au demeurant manquer de sagesse ». Comment concilier la pratique philosophique et l’action politique ? Cette question résonne de manière particulière avec l’actualité de l’auteur. Nommé en décembre 2019 aux côtés d’un groupe de professionnels et d’universitaires marocains comme membre de la Commission de développement chargée par le souverain de dresser l’état des lieux et les perspectives d’évolution du pays, Ksikes se retrouve de nouveau confronté au rapport entre la pensée et l’action, entre l’élan philosophique et la programmation politique. Au carrefour de la fiction et de la réalité, les leçons d’Averroès incarnent peut-être les enjeux d’un effort de réflexion, à la fois individuel et collectif, dont la Cité attend impatiemment les fruits.
Questions et déchirements
En utilisant la forme romanesque pour réactiver au présent la pensée d’Averroès tout en éclairant son ancrage historique et sa dimension prospective, Ksikes s’inscrit dans une longue tradition qui n’a cessé d’interroger le rapport à la culture dans ses lignes de rupture et de croisement. Ce n’est probablement pas un hasard si le personnage d’Adib rappelle le roman éponyme aux accents autobiographiques de Taha Hussein, paru en 1935. Dans Adîb, l’écrivain égyptien dressait le portrait d’un étudiant tiraillé entre l’appel séduisant de la culture occidentale et le poids persistant de sa formation et de ses valeurs traditionnelles. En reprenant le duo formé par Adib et le narrateur, déjà présent chez Taha Hussein, le roman de Ksikes associe la réactivation de la pensée rationaliste d’Averroès à une modernité critique qui rappelle, quoique de manière implicite, la démarche novatrice et les débats suscités, en son temps, par l’œuvre du doyen des Lettres arabes.
Comme un écho à ces débats, la « traduction en différé » de l’héritage d’Averroès se heurte sans cesse à la question du transfert et de l’adhésion. Les chroniques d’Adib parviennent à « divertir élégamment l’élite francophone du pays » mais leur transmission aux autres composantes de la société demeure plus incertaine. Tout au long du récit, les échanges autour de la postérité d’Averroès restent globalement confinés dans les cercles des universitaires et des érudits. Comment réhabiliter une pensée dont la complexité et la profondeur semblent en rupture avec le discours dominant ? Est-il vrai qu’« un philosophe ne peut être audible que d’une poignée d’initiés, et peut-être uniquement de lui-même » ? « Pourquoi l’idée de ‘raison’ demeure si difficile à traduire d’une culture à l’autre ? », voire même d’une époque ou d’une classe à une autre au sein de la même culture ?
Des traces à réécrire
A ces questions, le récit n’apporte pas de réponses définitives mais enregistre néanmoins une rupture inquiétante entre la pensée philosophique et le discours théologique, souvent au risque de formulations maladroites, comme quand il reprend le cliché médiatique et rebattu de l’imam « soft » ou quand la pratique de la psalmodie est associée de manière expéditive à des « étiquettes kitsch », ou encore quand les « tolbas » ou les représentants religieux d’un sultan almohade sont décrits comme les éventuels « ancêtres lointains » des talibans. A cela s’ajoute peut-être, dans le champ social et de manière plus ponctuelle, une représentation ambivalente des personnages féminins à partir des lieux obsessionnels du désir masculin, à l’image des évocations de la « jupe cintrée » de l’historienne Aziza ou de la « croupe voluptueuse » de la poétesse Hafsa. Malgré ces faiblesses occasionnelles, le roman éclaire de manière particulièrement efficace la fracture entre les pratiques sociales, noyées dans la superficialité et la violence, et l’effort de la pensée critique, incarné par un Ibn Rochd/Averroès qui résiste à toute récupération simpliste ou dogmatique. Suivant l’épigraphe qu’il emprunte à Walter Benjamin, Ksikes relève le défi de « retenir l’image du passé qui s’offre inopinément au sujet historique à l’instant du danger », soit le portrait en pointillés du philosophe en éclaireur et en revenant, foyer spectral d’une lumière sauvée des pages de l’histoire et brandie telle la promesse d’un refuge à l’heure des menaces obscurantistes.
Après tout, la quête tortueuse d’Ibn Rochd, comme la réécriture exigeante d’Averroès, n’est peut-être que le signe d’un défi sociétal, culturel et politique d’envergure qui dépasse le cas et l’œuvre spécifiques du philosophe andalou. De même, le détroit, lieu symbolique d’ouverture et de traversée, n’est peut-être que la pointe ultime de ce déchirement où l’écriture, miroir labyrinthique des hommes et de leur époque, prend tout son sens. Dans ce contexte, le spectre d’Ibn Rochd/Averroès devient un prétexte pour dire la condition d’un sujet écartelé entre la réalité éclatante du sud et le miroir persistant du nord, entre l’amertume du savoir perdu et la promesse de la pensée retrouvée, entre la réappropriation difficile de l’héritage et sa reconstruction incertaine au présent. Adib, comme peut-être Ksikes, est convaincu que « que c’est en passant son temps à noircir du papier qu’il prouverait son existence » et laisserait, dans le sillage des anciens, des traces précieuses à réinvestir par les générations à venir. C’est que, comme le dit Kilito, « on n’a pas fini d’enterrer Averroès ».
- Au détroit d’Averroès, Driss Ksikes, Fayard, 2019, 224 p., 18€


















