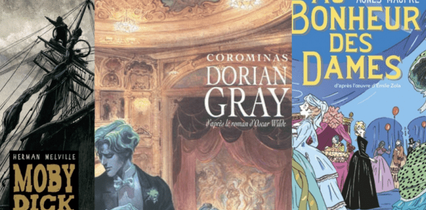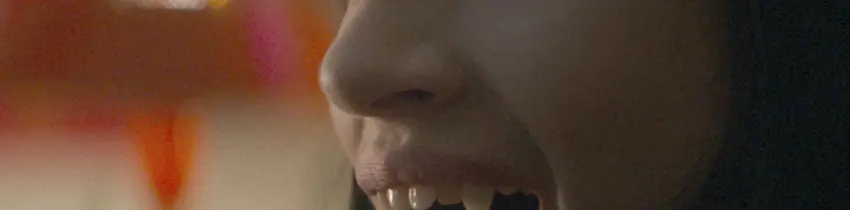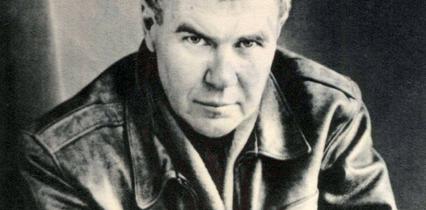Squid Game, en faisant régresser les joueurs au stade de l’enfance, se pose en allégorie de l’école. Les jeux soumis aux 456 candidats, tout comme les lieux où se déroulent les épreuves, en sont l’illustration parfaite. Un, deux, trois soleil, le jeu de la corde ou encore celui des billes : chacune des épreuves invite les joueurs à s’affronter sur des aires, qui ressemblent tantôt à des parcs, tant�ôt à des cours de récréation. L’élimination des perdants renvoie quant à elle à l’idée de concours. Or, chez Squid Game, ce n’est pas l’épreuve de mathématiques ou de langue qui régit la sélection, mais bien le jeu lui-même. Les vainqueurs enfin, ceux qui ont réussi l’épreuve, retournent alors dans leur dortoir en attendant le prochain jeu.
Squid Game, ou promouvoir l’égalité des chances
Afin de convaincre tous les joueurs de leur chance, les organisateurs de Squid Game font de la méritocratie un pilier fondateur de leur justice sociale : tous les participants disposent des mêmes chances de réussir. La promesse est ainsi formulée. En effet, aucun d’entre eux ne bénéficie d’une aide quelconque, ni ne sait à l’avance quel sera le prochain jeu. Cette absence d’information – à la manière d’une épreuve de concours que les étudiants découvrent en même temps – garantit précisément l’égalité des chances entre tous, et permet à chaque joueur de pouvoir croire en sa victoire. Autrement dit, aucun traitement de faveur n’est permis, et la méritocratie devient le régime du jeu.
Pour François Dubet, sociologue et auteur de L’école des chances, qu’est-ce qu’une école juste, la méritocratie est justement une « fiction nécessaire », qui pousse les enfants à rêver d’un avenir meilleur. En France, le ministère de l’Éducation nationale met d’ailleurs en œuvre bon nombre de politiques publiques – comme les « Cordées de la réussite » où la Convention éducation prioritaire qui ouvre, pour les lycéens de certains établissements REP, un concours distinct pour accéder à Sciences Po –, procédure visant à promouvoir l’idée selon laquelle les inégalités sociales de départ peuvent être gommées.
Qui plus est, et dès le premier épisode, les organisateurs affirment que le jeu a été créé pour celles et ceux que la société violente : les marginaux, les endettés, les délinquants et criminels. En somme, tous ceux dont la réussite sociale est rendue impossible par le système politique coréen. Face à cette exclusion, c’est un nouveau départ qui est promis aux joueurs, ramenés pour la première fois de leur existence à une situation d’égalité, comme si chacun d’entre eux revenait à un état de nature, et donc, métaphoriquement, d’enfance.
Or, cette égalité est une égalité devant la règle, et donc, devant la loi, telle que la formulent les organisateurs du jeu. De fait, en dépit – et a fortiori ! – de son caractère illégal, Squid Game est une allégorie du jeu social et politique, et s’inscrit dans des réseaux de pouvoirs, à l’image de nos sociétés contemporaines dans lesquelles citoyens et citoyennes luttent pour leurs conditions matérielles d’existence. La philosophie à l’œuvre, et par laquelle chacun croit en ses chances de réussite, se situe dans les deux cas, dans la garantie d’une égalité devant le règle – chaque fois qu’elle est dictée par les dominants, la règle fait loi. Il s’agit là bel et bien d’une perspective propre aux démocraties libérales et à la vision qu’elles portent sur l’égalité des chances. Milton Friedman distingue, dans La Liberté du choix, l’égalité des chances de l’égalité des résultats. Et pour cause, le jeu doit produire des perdants afin de faire croître la cagnotte du vainqueur : un mort équivaut à 100 millions de won, soit à peu près 75 000 euros. Cette logique s’apparente volontiers avec celle des systèmes éducatifs des démocraties libérales, lesquelles préfigurent une représentation pyramidale de l’ordre social : éliminer pour construire une élite.
Les règles de la méritocratie interdisent toute forme de solidarité.
Plus important encore, les joueurs sont soumis aux mêmes règles certes, mais ne sont égaux qu’avant les jeux, puisque pendant l’épreuve, seule la hiérarchisation des participants – la victoire des uns et la défaite des autres – permet d’éliminer des candidats et d’atteindre l’inégalité des résultats voulue. L’école Squid Game, comme l’indique Khen Lampert dans son Meritocratic Education and Social Worthlessness (2012) à propos de la méritocratie scolaire, repose ainsi sur les dynamiques d’un darwinisme social post-moderne.
Construire l’inégalité par la valorisation des compétences acquises
L’origine du terme « méritocratie » est attribué à Michael Young, et à son ouvrage The Rise of the Meritocracy (1958), brûlot fictionnel à l’encontre du système éducatif anglais. Parmi les effets pervers d’une organisation fondée sur le principe de mérite, l’auteur relève les conséquences néfastes de la compétition individuelle sur la qualité des liens sociaux. Cette dynamique est très bien illustrée par la série, où les joueurs sont invités à s’affronter directement lors des jeux. L’épreuve de la corde notamment, où les participants se défient par équipe, contribue, outre l’élimination des perdants, à la construction de clans et d’une conflictualité qui dure jusqu’à la fin de la première saison. Pire, à partir du moment où les joueurs comprennent qu’il leur est possible de faire croître la cagnotte en assassinant leurs concurrents en dehors du jeu, la série met en scène des nuits d’émeutes spectaculaires, dans les dortoirs, au cours desquelles de nombreux personnages perdent la vie. En d’autres termes, les règles de la méritocratie interdisent tout...