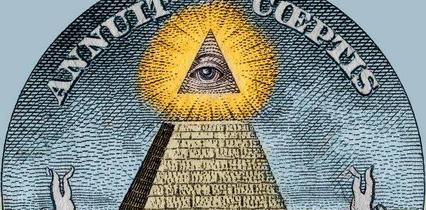A l’occasion de la parution du film Nosferatu réalisé par Robert Eggers, Zone Critique revient sur l’évolution récente du vampire, cette figure attirante et dangereuse qui imprègne l’imaginaire de la pop culture. Le vampire est-il toujours cette figure subversive et érotisée que l’on retrouve dans l’esthétique néogothique des années 60 ? Que disent les relectures contemporaines de ce mythe de l’évolution de nos sociétés ?
Pour l’essayiste Stéphane du Mesnildot, le vampire demeure le symbole d’une sexualité transgressive. A une époque de plus en plus puritaine, cet archétype du genre horrifique continue à nous en apprendre sur nos zones d’ombres et nos désirs cachés.
Dans son ouvrage Le Miroir obscur : une histoire du cinéma des vampires (Rouge Profond, 2013), du Mesnildot se demande ce qu’est un vampire. Réponse : une créature venant des origines du cinéma qui se tient devant nous et nous parle à travers le temps. La scène du Dracula (1992) de Coppola où le comte invite Mina dans une salle de projection du cinématographe à la fin du XIXe siècle, constituant l’intrication symbolique et historique par excellence entre la figure du vampire – notamment celle de Dracula – et l’apparition du cinéma en Europe.
Retour aux origines
Pour du Mesnildot ce lien entre fantastique et innovations technologiques est déjà présent dans le Dracula de Bram Stoker : « C’est vraiment un roman de la modernité, avec la présence des trains, de la science, du cinéma. Dracula apparaît en même temps que les rayons X et que la psychanalyse. Soit une technique qui produit un double du réel en passant à l’intérieur du corps, et une discipline scientifique qui scrute les profondeurs de l’esprit.
Au XIXe siècle les démons de la nuit étaient moins des êtres surnaturels que le fruit de l’imagination érotique. D’où la métaphore du vampire comme symbole d’une sexualité transgressive. Celle qui contamine la bourgeoisie victorienne engoncée dans ses traditions et qui, d’un coup, va laisser sa sexualité s’épanouir, déborder, mais en retombant sous la coupe d’un maître. C’est ambigu : Dracula libère nos désirs et nous emprisonne dans ses propres désirs. Le journaliste Nicolas Stanzick a une très belle théorie à ce sujet : Dracula et Mick Jagger vont libérer sexuellement les jeunes Anglais de la même manière. La bouche sanglante des Rolling Stones c’est aussi la bouche du vampire. »
Désir écarlate
Au fil des années et des évolutions techniques, on note un changement de la représentation graphique du vampire au cinéma : c’est du désir que naît cet être surnaturel et le rouge est la couleur de ce désir, celle qui éclate dans Le cauchemar de Dracula (1958) de Terence Fisher, le premier film du cycle des vampires et le plus éclatant représentant de l’âge d’or de la célèbre société de production britannique Hammer. Jouant malicieusement avec les codes de la censure, c’est par le prisme du fantastique que la charge érotique peut se manifester dans ces films (sans même parler des variations explicitement pornographiques de Jess Franco).