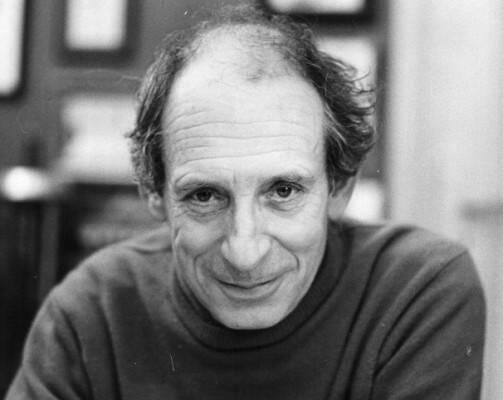Irradiant à merveille sa lucidité fracassante dans le pamphlet, maître de l’électrochoc et de l’ultra-court, alchimiste fantasque et cassandre du roman, Sternberg se déroba, comme une anguille dans la rocaille, aux orthodoxies ankylosantes et aux labels de labo.
Séducteur invétéré et marathonien du mariage, ivre d’air pur et fieffé fumeur, débordant de vitalité et hanté par la mort, Sternberg conciliait certains extrêmes tel un équilibriste un peu gauche.
Anarchiste notoire, réfractaire râleur, anticonformiste teigneux, iconoclaste incompris, le Pierrot de la dérision faisait partie de l’espèce rare des radicaux libres, discret mais farouchement insoumis.
Les études, la guerre, la naissance d’un écrivain
Né à Anvers, de parents d’origine juive et de condition aisée, Jacques Sternberg coula une enfance tranquille, douce, rêveuse, solitaire, sportive.
« J’étais un garçon timide, craintif et refoulé, complexé et attardé pour mon âge ».
Très tôt il couva une allergie viscérale aux études, contrairement à sa studieuse sœur et au grand dam de son père, cultivé, polyglotte et autoritaire. Dans son autobiographie, il se qualifiait lui-même de « cancre inspiré ». Les éditeurs Jérôme Lindon et Hélène Oswald le définissaient comme un « cancre génial » ou un « idiot galactique ». Le gavage à l’entonnoir de la culture académique en toc, producteur d’oies savantes et obéissantes, l’horripilait au plus haut point.
Il apprit très tôt à détester l’autorité et la contrainte, administrées sous les férules paternelle et professorale.
En 1940, lorsque les troupes allemandes déboulèrent en Belgique, l’adolescent de 17 ans n’ourdissait aucun dessein professionnel et se méfiait déjà de la besogne productive. La guerre ne chamboula donc pas ses perspectives. Au contraire, elle suspendit son cauchemar scolaire.
La plupart de ses textes traversèrent le ciel littéraire, comme des météores furtifs, simplement perçus et appréciés par quelques lecteurs buissonniers errant dans l’obscurité et daignant lever la tête.
Fuyant l’invasion allemande, la famille Sternberg quitta la Belgique, transitant par Paris, Biarritz, puis s’installa quelques mois à Cannes où Jacques échoua au baccalauréat mais excella en matière de voile, de vélo, de lecture et de badinage amoureux. Il y commit également ses premiers écrits intimes et prit conscience du pouvoir des mots.
L’ombre nazie se propageant, la famille dut migrer une nouvelle fois, vers l’Espagne cette fois-ci où elle fut interpellée et reconduite en France. Parquée dans les camps de Rivesaltes et de Gurs, antichambres de la déportation, la famille fut alors séparée.
Jacques, sa sœur et sa mère passèrent in extremis entre les mailles de la solution finale, contrairement au père qui fut déporté et gazé en 1943. Ce meurtre transforma la méfiance de Sternberg en dégoût vis-à-vis de l’espèce humaine, capable d’une barbarie et d’une perversité innommables.
Les années d’occupation et de guerre déniaisèrent et endurcirent le jeune Sternberg. Elles précipitèrent sa mue mentale en le parachutant dans une sinistre arène dont le sanglant et perfide spectacle lui inspira par la suite quelques dystopies littéraires.
« J’aurai toujours gardé la conscience de survivre par miracle dans un monde de tueurs et de sadiques, de fous furieux et de malades de la violence, de névrosés de l’ambition à n’importe quel prix, surtout s’il s’agit de prix réduit d’une autre vie humaine ».
Rescapé miraculeux, il revint en Belgique à la fin de l’année 44. En 1945, il rencontra Francine, sa future femme qui lui donna un fils en 1946, lequel deviendra également écrivain sous le pseudonyme de Lionel Marek. Une période sévère de vaches maigres débutait. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Sternberg força sa nature nonchalante, enchaîna les petits boulots (emballeur, dactylographe, représentant, manutentionnaire, livreur…), puis s’installa à Paris où il vécut de façon austère jusqu’à la fin des années 50.
« Je ne suis jamais entré dans un bureau sans me demander comment m’en échapper ».
Parallèlement à ses travaux forcés derrière les barreaux des bureaux, Sternberg laissait libre cours à son inspiration littéraire débridée, encouragé par sa femme, davantage séduite par l’écrivain que par l’homme.
« Jamais je n’écrivis autant, parfois plus de 15 pages par jour, avec autant de rage, de flamme et d’imagination échevelée qu’au cours de ces sept premières années de travaux forcés ».
Sept longues années pendant lesquelles Sternberg essuya les refus systématiques des éditeurs parisiens. Ses textes écrits en transe interpellaient et déroutaient à la fois.
Après ces sept années de pain noir beurré de mélasse miséreuse, un déclic survint : le petit éditeur Eric Losfeld s’enticha des textes de Sternberg et consentit à publier La géométrie dans l’impossible, recueil de contes brefs, étranges et surréalisants.
Dans les années qui suivirent, Le névrosé de la prose parvint à accrocher de grands éditeurs, entre autres Albin Michel, Plon, Minuit, Denoël, Julliard…
Pour autant, son audience demeura limitée, sa horde de lecteurs clairsemée, les mandarins médiatiques choisissant de le laisser dans l’ombre, dans son ombre, lui qui aimait tant le soleil. Il est des étoiles que le regard ignore.
Seuls ses deux romans passionnels, Sophie, la mer et la nuit (1976), Toi, ma nuit (1965), ainsi que La sortie est au fond de l’espace (1956) eurent quelque retentissement, lui ouvrirent quelques perspectives qu’il ne sut pas faire fructifier. Ses autres textes traversèrent le ciel littéraire, comme des météores furtifs, simplement perçus et appréciés par quelques lecteurs buissonniers errant dans l’obscurité et daignant lever la tête.
Une œuvre protéiforme et une inspiration déferlante

Il transposait sa soif de liberté dans une écriture torrentielle tous azimuts. Ainsi, hormis la poésie qu’il exécrait mais qui transparaissait pourtant dans certains de ses textes, il s’essaya à tous les genres littéraires, complètement détaché du souci de s’accorder aux modes ou aux conformismes en vigueur : Recueil de contes ou de nouvelles (Contes glacés ; Histoires à dormir sans vous ; 188 contes à régler ; Futurs sans avenir...), romans (Le délit ; L’employé ; La banlieue ; Un jour ouvrable ; Toi, ma nuit ; Sophie, la mer et la nuit ; Mai 86 ; Agathe et Béatrice…), autobiographies et essais (Lettre ouverte aux terriens ; Mémoires provisoires ; Vivre en survivant ; Profession : mortel...), pièces de théâtre (C’est la guerre,Monsieur Gruber…), dictionnaires (Dictionnaire des idées revues…), chroniques, anthologies… Sternberg virevoltait comme un dément dans l’asile à ciel ouvert de son imaginaire.
Cet écrivain plurifacétique, véritable rubik’s cube de la littérature, ne se contenta pas d’être l’un des défricheurs de la science-fiction française ou l’arpenteur goguenard de l’absurde et du surréalisme, il s’érigea également en peintre épicé de la passion et de ses fleurs voluptueuses et se positionna comme l’un des contempteurs les plus acharnés de la société contemporaine.
En créant en 1955 le farfelu fanzine « Le petit silence illustré », « la seule revue qui n’ait strictement rien à dire », il fut le précurseur spirituel de Hara Kiri. Découvreur puis ami de Roland Topor, il était féru des dessins d’humour notamment ceux du cartoonist américain Chas Addams.
Son sens aigu de l’observation et sa sensibilité écologique l’ont souvent amené à être en avance sur son temps et à anticiper certaines tendances du futur, notamment le consumérisme à tout crin, la libération sexuelle de la fin des années 60, la monotonie abêtifiante du travail, la pollution urbaine.
« Quand on rédigera l’acte de décès de la planète ce qui, au rythme du progrès convulsif, ne saurait tarder, il suffira de quelques formules brèves pour tout expliquer. Victimes : les Terriens. Lieu du décès : la Terre. Cause du décès : l’enflure maladive de l’industrie et du commerce, la course à la production. Motif : le goût du lucre. Circonstances atténuantes : nulles. Amen ».
Sternberg écrivait sous les auspices de l’automatisme à la manière des surréalistes, particulièrement à ses débuts. Auteur prolifique et marginal, maudit et mordant, il tambourinait sur sa machine à écrire comme un forcené, au son cadencé du jazz. Ouverts à plein régime, son lance-flammes, son lance-fantasmes et son canon à obsessions carbonisaient les paysages mornes de la réalité sur les ruines desquels il recréait un univers personnel insolite et déconcertant.
Généralement, dans ses livres, Sternberg se met lui-même en scène dans un microcosme imaginaire, étrange et oppressant. La plupart de ses récits se déroulent dans une société hyper contrôlée, déshumanisée, cadenassée par une administration omnipotente et répressive, façon Kafka ou Orwell. Son sens de l’absurde évoque les cocasseries burlesques de Beckett et Ionesco.
La plupart de ses récits se déroulent dans une société hyper contrôlée, déshumanisée, cadenassée par une administration omnipotente et répressive, façon Kafka ou Orwell.
Son roman le plus extravagant est sans nul doute L’employé. Cet ovni surréaliste truffé d’excentricités est le récit halluciné d’un homme plongé dans un univers sens dessus dessous, sujet à un périple fantasmagorique et balloté entre remous oniriques et turbulences apocalyptiques.
Imaginez-vous un livre dont l’histoire ne dure en tout et pour tout qu’une minute ! Sternberg l’a conçu. Jérôme Lindon, éditeur chez Minuit, accepta de publier cette pépite picaresque, apothéose du non-sens, à condition de dégrossir et de ciseler le manuscrit initial, profus et verbeux à son goût.
Dans le même acabit mais moins déjanté, Un jour ouvrable retrace la journée d’un homme amnésique placé sous haute surveillance, pris au piège d’une société insipide et sans âme, sans cesse harcelé par une administration tentaculaire. Y déferlent une inventivité farfelue et un déluge de bizarreries. Jérôme Lindon refusa le manuscrit, dégoûtant une nouvelle fois Sternberg du milieu de l’édition.
Par ailleurs, Sternberg, intarissable débiteur d’allitérations et de sonorités crépitantes, fut un inventeur patenté de néologismes, de mots-valises et autres trouvailles lexicales :
« Des scrapules fournes rongent déjà l’intérieur des farges qui s’uguvent de craspènes » (Un jour ouvrable). « Pour m’ensaliver le sexe », « mignardeux », « quotimesquin » (L’anonyme).
Curieusement, il était aussi le spécialiste de l’auto-plagiat et se plaisait à recycler dans une nouvelle parution des bribes de ses anciens livres, parfois en les retravaillant, les complétant ou les adaptant, bafouant sans ambages les convenances littéraires.
Rétif à la noble et pompeuse littérature, il ne réservait son admiration qu’à de rares olibrius, parmi lesquels Céline, Miller, Cioran, Beckett, Faulkner, Bierce, Bove, Scutenaire, Rhys, Tevis. Il n’en était pas moins un pilier du café de Flore.
« De tous les écrivains publiés, je suis sans doute le plus vraiment, le plus profondément ignorant ».
Un œil sauvage, hétérodoxe et corrosif

Animé d’une sensibilité écorchée vive, il n’a cessé, dans ses fictions mais surtout dans ses essais et chroniques, de fustiger les travers de la société française et de railler les mœurs modernes. Il distillait sans relâche une misanthropie implacable, salutaire, une misanthropie quasi fraternelle paradoxalement susceptible de nous réconcilier avec l’homme, l’homme qui était en Sternberg donc en tout homme.
« Je sors peu, je me réfugie presque sans cesse chez moi, parce que, dehors, je me sens dans la peau d’un homme perdu au milieu d’un monde étranger où il ne côtoie plus que des sujets de malaise ou d’effroi, des raisons de rancoeur ou de rancune ».
Sternberg, en irréductible destructeur d’icônes, en doux dynamiteur d’académismes adipeux, en trublion radioactif, pulvérisait l’un après l’autre tous les cultes encaustiqués de son époque, spécialement ceux de la consommation, du travail, du divertissement, de la performance, de l’automobile. Sa distance au monde, sa lucidité sulfurique constituaient de puissants radars qui détectaient les moindres compromissions d’une société avide de pouvoir, de profit, d’efficience et de sérieux infatué.
« Il n’y a pas d’homme arrivé sur terre. Il n’y a que des hommes qui arriveront tous à la même mort. Au même tombeau ».
Indifférent aux dorures de la comédie sociale, il comparait la planète capitaliste à un dépotoir et ses habitants à un troupeau servile reclus dans un enclos miteux et ruminant à longueur de journée une bouillie composée de mièvres fadaises et de contraintes arides.
« Impossible de renier la sensation permanente que j’ai toujours eue au contact des hommes : celle d’être un étranger parmi eux. Un exclu. Un demeuré ».
À la manière d’un boxeur enragé, les coups de Sternberg pleuvaient sans trêve, puissants et répétitifs. Tel un fauve affamé, jamais il ne démordait, ne suspendait ses aversions, ne desserrait sa mâchoire ni son mépris.
Son anti-modernisme iconicide n’est pas sans rappeler celui de Cioran avec qui il entretint quelques échanges épistolaires. Ces deux génies marginaux partageaient de nombreux traits communs, notamment leur penchant solitaire, leur sentiment d’étrangeté au monde, leur lucidité dévoreuse d’illusions, leur répulsion pour la frénésie citadine, leur soif de vivre et leur hantise de la mort.
« Je ne suis pas certain d’avoir une cervelle. En revanche, curieusement – ou par l’effet d’une complicité souterraine – j’ai toujours compris la plupart des aphorismes de Cioran, le seul essayiste plus noir que la nuit qui m’a toujours paru lumineux, implacablement lisible ».
Mais l’analogie la plus saillante qui les rapproche est le décalage saisissant entre la misanthropie fielleuse ruisselant de leurs écrits et la camaraderie avenante, badine et démonstrative dont ils faisaient preuve au contact des gens.
« Aussi méprisant intérieurement et aussi sociable en face des gens ».
« Disons que je suis un joyeux neurasthénique ou un amusant pessimiste ».
« Malgré son extrême sociabilité il avait la nature d’un loup solitaire » (Lionel Marek).
A l’instar de Cioran, l’écriture constituait pour Sternberg un refuge, une catharsis par laquelle il se libérait de ses hantises, de ses obsessions, de ses fantasmes.
Leur gémellité se précise nettement au regard de cette déclaration cioranesque de Sternberg : « Si on devait dire sincèrement ce que l’on a pensé des autres, on se ferait abattre. Et si on devait être vraiment sincère avec soi-même, on se trancherait la gorge ».
L’allergie cioranesque et rousseauiste que Sternberg vouait à l’homme lui servait de moteur. Elle prit vraisemblablement racine sous les coups de la matraque scolaire et des infamies guerrières.
À la manière d’un boxeur enragé, les coups de Sternberg pleuvaient sans trêve, puissants et répétitifs. Tel un fauve affamé, jamais il ne démordait, ne suspendait ses aversions, ne desserrait sa mâchoire ni son mépris. Comme tous les misanthropes attachants, il détestait plus le système, la grégarité médiocre et stupide symbolisée par un troupeau de bovidés bavant et beuglant que l’individu en lui-même.
« Ne jamais emboîter le pas aux meneurs de groupe, que leur emblème soit une croix ou une bannière, une faucille ou une enclume, un sabre ou un signe cabalistique ».
La quintessence de ses charges les plus vitriolées innervent particulièrement deux de ses essais rédigés dans les années 70, véritables cocktails Molotov lancés à l’adresse de l’espèce humaine, cette « caste de castors destructifs » : « Mémoires provisoires ou comment rater tout ce que l’on a réussi » et « Lettre ouverte aux terriens ». Dans le prologue de ce dernier, il décline avec une virtuosité singulière et sardonique sa vision générale de l’homme : « Théoriquement, l’homme est un être humain. Pratiquement, c’est un tuyau percé aux deux extrémités. Mécaniquement, c’est un corps lourd qui roule d’un gouffre de temps à un autre. Biologiquement, c’est un squelette habillé. Poétiquement, c’est un héros au sourire si doux… ». La litanie au TNT se prolonge et se déchaîne sur deux pages entières.
Explications d’une non-éclosion

En piètre promoteur, il n’a jamais pensé à capitaliser ses maigres succès. Il les a plutôt gâtés par son immarcescible soif de liberté, son absence criarde de sens du sérieux et son dilettantisme.
Etanche à l’opportunisme, il abhorrait la flagornerie et refusait d’hameçonner ou de ranger sous son aile des personnes influentes susceptibles de faire décoller irrémédiablement sa carrière d’écrivain.
Au moment où il perçait timidement dans le milieu, Sternberg se mit à cracher son dégoût de l’homme moderne dans des chroniques journalistiques et dans des pamphlets enflammés. En distillant ainsi un fiel épouvantable et un persiflage indistinct dans France Soir, Le Magazine Littéraire ou dans ses essais, il suscita la défiance et engrangea avec succès un nombre croissant d’ennemis
En distillant ainsi un fiel épouvantable et un persiflage indistinct dans France Soir, Le Magazine Littéraire ou dans ses essais, il suscita la défiance et engrangea avec succès un nombre croissant d’ennemis
Sa plume était trop désinvolte, trop légère pour s’amarrer inconditionnellement à l’immense plateforme terre-à-terre du journalisme ou au ponton pontifié d’une carrière.
« Sternberg nourrissait une soif de reconnaissance, tout en cultivant l’ambition paradoxale d’être encensé par cette même société qu’il ne cessait de vilipender d’un livre à l’autre » (Lionel Marek).
Par surcroît, respectant à la lettre son incandescente et sauvage inspiration, Sternberg rechignait à remanier ses premiers jets, à polir et fignoler ses manuscrits, condamnant de la sorte ses œuvres longues à l’inégalité et à la surcharge.
« J’ai écrit trop vite quand j’étais jeune et débordant d’idées folles ».
« Des manuscrits qui ressemblaient plus à des cataclysmes verbeux qu’à des textes littéraires ».
« J’ai un style heurté, bourré de scories, mais c’est le mien ».
En s’abstenant de ratisser les herbes folles de sa littérature, il hypothéqua sérieusement ses chances d’emporter l’adhésion plénière des prestigieux éditeurs, notamment Gallimard, maison dont il rêvait d’intégrer le catalogue.
Trois de ses romans, parmi les plus aboutis, échappent à cette logique brouillonne et primesautière : L’employé, corrigé mot à mot et allégé de 150 pages par Jérôme Lindon, éditeur de Minuit et protecteur de Beckett, Un jour ouvrable et Sophie, la mer et la nuit, romans pour lesquels il tempéra son écriture à l’emporte-pièces, sa verve torrentielle et débraillée.
La femme et son mystère

Il lui a logiquement consacré plusieurs romans, notamment Sophie, la mer et la nuit , Toi, ma nuit , Agathe et Béatrice, Suite pour Eveline, Mai 86, Le cœur froid, chacun d’eux déclinant un voire plusieurs portraits de femmes qui témoignaient de la fascination qu’elles exerçaient sur l’écrivain belge.
A ce titre, il fut un peintre magistral de la passion dans le sens où il savait retranscrire avec lyrisme et poésie les sensations amoureuses, le rapprochement des corps, l’attraction magique entre deux souffles, les vertiges voluptueux des amants seuls au monde.
Les narrateurs de Sternberg étant des hommes, en vérité lui-même, la femme s’inscrivait avant tout comme un objet, un auxiliaire de charme, un objet qui remplissait toute la page. Au fil de ses livres, un même profil se dessina, l’archétype féminin selon Sternberg.
Tout d’abord, la femme s’affirme comme un refuge pour le héros sternbergien, une consolation à son destin médiocre et dérisoire. Là où il subit sa vie, piétine, s’enlise, dépérit, surgit une femme qui l’arrache à sa réalité. Elle le revitalise et assigne un sens, un chemin, un destin à son existence. Elle souffle un air frais et revigorant chassant l’asphyxiante et grisâtre monotonie du quotidien.
L’extase que lui procure la passion amoureuse l’encalfeutre à la façon d’un cocon, l’ignifuge de l’hostilité extérieure : « De cet espace gris et tiède que l’on appelait la vie, avait surgi un visage, enfin » (Un cœur froid).
Psychanalytiquement parlant, la terminologie romanesque que déploie Sternberg pour décrire la communion amoureuse évoque le fœtus baignant dans le liquide amniotique : « Enroulé autour d’elle, lové dans sa chaleur, déployé dans son odeur, noyé au plus profond de ce cocon de nuit et de douceur, d’âpreté et de silence » (Toi, ma nuit).
« Une cellule dont les parois n’auraient été que pénombre, tiédeur et fluidité » (Sophie, la mer et la nuit).
Les notions de chaleur, tiédeur, pénombre, humidité, viscosité, moiteur, feutre composent l’arsenal lexical récurrent de l’écrivain comme si le mouvement vers la femme correspondait à une tentative de retour à la plénitude foetale, une velléité de reviviscence de l’époque bénie où l’enfant ne faisait qu’un avec la mère. Par le truchement des mots, Sternberg, tâtonne, creuse, recompose l’amour originel et s’applique d’une certaine manière à le dépasser, à faire le deuil de cet idéal.
Dès lors, il n’est pas surprenant que Sternberg éprouve une passion viscérale pour la mer, signifiant homophone de la mère. La corrélation est frappante dans les romans Sophie, la mer et la nuit et Le navigateur.
Les aventures marine et féminine forment le lit d’une mémoire inconsciente et nostalgique du lien fusionnel entre la mère et l’enfant, comme une réminiscence du paradis perdu.
Sous un prisme similaire, Baudelaire, dans son poème “Moesta et errabunda”, clamait ainsi les charmes de la mer :
« La mer, la vaste mer, console nos labeurs !
Quel démon a doté la mer, rauque chanteuse
Qu’accompagne l’orgue immense des vents grondeurs,
De cette fonction sublime de berceuse ?
La mer, la vaste mer, console nos labeurs ! ».
La quête de la mère conduit immanquablement à la multiplication des conquêtes, notamment dans le roman qui affiche sans doute l’un des titres les plus longs de la littérature : Agathe et Béatrice Claire et Dorothée Nathalie Véronique Elise...
Le narrateur épris tend à se liquéfier, à redevenir un enfant passif et impressionnable. Son identité sociale se dissout littéralement : il n’a plus goût au travail, se détourne des autres personnes qu’il côtoie. La femme aimée occupe toute sa tête, mobilise toute son énergie, se substitue entièrement au réel. Comme si l’homme ressentait le besoin inconscient de se débarrasser d’une gangue épaisse et visqueuse agglomérée au fil du temps futile.
« Je suis tombé dans un véritable puits. Je ne vois plus rien. La réalité a perdu toute réalité… Mon travail me semblait ridicule… Mes relations me paraissaient ternes, sans intérêt et, pour la première fois, je me rendais compte que je n’avais pas d’amis et que je ne tenais vraiment à personne. Tous et tout me paraissaient étrangers, inconsistants, lointains » (Sophie, la mer et la nuit).
L’amour à la Sternberg est aveugle, la rencontre s’opère en dehors de toute rationalité. C’est ce qui lui confère toute sa puissance, toute sa magie. Il fait ressurgir chez l’homme des affects assoupis, des forces latentes, capables de tout dévaster, de tout submerger tel un raz-de-marée longtemps contenu.
Quand l’objet aimé le quitte, il sombre dans la déprime et l’aboulie.
Ce modèle passionnel, ce magnétisme sensuel rappellent à de nombreux égards le roman de Pierre Louïs La femme et le pantin, lequel inspira le film de Luis Bunuel Cet obscur objet du désir ou le roman d’un des écrivains préférés de Sternberg, Emmanuel Bove, L’amour de Pierre Neuhart.
L’homme se perd dans la passion. Incapable de revivre exactement et durablement l’osmose originelle, il compense cette lacune par un délire imaginaire et fantasmatique qui l’isole et le décramponne du réel.
L’autre caractéristique de l’idéal féminin dont Sternberg dresse le profil exhaustif dans Vivre en survivant est sa dualité, son ambiguïté :
« Sophie était ombre et lumière. Tout en elle évoquait cette dualité » (Sophie, la mer et la nuit).
La femme qui faisait vibrer Sternberg était terriblement équivoque, à la fois indolente et sauvage, désinvolte et disponible, tendre et rugueuse, naïve et mature, lucide et inculte. Elle était le point de jonction entre le feu et la glace.
« Elle était un contenu de douceur et de violence, de métal acéré et de velours, d’imprévu et de feu glacé » (Toi, ma nuit).
Malgré de nombreuses séquences érotiques, Sternberg élude ponctuellement l’acte sexuel lui-même, celui-ci signifiant l’interruption des délices du désir, et par là même l’impossibilité d’une symbiose perpétuelle.
En outre, son tempérament martien propulse le mystère féminin à son climax. Souvent dépourvue de passé, de personnalité, d’ancrage dans la réalité, de volonté, elle semble s’offrir dans toute la richesse déconcertante du présent. Pourtant, telle une volute de fumée, elle s’évanouit dans l’air et se dérobe régulièrement à l’appétence masculine. Insaisissable, incompréhensible et incompréhensive, dotée d’une étrangeté inquiétante, elle déconcerte le narrateur masculin qui reste perplexe devant ce mur d’impassibilité, d’inertie minérale.
« On parle volontiers de l’amour fou, mais on ne trouve que l’amour flou ».
L’amour à la Sternberg ne dure pas. Il ne s’épanouit pas dans une relation stable vouée à l’affadissement. Quelque chose entrave son évolution, le rend éphémère ou impossible. L’évanescence féminine n’y est pas étrangère.
Malgré de nombreuses séquences érotiques, Sternberg élude ponctuellement l’acte sexuel lui-même, celui-ci signifiant l’interruption des délices du désir, et par là même l’impossibilité d’une symbiose perpétuelle. Sternberg diffère le reflux du désir tel le reflux de la mer… ou de la mère. Il tâche mordicus de prolonger cet entre-deux magique et incertain où le désir dure, s’étoffe, se nourrit de fantasmes.
Si la femme sternbergienne symbolise le refuge, elle porte aussi en elle le péril comme un esquif invisible planté au milieu d’une mer calme et étale. L’image de la Veuve noire, l’araignée capable de dévorer le mâle après avoir copulé avec lui, plane résolument au-dessus de l’homme subjugué.
« Et quand son sexe se referma doucement, gloutonnement, sauvagement, sur le mien, je compris qu’un nouveau piège venait de se refermer sur moi » (Sophie, la mer et la nuit).
Tel un vampire, un prédateur ou un félin languide, elle semble toujours en mesure de ne faire qu’une bouchée de sa proie, le mâle transformé en polichinelle vulnérable.
« Elle était aussi dangereuse qu’une trappe qui aurait donné l’illusion d’un sol plat » (Toi, ma nuit).
« Elle était nuit et noyade, brume et vase » (Toi, ma nuit).
En définitive, la femme soumet Sternberg à une équation insoluble, un dilemme terrifiant : elle est à la fois alternative au réel méphitique et créature venimeuse, ravissement et péril, consolation et menace. Elle est le seul horizon possible et une impasse.
La genèse de cet archétype féminin garde une partie de sa zone d’ombre. Il semble néanmoins que Sternberg se soit inspiré de sa femme Francine pour dessiner les contours itératifs de ses personnages féminins. En tout cas, il niait avoir transposé certains traits de sa propre personnalité dans ses héroïnes, malgré les apparences, malgré la proéminence chez elles des « trois Parques » sternbergiennes : l’indifférence, la lucidité, la dérision.
Une vie en dents de scie

De 1963 à 1972, Sternberg mena une vie dissolue, hédoniste, euphorique, oscillant entre mondanités et insouciance. La dolce vita. Crise de la quarantaine, phénomène de décompensation après les épreuves de la guerre et la galère sociale ? En tout cas, Sternberg se relâcha, élit un nouvel allié, l’alcool, alias Johnny Walker, s’adonna à un libertinage à la fois décomplexé et empreint d’une culpabilité larvée.
« Les périodes les plus heureuses de ma vie, les plus excitantes car les plus excitées, je les ai vécues dans la futilité, l’agitation, la frénésie physique et la soif de vivre, sans me gorger de mots, sans même penser à aligner quelques mots ».
« J’ai souvent été surpris de voir avec quelle facilité – proche d’une sorte de fatalité ? – j’ai pu séduire, troubler et mener au lit des jeunes femmes qui m’avaient explosé silencieusement le regard ».
« Je regrette surtout l’alcool pour la facilité qu’il donne face aux femmes que l’on veut séduire et pousser jusqu’à des sentiments plus troubles. On ne regarde plus les filles de la même façon, on n’écoute plus avec la même indulgence leurs petites bêtises ou leurs trop longs discours, on n’a plus la même envie de les toucher, de les humer, même en ne ressentant pas un tel besoin de les prendre ».
Au cours de son odyssée libertine, Sternberg chancela sous le charme de l’actrice Dorothée Blanck avec laquelle il entretint une liaison plus durable qu’avec ses autres maîtresses.
Sternberg boudait les femmes faciles et sans équivoque, laborieuses et ambitieuses :« J’ai une évidente prédilection pour les filles indolentes, assez taciturnes, peu actives, et les agitées – surtout les ambitieuses – ne m’excitent pas, m’agacent très vite ».
Il a largement retranscrit cette prédilection dans ses romans dédiés à Eros, notamment Sophie, la mer et la nuit, Toi, ma nuit.
Sa dilection initiale pour les femmes s’étiola au fil de leur évolution, au fil de leur virilisation.
« L’envie de baiser n’est plus aussi obsédante, les hors d’oeuvre me semblent le plus souvent si difficiles à avaler que, lassé à l’avance, je me passe du plat de résistance ».
Nonobstant son inconstance, l’attachement de Sternberg pour sa femme Francine, le phare de sa vie, perdura jusqu’à sa mort.
« J’avais mené une épuisante course poursuite pour dénicher la femme de ma vie alors que, confusément, je savais l’avoir trouvée depuis bien longtemps ».
Malgré les incompréhensions et les remous inhérents à la vie conjugale, malgré les nombreuses infidélités, malgré la versatilité et l’intransigeance de Francine, le couple n’explosa jamais totalement.
« Une liaison de plus de 50 ans, avec tant de hauts et de bas, d’illogisme et d’incurable attachement ne s’explique pas ».
« Je n’ai jamais réussi à comprendre ma complexe compagne ».
Au crépuscule de sa vie, Sternberg confessa ce terrible aveu, révélateur de sa solitude et des tragiques incidences de la vie à deux :
« Je n’ai jamais été aimé par personne puisque j’ai réussi à lasser et à décevoir toutes les femmes que j’ai pu connaître. Surtout celle qui, plus déçue que toutes les autres réunies, est restée dans ma vie, pas seulement à contrecoeur depuis bien des années, mais contre ses sentiments refroidis, donc avec tous ses regrets et ses ressentiments que j’accepte, écrasé de culpabilité ».
Sternberg réintégra sur le tard le giron conjugal, allant jusqu’à renier sa maîtresse au long cours, Dorothée Blanck, laquelle fut persona non grata lors de ses funérailles.
Sternberg ne s’est guère épanché sur la nature de sa relation filiale. Sans doute fut-elle balisée de distance et d’ombrage au vu des confidences de son fils, Jean-Pol Sternberg :« Mon père, je ne l’aurai vraiment approché de façon intime qu’entre 1990 et 2002 ». « C’est l’écriture qui aura bel et bien fini par cimenter notre relation, hélas tardivement ».
Dès les années 70, Sternberg perdit de sa combativité, son fatalisme s’enracina plus profondément, son étrangeté au monde se densifia : « Je n’ai plus le courage ou la volonté de lutter. J’ai sans cesse la sensation d’avancer à contre-courant dans un monde de moins en moins concerné par la sincérité, l’imaginaire et le délire, de plus en plus passionné par la platitude, le quotidien et le prisunic. Je ne sers à rien dans cette nouvelle société promotionnelle hantée par la réussite ».
De 1974 à 1983, il vécut 6 mois par an dans le calvados, au bord de la Manche, s’adonnant à ses passions solitaires, la voile et l’écriture, ses seules consolations avec les femmes. Le reste du temps, il végétait dans la capitale française, encapsulée sous le fracas, la pollution et la promiscuité. Il n’y circulait qu��’en Solex, toujours dans la marge, loin du marécage de la bien-pensance et du milieu à l’huile littéraire.
« J’ai toujours détesté la dignité, la vertu, l’amour-propre, l’honnêteté, le sérieux, toutes ces qualités qui sentent le détergent ». Il n’adorait pas pour autant la campagne, ce « gigantesque cimetière » qui attisait son angoisse existentielle.
Dans les années 80, la veine créatrice du martien déboussolé commença à se raidir, sa mécanique élucubrante à s’enrayer. Conscient de sa déchéance physique, le moral de Sternberg se teinta d’une lassitude amère, lui que le besoin d’exercice et d’écriture avait constamment tenaillé. En 1985, suite à une diplopie l’affectant pendant 5 mois, il cessa de fumer et de boire.
Suite aux échecs de ses romans L’anonyme et Le shlemihl, il se rabattit sur le format court, le conte, où sa fulgurance étincelait.
Son ultime opus « 300 contes pour solde de tout compte » parut en 2002.
Au final, en dépit de son impression d’être passé à côté d’un destin et d’avoir été un satellite maudit de la planète littéraire, l’Attila du Flore peut légitimement se prévaloir d’avoir graver une empreinte singulière et percutante dans le marbre des mots. Auteur d’une cinquantaine d’ouvrages, il fut édité par les plus grands, y compris Gallimard (4 livres en folio), Bernard Pivot l’invita une demi-douzaine de fois à participer à son émission phare, Apostrophes, où l’on s’ébahit de le voir consumer clope sur clope, il participa activement à l’effervescence culturelle des années 60 et 70, il écrivit le scénario du film d’Alain Resnais Je t’aime, je t’aime présenté au festival de Cannes, la Comédie Française joua l’une de ses pièces de théâtre « C’est la guerre, monsieur Grüber », et, cerise sur le radeau, le Ministre de la Culture, Renaud Donnedieu de Vabres, lui rendit un vibrant hommage posthume : « Avec Jacques Sternberg, la littérature francophone perd l’un de ses représentants les plus singuliers, le créateur d’un univers déroutant… ».
Placé sous le signe du désir, de la débrouille, de la dérision et de la dérive, son parcours contrasté et cabossé émeut ceux qui veulent bien s’aventurer dans ses dédales.
Sternberg n’a jamais capitulé, ne s’est jamais renié. Il s’est acharné à confectionner une littérature artisanale, biologique, de plein air, avec toute la luxuriance, le chaos et les imperfections que les pesticides d’une littérature industrielle, intensive, lyophilisée auraient inéluctablement pervertis.
Placé sous le signe du désir, de la débrouille, de la dérision et de la dérive, son parcours contrasté et cabossé émeut ceux qui veulent bien s’aventurer dans ses dédales.
S’il sévissait encore parmi nous, Topor aurait sans doute griffonné l’oeil martien et corrosif de Sternberg surplombant une civilisation malade, véritable écheveau d’acier, de gadgets, de vernis, de goudron et de brume. Cet œil joue encore aujourd’hui un rôle d’antidote à la cécité béate et aux certitudes contemporaines.
Amoureux de la mer, on pourrait dire de Sternberg qu’il a délaissé séquentiellement son port d’attache, Francine, qu’il s’est échoué à de nombreuses reprises sur l’esquif luxurieux de l’infidélité, qu’il a essuyé les grains de l’alcool et du tabac, et qu’il s’est débattu contre les vents froids et contraires de la guerre, des boulots minables et des déceptions littéraires… sans jamais chavirer vraiment.
« Bref toute une vie en dents de scie très éprouvante le plus souvent, non pas une lente ascension vers le succès et la réussite, mais une suite permanente de dégringolades et de remontées, de nouvelles chutes et de reprises imprévisibles ».
Cet aveu claquant et caustique résume à lui seul l’état d’esprit du personnage :
« Parti de rien je ne suis arrivé nulle part ».
Hanté toute sa vie par la peur de la mort, celle-ci l’emporta réellement en 2006 à l’âge de 83 ans, suite à un cancer du poumon. Incinéré, il n’aura finalement pas échappé à l’instrument crématoire.
Un peu gauche à traverser la vie, il est désormais passager d’un autre monde, ce monde aux quatre dimensions qu’il aimait tant titiller et lutiner de son imagination.
« La mort, décidément, m’aura gâché toute ma vie. Rien de ce que j’ai vécu ne pourra me consoler de cette certitude d’y passer un jour. Une seule question reste en suspens : est-ce que la mort me consolera de ma vie ? ».
Cyrille Godefroy