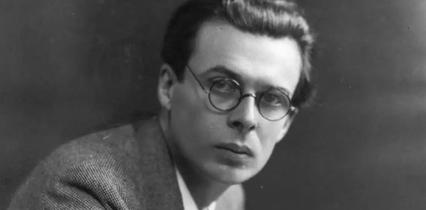À la fois points d’attachement et de répulsion, les paysages d’enfance restent souvent des lieux de mémoires contrastés dont on s’émancipe rarement sans souffrances. Cela fait partie de la vie. Il n’est pas nécessaire d’en faire toute une histoire. Mieux vaut en faire un recueil, à l’instar de Thomas Flahaut avec Bleu Laguna.
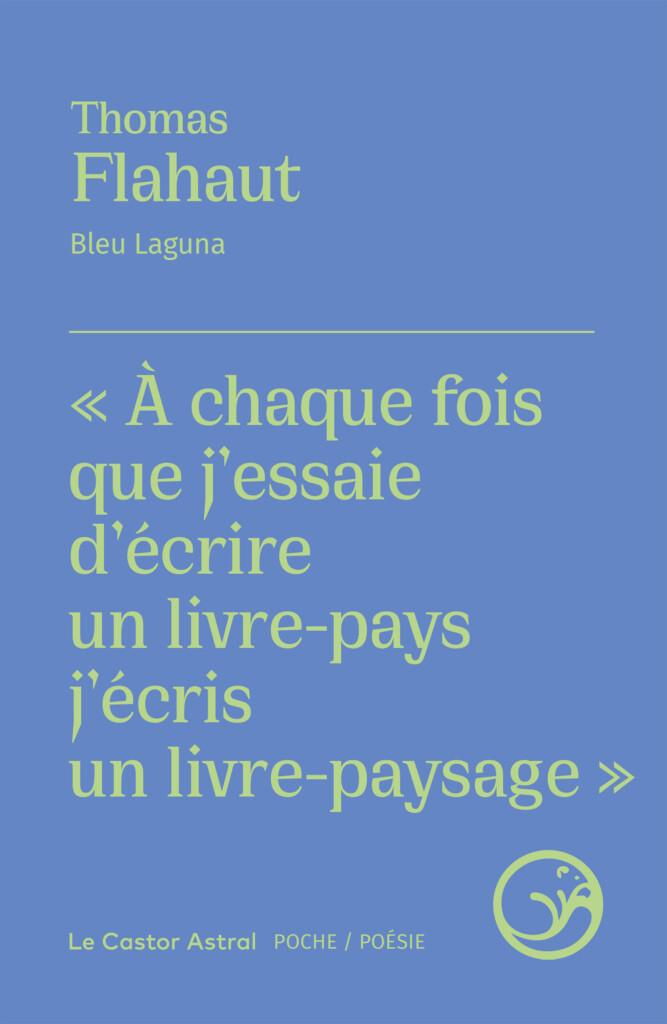
Ce qu’ils appellent « la zone » n’est ni un concept, ni un espace mais une réalité qu’il faut avoir vécue pour pouvoir l’exprimer. Tout le monde n’a pas la chance de grandir à Paris. Thomas Flahaut, lui, est originaire du Doubs ; ce département frontalier que jadis le général Johann August Suter dans L’Or de Cendrars traversait pour faire fortune en Californie. Cent ans plus tard ce n’est plus outre-Atlantique mais vers l’Helvétie que l’on se dirige : « La frontière suisse larve, invisible, entre les deux Jura. Sous les sapins, les étangs et les montagnes, elle se glisse comme une taupe. Les motos des ouvriers frontaliers filant dans la nuit la percent en mille endroits, la franchissent, l’écrasent ».
Dans le temps des machines
C’est qu’en Suisse, il y a des usines, donc du travail. Même si celui évoqué par Flahaut est plutôt répétitif : « des bobines / des stators / des bobines / des stators / des bobines / des stators / des bobines / des stators / et toi peut-être / quelque part / dans une pause / un mouvement / retenu / de la chaîne / dans une panne / un espace possible / de temps / de rêve entre / des bobines / des stators / des bobines / des stators ».
Se situant volontairement dans le sillage d’auteur et d’autrices ayant écrit sur les conditions de travail en atelier tels que « Robert Linhart, Leslie Kaplan, François Bon et Thierry Metz » (auxquels il faudrait ajouter Joseph Ponthus), Flahaut reprend et développe l’imaginaire d’une classe ouvrière en pleine mutation qui avait déjà fait la force de ces premiers romans : Ostwald (2012), Les Nuits d’été (2020). Plus encore que ces deux ouvrages précédents, Bleu Laguna se distingue par une prosodie, par un rythme (l’auteur parle de « syntaxe ») davantage inspirés par le rap que par un Alfred du Musset, par exemple. Ce n’est dès lors pas un hasard si le recueil porte en exergue une ligne du rappe...