
Que faire des souvenirs du monde d’avant nous ? Depuis l’espace où elle se sent grandir et où elle voit vieillir autour d’elle ses parents, ses souvenirs et l’amour passé mais pas oublié, Milène Tournier propose en cette rentrée littéraire une forme sinon nouvelle, au moins d’une bâtardise belle et rare : l’autobiographie poétique. Se coltiner grandir, comme un chemin d’écriture-croix, vient de paraître aux éditions Lurlure.
Au Commencement n’était pas Milène Tournier mais les mots, eux, étaient prêts à l’attendre et entendaient déjà les échos du futur approchant. Ils rôdaient autour d’elle comme les fées parfois survolent le berceau dont la légende préconise de prendre soin pour que l’histoire prenne la tournure escomptée.
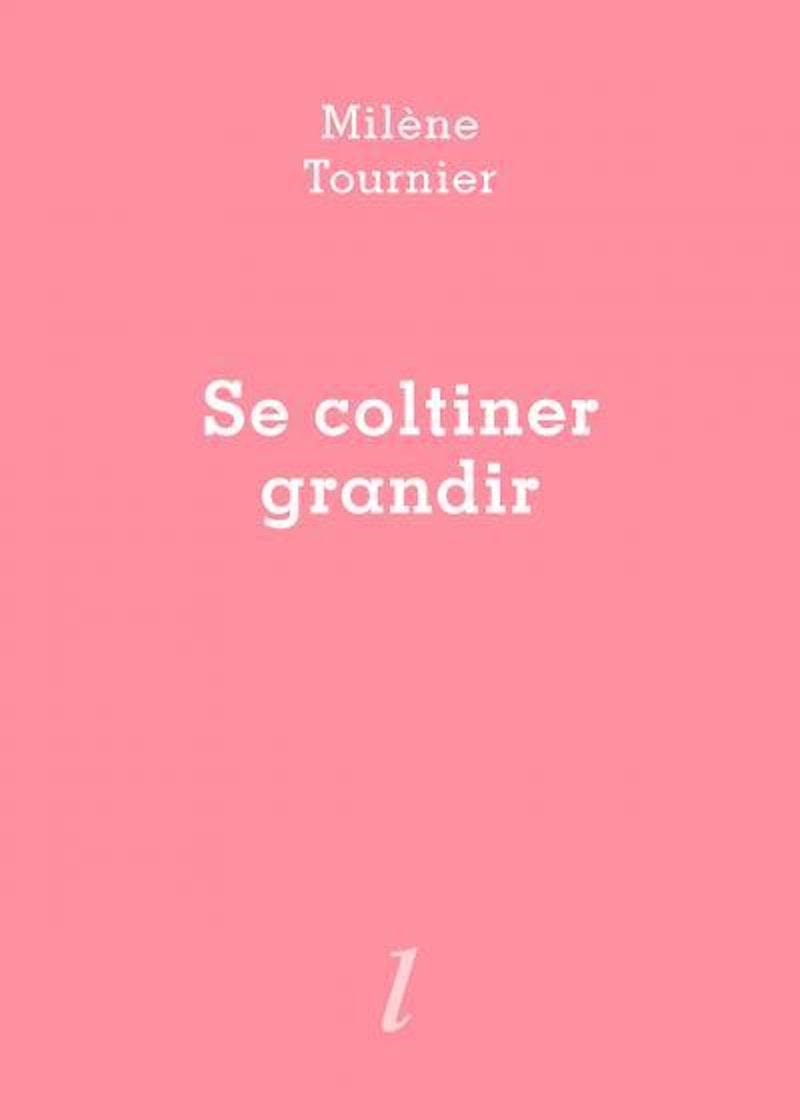
Au Commencement était le Verbe. On l’a dit, redit et répété : la Création est une action que seul le langage premier pouvait accomplir. Les poètes ont eu beau tordre la langue, l’enrouler sur elle-même, elle est demeurée le modèle initial à partir duquel tout est devenu possible et grâce auquel (et c’est peu de l’écrire), toute poésie se positionne et grandit dans ses lecteurs. L’impératif premier fut et les réalités du monde à venir advinrent alors toutes ensemble.
“Alors, après avoir inventé d’abord l’impératif, qui est le désir et l’impatience du langage, puis le langage, Dieu – comme un enfant commence à parler et veut tout nommer et désigne, pour qu’on les lui nomme, toutes les choses autour, et répète et en répétant mémorise, et désigne autre chose et répète et mémorise, et ainsi prend forme, en doigt, réponse et répétition, le monde sous sa langue -, alors Dieu comme un enfant se mit à hurler.”
Mais le monde – c’est terrible mais c’est vrai – ne commence jamais à partir de soi et l’on se doit d’accepter qu’avant nous, il n’y avait pas rien et qu’après nous, il y aura encore d’autres êtres dont (peut-être) nous ne ferons plus partie, même pas en souvenirs. L’autobiographe-poétesse en prend conscience quand elle se rend compte qu’avant sa naissance, l’Écriture, déjà, par la main du père, existait. Il tenait des classeurs anté-Milène, sortes de journaux intimes précédant sa naissance, comme un passage de plume de l’Ancien Livre du Père au Nouveau Poème de la Fille-née.
Il lui faut alors accoucher non pas de la fresque du père (il l’avait très bien fait avant elle dans ses cahiers consignés) mais écrire leur vie désormais partagée. Faire résonner de son vivant l’avant-soi et le désormais-nôtre que lui permet le recopiage de la Parole retranscrite, l’attendant à la cave, disponible pendant la petite course de l’après-midi mais redoutée déjà pour l’irrémédiable Absence qu’elle annonce pour plus tard, à voix redoutante et tremblante.
“De son vivant, je photographie ma naissance manuscrite et retape et relis. De son vivant, je remets en vitesse les classeurs lorsque j’entends la voiture se garer des courses, de son vivant j’avoue, plus timide de narcissisme qu’honteuse d’avoir fouillé, à mon père, en séparant les yaourts de leur emballage carton avant de les ranger au frigo, que j’y suis encore allée voir. Et de son vivant, on en rit. De cette obsession. De son vivant, parce que le faire de son mourant sera autre chose. Et parce que lui m’ayant, j’en suis un peu sûre, tenue en vie grâce à ses mots, d’avoir glissé le mot Milène dans ses autres mots, j’espère peut-être, moi aussi, souffler mon père en vie, encore beaucoup de classeurs et livres.”
Ne partons pas trop vite ; allons marcher encore. – Où vivre ?
Le Père photographie, la Mère observe et s’émerveille et la Fille, auprès d’eux, écrit qu’elle a grandi. Mais elle grandit sans âge véritable et ses souvenirs, s’ils sont consignés pour certains dans ce livre, n’ont pas vocation à vieillir non plus. Simplement, ils sont là ; avec elle et ses parents tout près grandissant avec les textes qui habitent les souvenirs communs et les paroles échangées, parfois timidement, comme on murmure le soir ces phrases essentielles avant de s’endormir, rassurés et confiants. Face aux immenses adultes qu’on croit longtemps ne jamais pouvoir dépasser, le monde est un théâtre. Ils l’habitent si bien que les yeux de l’enfant pourraient alors croire que tout ne dépend que d’un geste d’adulte pour exister et s’animer.
“Dans la baie vitrée du dernier étage de la galerie commerciale, le père parlait, pour moi, à toute la ville. Et me donnait, si l’on était dans une sorte d’autobiographie, une leçon à sa façon de photographie. (…)
Et je riais, et je riais.
Je riais comme dans une autobiographie.”
Dans le pèlerinage de sa propre histoire, Milène Tournier ne cherche pas à saisir poétiquement ceux qui lui ont permis d’arriver au monde mais propose plutôt de les (d)écrire en doubles poétiques légers, à la manière d’Henri Michaux et de son certain Plume.
Seulement, les parents sont des coquelicots fragiles ou des dieux mortels, – suivant la formule qu’on préférera adopter. Dans le pèlerinage de sa propre histoire, Milène Tournier ne cherche pas à saisir poétiquement ceux qui lui ont permis d’arriver au monde (car, au fond, ce serait faire affront aux photographies du père sensible et joyeux) mais propose plutôt de les (d)écrire en doubles poétiques légers, à la manière d’Henri Michaux et de son certain Plume. Même s’ils meurent, ils pourront de nouveau mourir quelques pages plus loin et il y aura entre ces pages la possibilité d’un sauvetage poétique et de quelques canaux immobiles sur lesquels faire étape et demeurer encore auprès d’eux.
Au fond, c’est dans l’action sublimée par l’écriture que la poète-autobiographe se retrouve face à sa conscience infantile d’un vide infini. Elle aime et en aimant dit : “Puisque vous allez mourir, c’est moi qui vous laisse ici. Mais je reviendrai. Et quand je reviendrai, promettez-moi d’être là, le temps encore de vous faire une promesse.” Alors seule face à l’immense vertige de voir mourir sans avoir vu grandir ses parents, elle décide de rassembler dans un désordre de cœur tous les moments dont ils étaient les témoins privilégiés, même au milieu d’une foule d’un centre commercial. L’enfant qui grandit oublie toujours que ses parents, eux aussi, grandissent encore un peu avant de disparaître et c’est ici souvent par la voix et le souffle que s’entendent les prémisses de la fin des chansons à voix partagées ; les balades auprès d’eux ne seront plus aussi longues que ces après-midis d’été à manger des abricots parfois un peu trop verts.
“J’ai demandé au père “Je suis déjà triste alors
De jouer de l’harmonica. Que personne d’entre eux deux
Il a sorti, d’abord, sa Ventoline.” N’a encore commencé à mourir.”
“Il faudra penser / à aussi un Big-Bang / Pour la fin.”. – Comment s’aimer ?
“Maman, rassure papa, j’ai trouvé
Un garçon pour regarder
Doucement blanchir mes cheveux.”
Quand elle arrive en ville en athlète-poète, l’écriture poétique se trouve une quête ; le moindre détail, la moindre solitude sera accompagnée, même de loin, parfois avec un seul mot, comme la possibilité d’un rivage auquel accoster et souffler quelque temps.
D’une ville l’autre, Milène Tournier arrive à Paris, ville dont elle sera toujours étrangement familière. Alors elle marche, et marchant, elle écrit et s’écrit en même temps, pas à pas, quitte à se tromper de rue ou bien de direction. Quand elle arrive en ville en athlète-poète, l’écriture poétique se trouve une quête ; le moindre détail, la moindre solitude sera accompagnée, même de loin, parfois avec un seul mot, comme la possibilité d’un rivage auquel accoster et souffler quelque temps. Sans doute qu’une grande ville, c’est comme de nouveaux parents qui nous dépassent ; on la voit changer en notre absence, on ne la reconnaît pas toujours et elle nous surprend souvent à un moment où on croyait la connaître suffisamment pour que ce ne soit plus possible ou crédible.
Puisqu’il a fallu grandir et vieillir, il a fallu aussi aimer des corps et des êtres moins familiers qu’eux deux. Le garçon est parti – on le sait depuis Je t’aime comme, le précédent recueil qui précisément recueillait le cri d’amour tout juste disparu – mais la marche avait débuté à partir de lui et même en ne sachant plus vraiment où l’on va, l’exercice quotidien nous permet d’errer et d’aimer, timidement, encore un soir.
“S’il te plaît pose
Une ville
Sur ma tombe.
Et après pose
Sur ma ville
Ta main.”
Dans la ville poétique de Milène Tournier, tout devient prétexte à incarner le soliloque amoureux. L’insupportable disparition s’équilibre avec l’inépuisable réparation poétique : je m’écris seule donc je suis avec vous.
” Je me suis allongée dans la cuisine, cette nuit.
C’était comme frauder dans le métro.
Je t’aime encore.
(…)
J’attends j’attends j’attends.”
“Trop d’éternité ou pas assez, ça fait pareil au ventre,
D’avoir encore trop longtemps à devoir vivre,
Ou pas assez.
Il faudrait savoir être heureuse (…)
J’ai été quittée”
Car se coltiner grandir, c’est aussi (et peut-être surtout) “avoir trente ans à trente ans”. C’est se demander si quand le monde mourra, nous mourrons avec lui et près de quelles solitudes à qui tenir ou lâcher la main si tout alors se met à trembler comme le soir dans les villes, au début de l’hiver. Se coltiner grandir n’est pas un suicide poétique mais peut s’appréhender davantage comme un reliquaire où l’archive amoureuse est consignée mais disponible, secrète mais ouverte aux regards et aux coeurs qui s’approchent. Puisque les mots ne vieilliront jamais aussi vite que nous, laissons-les veiller auprès de ceux qui les accepteront comme la promesse d’un rêve familier et tranquille. Les mots sont des rails pour accueillir nos peurs, et même si certaines nuits (peut-être) seront froides cet hiver, au moins restera-t-il ces chemins affectés de poèmes, cette vallée urbaine à égale distance du ciel et de la terre, prête à accueillir, qu’on en soit capable ou non, ” un grand et beau cri, un long et joyeux cri qui résonnerait (…), ce bonheur-là que [l’on] devrai[t] [s]’offrir, hurler une bonne fois.” (Juste la fin du monde, Jean-Luc Lagarce).
“Et il y avait un rail pour mes peurs,
La peur de la vie, la peur de la mort, la peur de la mort de mes parents, la peur d’une vie entière avec mes parents, la peur de ne pas avoir d’enfants, la peur d’en avoir, la peur de l’an prochain, la peur de la moindre chose qui viendrait fissurer l’an prochain, la peur de l’hiver au premier jour enfin de juillet,
La peur surtout que la vie et la mort se rejoignent comme on nous parle je sais pas quoi d’un métavers, et qu’on passe alors notre vie à être les morts de quelqu’un d’autre.”
Crédit photo : (c) Fitaki Linpé

















