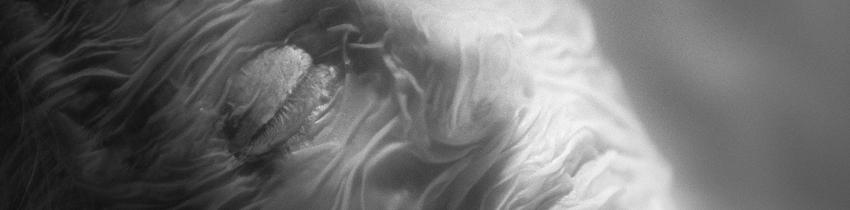« Quand la réalité scintille » : Rencontre avec Arnaud Desplechin pour évoquer son nouveau film, Tromperie, mais aussi l’œuvre de Philip Roth, le travail d’adaptation et de mise en scène, la judéité, la fidélité à soi-même et les souvenirs amoureux arrachés à l’oubli.

Arnaud Desplechin : Concernant les personnages, c’est pour moi le thème du jeu qui prévaut. C’est par le prisme du jeu que j’ai trouvé la façon de faire le film : Léa Seydoux joue à être anglaise et Denis Podalydès joue à être un écrivain américain. C’est un jeu qui est proposé au spectateur dès le début puisqu’on est dans un théâtre qui ressemble aux Bouffes du Nord, et voilà que Léa Seydoux ferme les yeux, et quand elle les rouvre, nous sommes dans l’appartement de Philip, donc il y a un jeu. « Tromperie » parce que, bien sûr, c’est un adultère pour chacun des personnages, mais tromperie peut-être aussi à travers le fait que le personnage incarné par Léa va se retrouver dans le livre de Philip et qu’elle ne le désirait pas forcément. Enfin, évidemment, il y a tromperie par rapport à l’épouse de Philip, qui lui demande pourquoi le personnage s’appelle Philip et pas Zuckerman, ce qui rend possible une identification stricte de l’écrivain et du personnage du film. Mais, à travers ce titre que je pourrais prendre à rebours, ce qui m’a obsédé pendant la préparation, c’est la fidélité à soi-même. C’est d’ailleurs le cœur de la dispute entre Denis Podalydès et Anouk Grinberg (qui incarne l’épouse du personnage de Denis Podalydès, ndlr) : Philip ne peut pas faire autrement que d’être fidèle à lui-même. Je crois qu’il est épris de sa femme, tout comme il est épris de Léa Seydoux, mais d’une autre façon, et pourtant il ne peut pas renoncer à être fidèle à lui-même. Mais toujours sur ce thème de la tromperie, j’ai l’impression qu’à travers la conversation que ces femmes entretiennent avec Philip, elles s’émancipent et se réapproprient quelque chose d’elles-mêmes à travers les vicissitudes de la vie, l’exil, les tourments, les mariages malheureux, le temps qui passe… En parlant avec Philip, ces femmes récupèrent un peu d’elles-mêmes, et à travers cette relation adultérine, elles redeviennent fidèles à elles-mêmes.
C’est le procédé de l’écriture qui permet cet échange réciproque entre Léa Seydoux et Denis Podalydès. C’est la première fois que vous abordez aussi frontalement le personnage de l’écrivain. Comment avez-vous pensé dramatiquement la mise en scène de ce personnage, statique dans son travail, mais dont l’écriture et la parole vont convoquer une diversité de lieux et d’atmosphères ?
Arnaud Desplechin : La distribution du film m’a aidée énormément. Car Denis est l’écrivain que l’on sait et j’ai beaucoup d’admiration pour son écriture – je suis d’ailleurs en train de terminer la lecture de son dernier livre sur la Nuit des Rois(Les Nuits d’amour sont transparentes, éd. du Seuil, 2021, ndlr). Denis est un écrivain et un lecteur. Philip Roth était lui aussi un immense lecteur, on le sait par les textes qu’il a écrits sur les auteurs qu’il admirait : Kundera, Privo Levi, Aharon Appelfeld, etc. Du coup, avec Toma Baqueni, le décorateur, nous avons fait un travail de documentation énorme à partir de toutes les photos et les documentaires consacrés à Philip Roth, ce qui nous a permis de reconstituer son bureau à l’identique. Dans le film, les stylos sont ceux de Roth, la machine à écrire est la sienne, l’écritoire, la batte de base-ball dans un coin, bref, c’était absolument pareil. Du coup, c’était un terrain de jeu formidable pour Denis, et je lui ai laissé une grande liberté pour improviser au sein de ce décor. Bien sûr, j’avais des suggestions à lui faire, et nous travaillions à partir d’un découpage des scènes très précis, mais il se servait de tous les accessoires du décor pour donner cette dimension physique du travail de l’écrivain.
« Il s’agit d’arracher au temps quelques phrases »
Je tenais à ce qu’on voie le côté physique de l’écriture, l’engagement du corps. Et c’est une chose que Denis savait faire assez spontanément, car pour lui ce n’est pas mystérieux d’écrire, et du coup il y avait une incarnation très forte du geste d’écrire. Je crois ainsi que pour le personnage de Philip, le geste d’écrire revient aussi à laisser se déposer en lui les voix de ces femmes dont il est amoureux. On le voit au tout début du film, car Léa lui raconte une histoire, quand son mari a reçu un disque de son amante, La jeune fille et la mort de Schubert, et Denis essaie de noter les mots, de sauver le temps qui passe, de sauver les souvenirs de cet amour précaire. Car les amours extra-conjugales sont nécessairement précaires, car un jour ou l’autre on sait que ça se terminera et il s’agit d’arracher au temps quelques phrases, c’est ça que je trouvais magnifique dans le livre et que j’ai essayé de retranscrire à travers le film.
Le thème de la mise en récit de relations adultérines relie votre film à L’homme qui aimait les femmes de Truffaut, notamment dans cette belle scène où vous cadrez en gros plan la boule Pica de la machine à écrire utilisée par Denis Podalydès, qui est une référence à un plan de Truffaut, où il cadrait Charles Denner écrivant à la machine.
Arnaud Desplechin : Bien sûr, nous y avons beaucoup pensé ! Au cinéma, Charles Denner est un des acteurs fétiches de Denis. Évidemment, dans ce rapport aux femmes, dans cette collection de femmes, le personnage de Philip peut sembler réactionnaire, alors qu’il est le contraire d’un womanizer, il se laisse plutôt emplir par ces voix féminines, il se laisse déborder par les femmes qu’il a aimées, qu’il a connues ou qu’il a méconnues, et son livre procède de cela. L’homme qui aimait les femmes est un de mes films cultes et il faisait partie des films que nous avons révisés scrupuleusement avant le début du tournage.
À travers votre filmographie, on décèle une proximité thématique avec Philip Roth, notamment sur le traitement de l’Europe de l’Est, ou encore la question juive, on peut ainsi songer à La Sentinelle. Quelle relation entretenez-vous avec l’œuvre de cet auteur américain ?
Arnaud Desplechin : Pour moi, Philip Roth, c’est au départ un immense éclat de rire quand je découvre Portnoy et son complexe. En découvrant ce livre, je découvre non pas de l’humour, mais une explosion de rire américain, et ce rire procède de deux choses qui, à mon avis, ne font qu’une : Philip Roth se sert de lui-même, de ses origines, de ses obsessions, de la même manière que je me sers de moi-même sur mes films. C’est-à-dire qu’il est à lui-même son propre matériau : de nombreux romans de Roth se passent à Newark ; de mon côté, 9 films sur 10 que j’ai faits passent par Roubaix. Mais surtout, il se fait déchoir : c’est-à-dire que ce n’est drôle de se servir de soi-même que si l’écrivain déchoit de son piédestal, si tout d’un coup l’écrivain est ridicule. Cette capacité à se moquer de soi, se déguiser et utiliser tout ce système de masque est ce dont je suis tombé amoureux dans l’œuvre de Roth. Il est vrai que me frappaient deux obsessions chez Roth : une singulière et une incontournable. Une obsession singulière pour les pays sous oppression soviétique, qui est un thème qui me passionne également, je pense à Trois souvenirs de ma jeunesse.
De par mon âge, je me souviens que l’Europe n’était pas une, l’Europe était en deux, et c’est un sujet qui me passionne encore aujourd’hui. Tromperie s’ouvre sur une vue des Twin Towers, c’est-à-dire avant la chute des tours du 11 septembre 2001. C’est un autre monde, un monde encore coupé en deux, et ça me passionne, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Peut-être parce que j’ai lu les écrivains dissidents, et qu’ils m’ont beaucoup apporté, notamment les écrivains dissidents russes, mais aussi Kundera, et les écrivains dissidents tchèques. Le regard porté sur les pays opprimés vous permet d’apprendre que dans le monde capitaliste on n’est sans doute pas aussi libre qu’on le croit, et on peut ainsi apprendre quelque chose des dissidents. C’est un motif qui traîne chez Roth, à travers L’orgie de Prague qui se passe entièrement à Prague, puis ensuite, il parlera dans ses livres plus tardifs d’un système coercitif américain, je pense à Comment j’ai épousé un communiste, La tache, The Human Stain, etc. Il est donc vrai que c’est un point commun entre Roth et moi, et je me reconnais terriblement à travers ces thèmes. D’où le fait qu’il n’était pour moi pas question de moderniser l’intrigue, je voulais absolument garder cette inscription d’un moment où il existait, de l’autre côté du mur, une oppression plus radicale encore que celle que l’on connaît, et je voulais garder cette présence d’un dialogue entre l’Est et l’Ouest.
« Le fait que nous dissemblions est pour moi source d’une grande joie »
Enfin, il y a l’obsession juive qui est absolument omniprésente dans les livres de Philip Roth. Je suis catholique, Roth est un écrivain juif, mais au cœur de ma vie s’inscrit la singularité juive, c’est évident et ça transparaît dans mes films, et la singularité juive est pour moi le sel de la vie même. Je le dis en tant que chrétien, en tant que non-juif, comme me réjouit dans les films de Renoir, dans La Grande Illusion, le fait que Dalio soit juif. Le fait que nous ne soyons pas tous pareils, que nous dissemblions est pour moi source d’une grande joie. Je ne pourrais pas vivre dans un monde où nous serions tous pareils, ce serait l’horreur. Pour moi, le plaisir est que nous soyons hommes et femmes, juifs et non-juifs, etc.
Cette présence des auteurs juifs est en effet récurrente dans vos films. Dans Roubaix, une lumière on apercevait des livres de Levinas sur le bureau du jeune policier. Levinas est un penseur qui a mis au centre de sa réflexion la notion de l’altérité, qui passe par une attention marquée au visage. Dans Tromperie , vous filmez en Scope et souvent de manière très serrée les visages des comédiens, était-ce pensé dans le but de donner toute leur place à la singularité des acteurs, et de faire naître l’émotion ? D’autant plus que ces plans alternent avec des scènes plus aérées en dehors du bureau de Philip. Comment avez-vous construit l’agencement des séquences pour adapter ce roman uniquement constitué de dialogues ?
Arnaud Desplechin : Vous avez cité Levinas qui est effectivement un penseur de l’altérité, mais qui passe plus précisément par le chemin de la « visagéité », c’est un penseur qui est ivre des visages. À ce titre, dans Tromperie, la caméra est ivre des visages des femmes. Je pense en particulier à une scène, quand Philip rejoint Rosalie (Emmanuelle Devos) à l’hôpital à New York après avoir eu deux longs coups de téléphone avec elle. On terminait la scène sur elle, Yorick Le Saux (chef opérateur, ndlr) était à la caméra et je lui disais de cadrer plus près le visage d’Emmanuelle pendant qu’elle disait à Denis : « Redis-le-moi, redis-moi que je vais vivre. » Et Yorick me disait que ce n’était pas possible de faire plus serré car on était déjà en très gros plan ; je lui ai alors répondu que je ne voulais pas un très gros plan, mais un « trop gros plan », ce qui n’était pas du tout la même chose. Donc ces plans très serrés sur les visages sont des choses qui se sont accentuées au tournage, mais ça nécessitait aussi de l’aération. Je me souviens que toute la préparation était très heureuse, mais quinze jours avant de tourner j’ai fait le compte et on devait avoir près de soixante-et-une scènes où un homme parle avec une femme dans un bureau. Je me suis dit que ça allait être à périr d’ennui.

Pour remédier à cela, on a fait feu de tout bois pour inventer des situations de paroles différentes, des tailles de cadre différentes. Je pense par exemple, à la scène du jeu du biographe : elle commence en intérieur, où Denis est assis au bureau, puis c’est Léa qui est assise au bureau, et lui est assis sur un canapé, il s’approche et la conversation se continue dans un parc. Voilà qu’elle veut raconter qu’elle n’a pas du tout aimé être enceinte, que c’était affreux pour elle, que c’était un cauchemar. Ça, c’est une confession qu’elle ne peut faire qu’à Hyde Park, c’est-à-dire en plein air. Je pense qu’il y a des vérités qui ne peuvent pas se dire dans un appartement. Comme je connais un peu Londres, et qu’il est dit dans le livre que Philip habite à Notting Hill, si vous remontez à pied de Notting Hill, vous arrivez à Hyde Park. Donc du coup ça aérait les scènes, sans transiger avec la vraisemblance, et cela permettait de rythmer le film et de dire au spectateur que c’était tout sauf un film cérébral, que c’était un film physique sur l’amour même si on les voit très peu coucher ensemble. À ce titre, je dois beaucoup à Yorick Le Saux pour la sensualité du film.
Vous abordez de manière récurrente la question du souvenir dans vos films, on peut songer à Trois souvenirs de ma jeunesse, ou aux Fantômes d’Ismaël. Ce thème est encore présent dans Tromperie, comme dans cette scène où Rebecca Marder dit à Denis Podalydès qu’elle n’a que très peu de souvenirs de lui. Le personnage de l’écrivain semble lutter contre l’oubli par l’écriture, comment concevez-vous la notion du souvenir ? Plus largement, voyez-vous dans le cinéma le moyen de conjurer l’oubli ?
Arnaud Desplechin : Le souvenir est pour moi quelque chose qu’on arrache au temps. La dernière phrase d’Une autre femme de Woody Allen – que je cite très imparfaitement – dit quelque chose comme : « Est-ce que le souvenir est quelque chose qui nous échappe, ou quelque chose qui nous appartient ? » Je pense que c’est les deux : le souvenir est ce qui s’enfuit, mais il est également la seule chose qui nous reste. Personnellement, j’ai une mémoire exécrable, je ne me souviens de rien en particulier dans ma vie. Je n’ai aucun souvenir précis de mon enfance, de ma jeunesse, mais en revanche, j’ai une mémoire très exacte des films que j’ai faits et de la manière dont je les ai conçus et tournés. Ce qui me fait dire que ce sont les films qui sont les réceptacles du souvenir. Je me permets de risquer une confession : ce qui me bouleverse dans le cinéma, c’est quand le réel se met à scintiller, quand le réel devient une épiphanie. Cela me frappe très fortement quand je vois les films des frères Lumière. Récemment j’ai vu l’exposition Enfin le cinéma ! au musée d’Orsay, et on peut y voir un petit film d’Alice Guy, avec des enfants qui jouent dans une rivière avec un chien, et soudainement, la vie qui peut sembler terne, banale, devient magnifique lorsque vous la projetez.
« C’est ça pour moi, la présence du cinéma : quand la réalité scintille »
Et quand Philip pense à son amante anglaise, il se souvient de l’odeur de chaque étreinte, de chaque geste, de la manière dont elle était habillée, et c’est ça pour moi, la présence du cinéma : quand la réalité scintille. C’est un privilège de l’amour extra-conjugal par rapport à l’amour conjugal, c’est que dans les amours conjugaux le charme réside dans la quotidienneté ; alors que lorsque vous êtes avec un amant ou une amante, le miracle apparaît, tout est miraculeux, car c’est une forme de redécouverte permanente. Et pour moi, le cinéma, c’est quand la vie se met à scintiller. Je crois que cela est en lien avec la question du souvenir, car si vous lisez le livre de Roth, il est très austère, c’est plus un essai qu’un roman, car ce sont juste des dialogues sans didascalie, et sans même le nom des personnages. Vous avez simplement des bribes de dialogues et de mots échangés.
Et à un moment, il y a ce chapitre que je peux vous citer de mémoire, car il est très court : « Oh ! Une nouvelle ceinture. » Évidemment, cela invite le réalisateur à l’imagination, car est-ce l’homme qui défait la ceinture de la fille, est-ce la fille qui remarque que l’homme a une nouvelle ceinture ? Une épouse ne dirait jamais cela à son mari, car elle était avec lui au magasin, donc elle n’a pas de raison de le dire. Quand vous vivez sous le règne de la conjugalité, ce qui est délicieux c’est l’habitude, mais quand vous avez des amours extra-conjugales, tout est évanescent, vous voyez l’être aimé le lundi, et peut-être le vendredi vous ne le verrez plus jamais de votre vie. Vous ne savez pas, c’est très ténu, c’est très fragile. J’ai donc l’impression que Philip essaie d’arracher au temps des moments qu’il gardera toute sa vie. Un jour cette femme lui avait dit cette phrase tout à fait banale qui était : « Oh ! Une nouvelle ceinture. » Et de cela il s’en souviendra toute sa vie comme d’un miracle, un miracle de présence, de drôlerie, et tout d’un coup il peut arracher quelque chose au temps. J’ai l’impression que ce thème du souvenir est très fortement inscrit dans le livre comme dans le film, il s’agit de tout ce que l’écrivain peut arracher au temps grâce à ses carnets de notes.
En ce sens, à la lecture on se perd un peu dans le livre de Roth, on ne sait jamais très bien qui parle. De ce point de vue, on a le sentiment que le livre appelle le film.
Arnaud Desplechin : Oui, c’est la fameuse scène du « Oh ! Une nouvelle ceinture », il faut qu’un réalisateur arrive pour savoir si c’est l’homme qui dit ça à la femme ou la femme qui dit ça à l’homme, il y a un choix de mise en scène et j’ai aussi eu l’impression que comme le livre raconte un peu les états du cœur des protagonistes, on ne sait jamais quand l’écrivain américain et l’Anglaise rompent. Et je me suis dit que cette incertitude n’était pas cinématographique. Il faut être plus simple au cinéma. Avec Julie Peyr (co-scénariste du film, ndlr), on a travaillé sur le fait de raconter une histoire. Je voulais raconter une histoire au spectateur, je voulais insuffler du romanesque dans le film, et je me suis donc dit qu’on allait raconter la rupture.
En fait, c’est en lisant le texte et en analysant le texte qu’on en est arrivé à comprendre ceci : à un moment Philip va rendre visite à Rosalie, à l’étudiante américaine, et à son père également, donc il est retourné à New York. De son côté, la jeune femme incarnée par Léa est captive dans ce mariage malheureux, et quand elle voit son amant revenir de New York, elle se dit qu’un jour ou l’autre il repartira. Et ce jour-là elle le perdra, et donc, elle se dit : quitte à le perdre, autant que je le perde la première, que je devance le terme. Par conséquent, on a utilisé la scène du chèque que je trouve bouleversante chez Philip Roth, où lui fait ce geste si admirablement juif : il lui donne de l’argent. C’est-à-dire qu’il ne lui donne pas un cadeau, il ne lui donne pas un collier, il lui donne de l’argent, c’est-à-dire de la liberté. Et elle qui est toute chrétienne, elle ne peut pas accepter cet argent, parce que ce n’est pas possible, ça irait contre sa dignité, et ça irait contre l’idée qu’elle peut se faire de l’amour. Après cette scène, elle repart et c’est fini entre eux. Il a donc fallu construire la rupture de manière plus romanesque que ce que Philip Roth avait fait, mais avec le matériau littéraire de Philip Roth.
L’adaptation est extrêmement fidèle au texte de Roth, mais il y a certains moments d’une grande subtilité où les acteurs s’émancipent un peu du texte. Par exemple, cette scène où Léa Seydoux qui raconte son enfance dit qu’elle avait les cheveux bleus, alors que dans le texte de Roth, son personnage avait les cheveux rouges. Étant donné que c’est Léa Seydoux qui prononce cette phrase, on ne peut s’empêcher de songer au fait qu’elle portait elle-même les cheveux bleus dans La vie d’Adèle d’Abdellatif Kechiche. Une telle intimité éclot dans ce film, que les acteurs semblent parler pour eux-mêmes, et non plus seulement pour leurs personnages.
Arnaud Desplechin : Quand je commence le travail, je ne répète pas avec les acteurs ensemble, mais je lis le texte avec chacun d’entre eux séparément. Ensuite, lorsque les acteurs se rencontrent, il faut une caméra pour immédiatement capter l’alchimie qui peut passer entre eux. Quand on faisait ces lectures, je disais à Léa et Denis de « flotter dans le texte ». Ce que je veux c’est comprendre ce que les comédiens éprouvent. Je les incitais donc à ne pas nécessairement respecter la lettre du texte – d’autant plus que c’est une traduction – et j’avais tendance devant eux à broder sur le texte, à m’en affranchir. Et quand on est arrivé à cette scène que vous citez, Léa m’a envoyé un message la veille du tournage et m’a dit : « Je suis désolé, la fille aux cheveux rouge ce n’est pas crédible, j’ai envie de dire la fille aux cheveux bleus, est-ce que tu le permets ? » J’ai dit « Mais flotte, flotte » et j’ai embrassé sa proposition avec grand plaisir. Je trouve le texte de Roth bouleversant, mais je crois que ces quelques libertés prises par les acteurs permettent de faire naître encore plus de tendresse et d’émotion. C’est ce que Léa dit à Denis à la fin : « C’était si tendre, je crois », et à ce moment-là elle pleure, et Léa pleurait réellement sur le tournage.
- Tromperie, un film d’Arnaud Desplechin, Avec Denis Podalydès, Léa Seydoux, Anouk Grinberg, en salles le 28 décembre