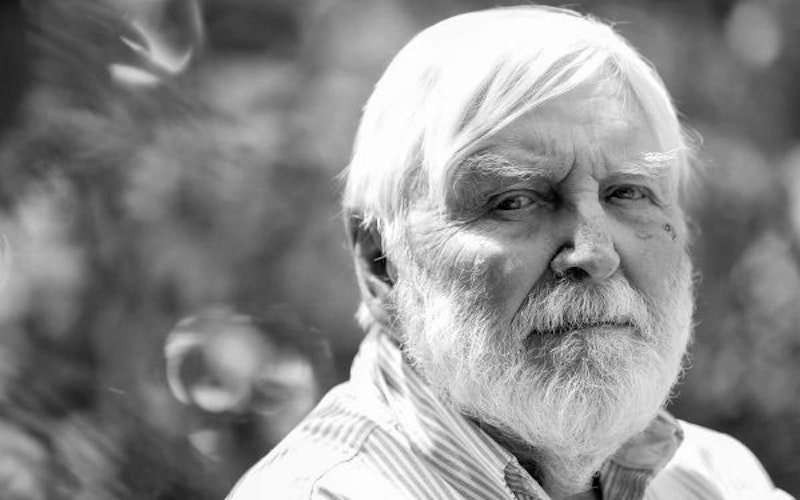
Bora Ćosić, Pâté de sable
Traduit du serbe par Ivana Velimirac
Le pâté de sable, qu’un enfant-pâtissier, dans sa pratique quotidienne du « faire semblant », pétrit partout où il peut trouver de la boue, reste le signe le plus évident de cette multitude d’entreprises sculpturales extravagantes qui, négligeant les matériaux de base ou classiques, sont façonnées en petits ouvrages à partir d’éléments tout à fait surréalistes. Au très ancien art japonais du pliage de figures mi-humaines mi-animales en papier, se joignent d’autres singeries : celles-ci prêtes à ciseler leurs objets à l’aide d’une carotte, celles-là à sculpter avec de la neige et de la glace.
À ce titre, le poète Rastko Petrović, selon les dires d’un autre poète, Milan Dedinac, conseillait de n’ériger que des monuments de courte durée ; d’après lui, par exemple, on ne devrait poser sur les piédestaux en marbre que des vases remplis de fleurs fraîchement coupées, ou bien l’on ne devrait ériger des statues à la Victoire qu’avec de la neige, de la vraie neige, pour que, dès que le soleil de printemps darde ses premiers rayons, le monument fonde et s’écoule par les champs dans un gargouillement d’évocations. Car le poète-ingénieur considérait que tout monument doit être éphémère, afin qu’il ne puisse pas braver, par son hargneux granit, le délabrement progressif.
Que la jeunesse ne les voie qu’une seule fois, deux peut-être ? et c’est déjà trop.
Bora Ćosić, Mixed Media, Edition indépendante, Belgrade, 1970, p. 31 (réédité en 2010)
Bora Ćosić, Paysage dans l’orage
Traduit du serbe par Ivana Velimirac
Les rochers volcaniques du lit de ma mère ont achevé toute une civilisation alors que sa literie semble être figée dans un autre état de la matière, à l’image des cadavres royaux de la basilique de Saint-Denis qui reposent sur des coussins de marbre.
Bien avant d’en arriver là, je me suis longtemps épuisé à chercher une signification dans les formes des draps de ma mère et à découvrir dans leurs replis tièdes tous les secrets de la féminité, comme si j’eusse voulu y trouver les sources d’eau chaude jaillissant des geysers du Groënland.
A présent, je soulève de nouveau cette couverture et je scrute les profondeurs de cette chaude literie, comme si j’observais un endroit honteux du monde. Là, le baromètre monte crescendo, signe de la maladie, ce fléau de l’histoire des hommes, et les odeurs qui s’en dégagent sont celles du sel de notre race. Il faudrait qu’un explorateur des rues des grandes villes s’y aventure pour en déchiffrer la carte. Car chaque corridor dessiné par les draps imite le chemin sinueux que l’on emprunte pour parvenir au ventre maternel. Je suis l’héritier de cet espace, moi pauvre nautonier du radeau des rêveries manifestes, quand ce dernier n’est pas pris pour une nef des fous. Je suis l’essayiste du lit qui veut en démontrer le caractère maritime. Car je mène ma vie aux côtés de la sensualité de la chair de poisson qui caractérise le principe féminin ; sur ce banc de sable, je brandis les drapeaux folâtres d’une station balnéaire et je retombe en enfance.
A côté du lit, il y a une lampe, un ultime secours en période d’insomnie, un phare salvateur. Cela signifie que dans cette cabine minuscule que représente la chambre, sur le chevet du lit, vit un elfe qui surveille notre navigation et qui tient un carnet qu’il glissera dans la barque de notre mésaventure.
Et pourtant, ce carnet relate toujours plus ou moins le même événement : un homme allongé sur un lit qui n’arrive pas à s’endormir. Il ne trouve pas sa raison d’être dans ce dernier secours, simple raison de draps, mais dans une autre, allégorique celle-là. De fait, au-dessus du lit de mon enfance, dans l’orage de la vie bourgeoise, le motif suivant était représenté : un bateau pris dans le fracas des vagues incessantes. L’allégorie de la vie drapière est ainsi plus ou moins issue d’une scène de genre accrochée au-dessus du lit.
L’habitant du lit serait malhonnête s’il ne tirait pas une leçon de ce tableau. Ainsi s’est bâtie l’œuvre de mon sommeil et de mes rêves, comme on élabore un conte. Là se trouvent les choses les plus exactes de ma vie, bien qu’elles soient racontées dans la langue d’un autre. Car ma langue ne dit rien de moi, ce sont les langues des autres qui s’en chargent.
Bora Ćosić, La vieillesse à Berlin (Starost u Berlinu), Samizdat B92, Belgrade 1998, p. 104-105

















