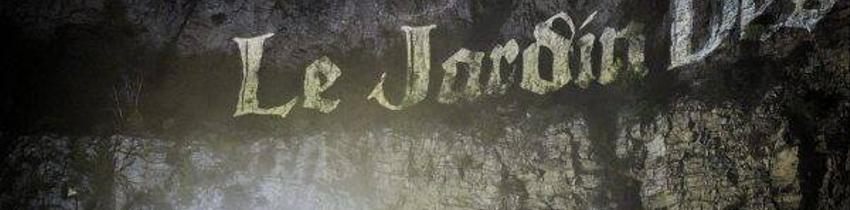Comment penser un événement tel que l’épidémie mondiale où nous sommes plongés depuis plusieurs mois ? D’abord, en tâchant de savoir de quoi l’on parle. Comment considérer un phénomène qui ne se donne à voir qu’en forme de chiffres frénétiques et de graphiques furieux ? Soudain, à cause de cette épidémie, la mort revient dans le champ de visibilité dont la conspiration du siècle contemporain l’avait consciencieusement bannie. Mais est-ce voir le sens que de voir les chiffres ? N’est-ce pas au contraire couvrir d’un voilement mathématique la réalité humaine de l’événement épidémique ? À l’épidémie, il s’agit d’opposer plutôt la pensée que la peur.
« On est tellement stupide que nul n’a rien à dire. Mais une sentimentalité diabolique intervient. »
(L. Bloy)

La terreur de la prédiction
Les chiffres ne sont donc pas seulement une mort vue, ils sont aussi et peut-être d’abord une mort prévue.
Ceci cependant ne signifie pas qu’il convienne de récuser purement et simplement toute approche statistique. L’excès serait risible. Ceci signifie bien plutôt que toute donnée chiffrée ne fait sens qu’une fois interprétée, – déchiffrée, précisément. Les chiffres laissés à eux-mêmes, jamais, n’ont eu aucun sens. Proclamer par exemple que « 500 personnes sont mortes du Covid-19 dans les dernières 24h », littéralement, est une affirmation dénuée de sens réel. Pour lui en donner, il faudrait commencer par produire le nombre de morts quotidien pur et simple, sur le même territoire. Ainsi, par exemple, chaque mois près de huit cents personnes meurent en Suisse des suites d’une maladie due au tabac ; cependant que, pour l’heure, le Covid-19 n’a fait « que » un peu moins de six cents morts depuis le 25 février. Si l’on s’en devait tenir aux chiffres, l’épidémie devrait en toute logique préoccuper moins les autorités et les citoyens que le tabagisme. Plus net encore : en Suisse, en 2017, 66’971 personnes sont décédées, soit environ 5’580 par mois. Conçoit-on l’effet, sur le moral de la population, de la publication perpétuelle, et sur tous les écrans, de ces chiffres ? Conçoit-on l’effet de la mort visible, chaque jour, par le truchement étroit des chiffres ? Mais immédiatement, il faut dépasser cette conclusion, à cause que le nombre n’est en aucun cas l’exact reflet de la réalité d’une maladie. Ce n’est certes pas seulement parce que l’on meurt du Covid-19, que la situation est préoccupante ; c’est d’abord parce que l’on est là confronté à une pathologie contagieuse, laquelle pourrait faire beaucoup plus de mort. La terreur ne naît pas tant d’un fait que d’une possibilité, – certes fort convaincante. Aux statistiques de fait s’ajoutent donc des statistiques de projection : les mathématiques deviennent instrument de prédiction de l’avenir. « Gouverner c’est prévoir », répète-t-on. Dès lors gouverneront les statistiques, seules capables d’être plus fiables que l’alignement des étoiles pour faire entrevoir aux pouvoirs politiques la situation possible et probable dans deux jours, dix jours, deux mois… Les chiffres ne sont donc pas seulement une mort vue, ils sont aussi et peut-être d’abord une mort prévue. De là des peurs paniques. « Il y aura… », dit-on. « Nous prévoyons… », dit-on. « Il faut s’attendre à… », dit-on. Et l’on tremble, et l’on s’enferme, et l’on exige encore plus d’enfermement et de fermeté.
Le médecin et l’homme politique
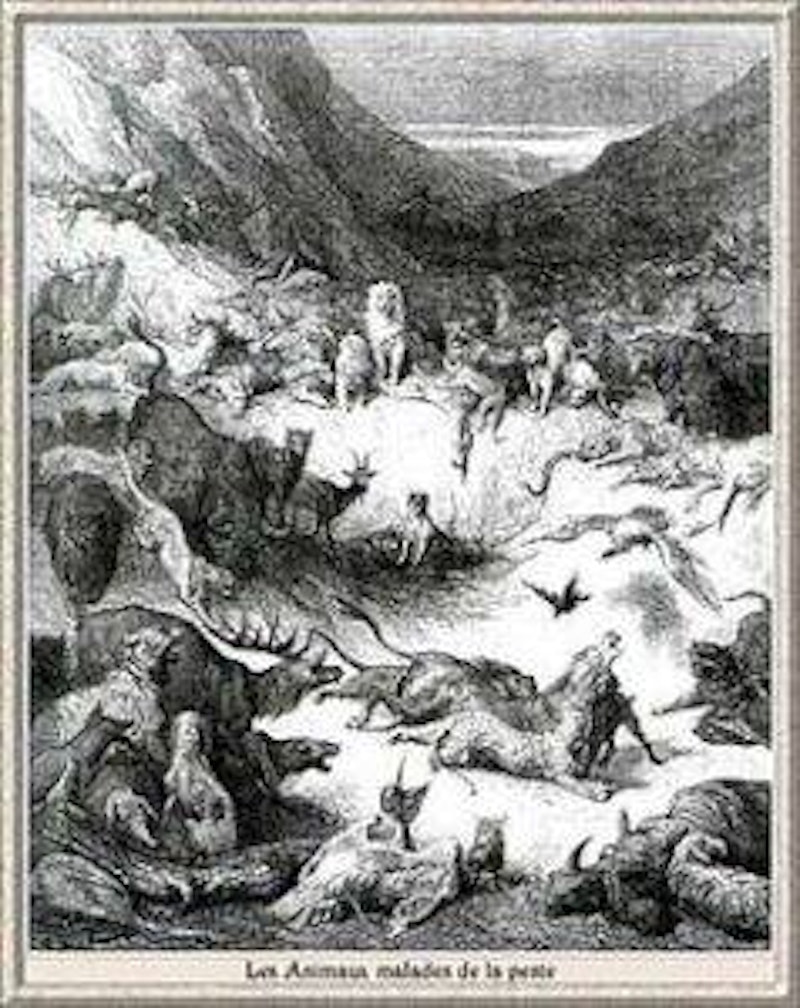
Le premier acte médical parmi tous est de discerner le malade d’avec le bien portant
L’on comprend alors l’importance de faire bien voir à tous et à chacun que le confinement des personnes saines n’est rien de plus qu’un pis-aller. Seul l’isolement des malades est un acte que l’on peut strictement dire un acte médical. Le confinement total est une réponse de la santé publique à une situation où tous ses repères s’effondrent les uns après les autres. Non bien sûr que cette réponse soit injustifiée ; il ne s’agit certes pas d’inciter les populations à se coaguler dans les parcs publics en temps d’épidémie. Mais il paraît parfaitement hypocrite de ne la pas nommer par son nom, et de la présenter comme ce qu’elle n’est pas. Le premier acte médical parmi tous est de discerner le malade d’avec le bien portant ; et dès là d’ailleurs commencent les difficultés, dans la mesure où la santé ni la maladie ne sont aisées à définir. N’en demeure pas moins que ce discernement par définition est l’action première du soin. Elle précède même la démarche du diagnostic qui est très exactement l’identification d’une pathologie à partir, comme dirait Montaigne, des « signes » par quoi celle-ci se manifeste. Un confinement généralisé, à l’évidence, n’est donc pas une prescription médicale, mais une directive de santé publique, c’est-à-dire une réponse politique à une crise sanitaire. Le point de vue, seul possible, du médecin, est d’avoir devant lui des souffrants dont il convient de déterminer l’affection, afin de proposer un traitement adéquat. Le médecin soigne ; et s’il doit renvoyer chez lui un patient malade en le priant de se bien enfermer dans sa chambre, en attendant que cela passe, telle ordonnance qui n’en est pas une lui sera toujours un échec, une défaillance dont certes il n’est pas responsable, mais qu’il ne peut que déplorer. Aussi ne demandera-t-on ni à un responsable politique d’agir comme un médecin ; ni à un médecin d’agir comme un responsable politique. Seulement à l’un et l’autre de se faciliter réciproquement la tâche, et surtout de ne pas s’entraver parmi. Ce n’est certes pas un hasard si Winslow, dans sa longue définition de la santé publique, n’omettait pas en 1920 de faire mention de « l’organisation des services médicaux et infirmiers pour le diagnostic précoce et le traitement préventif des pathologies ».
Les guéris n’intéressent guère
Ainsi, l’hésitation de certains pouvoirs politiques au devant de « l’option » du dépistage massif et précoce dans la population, laquelle précisément n’était pas une option, apparaît excessivement coupable dans la mesure où elle rend impossible le travail des médecins. Car ce sont eux, ensuite, à qui dans les hôpitaux l’on n’amène plus que des malades trop gravement atteints pour être traités avec efficacité, et qui doivent ensuite tâcher de trouver le sommeil après avoir vu crever seuls de pauvres diables pris en charge dans un état déjà désespéré. Le confinement, événement politique, n’est pas une alternative aux démarches de dépistage, il en est le pendant, en ceci qu’il permet de faciliter la tâche des médecins, qui dès lors se trouvent avec moins de patients potentiels à tester chaque jours. Étrange lubie de statisticien que de ne tester que les personnes « à risques »… Étrange, car du point de vue même de la seule statistique, elle éloigne prodigieusement de la réalité les résultats des décomptes effectués ; à l’évidence en effet, plus grand sera le nombre de tests effectués, plus grand aussi sera celui de cas positifs révélés. Peu de tests réalisés rendent illisibles les statistiques qui sont supposées nous faire voir le nombre des cas de Covid-19 par habitants. De deux pays également touchés, l’un fera des tests très nombreux, et l’autre n’en fera que fort peu : dès lors leurs données statistiques seront incomparables. De même, le nombre de tests va croissant dans la plupart des pays : comment alors interpréter l’augmentation où la diminution du nombre de cas ? L’interprétation est là tout simplement impossible, – les chiffres sont suspendus dans le vide, ne tenant qu’à eux-mêmes, déliés de tout sens réel. On notera par parenthèse que l’une des études statistiques qui semble le moins passionner les foules, et qui bénéficie de la plus faible exposition dans les médias, n’est autre que celle qui porte sur… le nombre de guérisons ! D’abord parce qu’une guérison fait moins vendre une première page de journal qu’une hécatombe – c’est incontestable. Ensuite et surtout parce que, dans des pays où les tests sont réservés aux malades à peu près déjà au bord de l’agonie, il est rigoureusement impossible de donner à voir la multiplicité immense de ceux-là qui, après une semaine épuisante et fébrile passée à cracher leurs poumons seuls dans leur chambre (sans d’ailleurs savoir s’ils sont victimes du Covid-19 ou d’une sale grippe), se portent à nouveau fort heureusement comme de jeunes pousses. Pourtant et paradoxalement, le chiffre des guérisons tel qu’il est donné à qui sait le chercher, et le veut bien, dans la mesure où il ne prend en compte que les cas les plus sévères, devrait apparaître d’autant plus rassurant. Rien n’y fait hélas : les guéris n’intéressent guère.
La médecine n’est pas une science

Il n’est pas insignifiant que, en Occident, la médecine moderne soit née du génie de quelques chirurgiens et anatomistes, et non des professeurs en faculté de médecine
Il n’est pas insignifiant que, en Occident, la médecine moderne soit née du génie de quelques chirurgiens et anatomistes, et non des professeurs en faculté de médecine. Et Montaigne d’écrire que « la Chirurgie me semble beaucoup plus certaine, parce qu’elle voit et manie ce qu’elle fait ; il y a moins à conjecturer et à deviner ». Phrase fascinante qui pourrait aujourd’hui être proclamée de la médecine clinique par rapport à la santé publique : ici, l’on conjecture et devine en chiffrant les données ; et là on tâche à voir et manier ce que l’on fait. Au reste et de nos jours encore, la situation de la médecine n’est pas celle d’une discipline dont la référence est elle-même, mais les disciplines distinctes qui la fondent ; et, partant, son but n’est pas d’expliquer un traitement, ni d’expliquer une maladie, – son unique but est de la guérir. Non bien sûr que le médecin doive, pour être un bon médecin, ignorer les causes de sa pratique, bien au contraire. Que dans le même homme se rencontrent un grand scientifique (un grand chercheur, comme l’on dit de ceux qui, parfois, trouvent) et un grand médecin, c’est là toujours une générosité admirable de la Providence. Jadis furent les plus grands chirurgiens aussi les plus érudits, de Henri de Mondeville à Ambroise Paré, en passant par Guy de Chaulignac. Mais ce n’est pas à la médecine comme telle qu’il les demandera, ces causes et ces raisons : le médecin doit bien sûr savoir pourquoi et comment tel traitement agit, mais ce savoir-là relève de la chimie, de la bio-chimie, de la biologie, etc. Autrement dit, le médecin est par essence pragmatique : homme de science et homme de pratique, homme du « savoir » et du « faire », il a pour tâche difficile d’équilibrer les deux aspects de son sacerdoce, et de ne laisser jamais l’un dévorer l’autre. Le rôle, au dessus, de la santé publique est de lui rendre sa difficile tâche un peu moins difficile – et non de lui mettre des bâtons dans les roues, au prétexte d’un chiffrage abstrait de la situation d’ensemble.
il n’est guère étonnant que dans ce vaste village d’Astérix qu’est la France, le salut semble venir plutôt de la potion magique du druide Panoramix que des gesticulations déclamatoires d’Abraracourcix
Les statistiques sont un miroir ; nécessaire, mais non pas suffisant. Seuls les médecins voient la maladie en face. Il est singulier qu’aujourd’hui le reflet veuille se faire le maître de ce qu’il reflète. Il est singulier qu’aujourd’hui, alors que, dit-on « nous ne sommes plus au Moyen-Âge », certains parmi les gouvernements européens n’aient trouvé rien de mieux pour faire face à une épidémie que de paralyser absolument la médecine de ville, faisant ainsi de la première et la dernière prescription possible, avant les urgences et la réanimation, une non-prescription médicale digne à peu près du fameux cito longe tarde médiéval, – mais il est vrai que jadis, les médecins n’avaient rien de mieux à proposer. Pour n’engorger pas les hôpitaux, restez chez vous à guérir tout seul, dans d’ailleurs l’incertitude de votre propre pathologie, puisque le dépistage n’arrivera jusqu’à vous qu’après l’épuisement de l’épidémie ; ou bien après votre mort. On aura reconnu ici le génie français. Lequel il faut, pour une fois, se féliciter de ce qu’il ne paraît guère contagieux : l’auteur de ces lignes s’est enfui à temps dans son pays de Vaud natal où, moyennant quelques précautions, les promenades en forêt ou en montagne ne sont pas interdites, ni les hôpitaux saturés, ni les médecins méprisés. Au reste, il n’est guère étonnant que dans ce vaste village d’Astérix qu’est la France, le salut semble venir plutôt de la potion magique du druide Panoramix que des gesticulations déclamatoires d’Abraracourcix[1].
[1] Inutile de dire que, n’étant pas médecin, l’auteur de ces lignes n’a strictement aucune opinion, laquelle d’ailleurs ne vaudrait pas même son pesant de Dafalgan, quant à l’efficacité ou l’inefficacité d’un traitement désormais devenu fameux, à cause qu’il a du moins la propriété certaine de faire tourner noires les humeurs de certains potentats parisiens. Ne nous intéressent que les attitudes. D’un côté, celle d’un ministre de la santé proclamant que donner aux médecins l’autorisation de prescrire ce traitement, par ailleurs fort bien connu et fort bien maîtrisé – c’est-à-dire de faire leur métier en conscience, puisqu’ils conservent bien évidemment la possibilité de ne le pas prescrire… –, reviendrait à « faire des paris » avec la santé des français ; et de l’autre, un clinicien d’allure hirsute, qui prend le risque, sans mettre en danger la santé d’aucun parmi ses patients, de ruiner sa réputation (mondiale), dans le cas où, bientôt, une étude scientifique d’ampleur démontrerait l’inutilité du traitement qu’il préconise. En somme, d’un côté, un fonctionnaire ; de l’autre, un aventurier, au sens malrucien du terme. Car si nous avons entendu souvent dire que, dans le cas où ce traitement ferait ses preuves, le Pr. Raoult pourrait par exemple recevoir un prix Nobel, curieusement, le pendant de ce triomphe hypothétique n’est guère évoqué, – à savoir qu’en cas que la démonstration inverse serait finalement faite de l’inefficace de son protocole, il risque fort d’y laisser sa réputation pour les siècles des siècles. Le reste excède infiniment nos compétences.