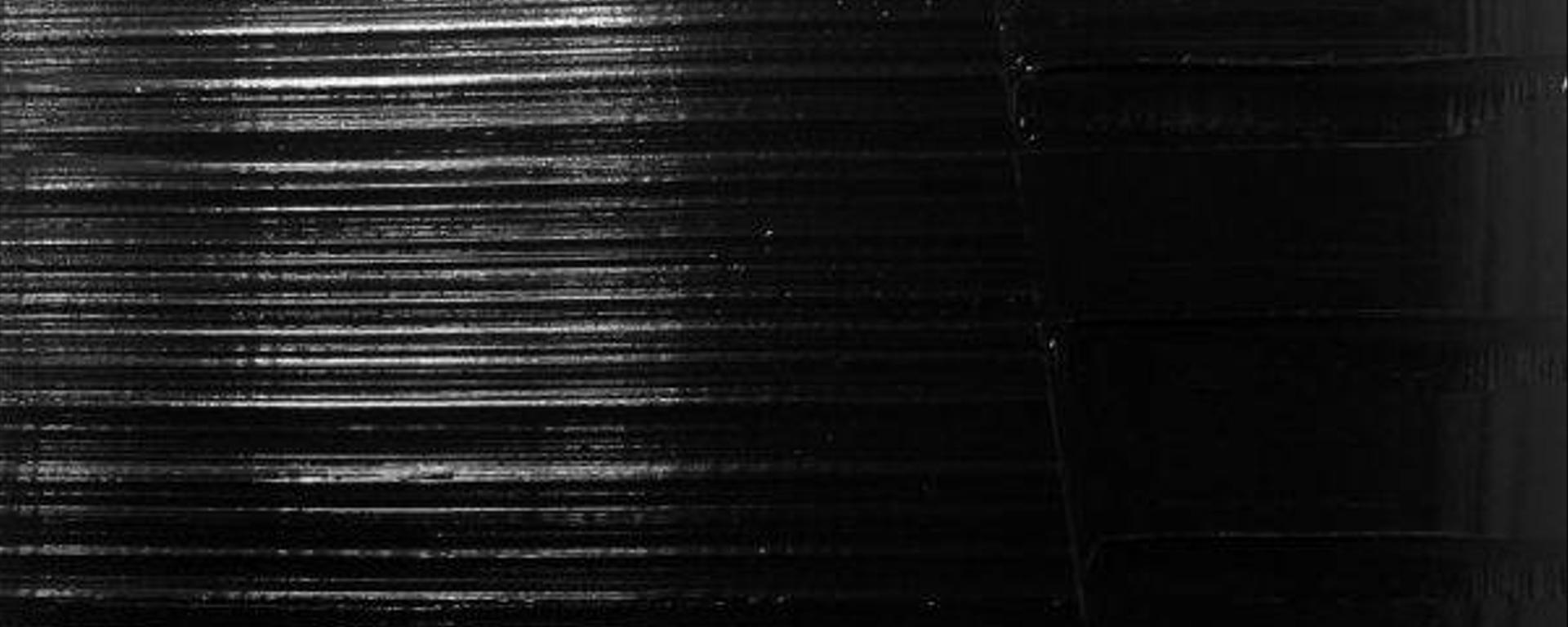Jean-Luc Nancy est mort récemment, il laisse derrière lui une pensée et une œuvre considérables, qu’il nous reste à méditer pour reprendre corps dans ce monde, loin de l’immonde, et éprouver le sens de notre existence commune dans un monde bordé de plus en plus par le non-sens. Ce texte de Valentin Husson lui rend hommage.

Toute la pensée de J.-L. Nancy se tient sur cette ligne de crête, où la philosophie en vient à penser l’essoufflement et le démantèlement des valeurs chrétiennes qui structuraient largement le monde jusqu’au XIXe siècle
Toute la pensée de J.-L. Nancy se tient sur cette ligne de crête, où la philosophie en vient à penser l’essoufflement et le démantèlement des valeurs chrétiennes qui structuraient largement le monde jusqu’au XIXe siècle. Le sens du monde (titre d’un livre majeur de Nancy), disait-il souvent, est depuis « sens dessus dessous ». Dans le sillage de Nietzsche, l’œuvre de Nancy repose sur une méditation profonde du nihilisme. Dans un monde basé désormais sur la dévaluation de toute chose et de l’humain lui-même, J.-L. Nancy nous enjoignait de penser le sens d’un monde loin de toutes les idéologies et des grands récits qui ont pu former le régime de signification de celui-ci. Si la vie ne vaut rien, rien ne vaut toutefois la vie, peut-on dire, depuis lui, en somme. Et c’est au coeur de la vie commune, de la communauté, de l’être-en-commun, que Nancy pointait l’aube d’un regain de sens. Et exposés les uns aux autres, la communauté fait sens, laisse circuler le sens, depuis l’art, l’amour, la science, la politique. Le sens du monde, désormais, est le sens commun, le sens du commun. Le sens n’étant rien de plus que la manière dont nous entrons en rapport les uns avec les autres, la manière dont l’existence humaine est d’emblée convivialité et partage. Si l’État, le Parti, les Églises donnaient un sens à la vie, le retrait du politique, comme du religieux, laisse une chance à un sens qui viendrait de nous, entre nous, et non en surplomb à notre existence.
Un tel sens commun vient avant toute chose de ce que nous partageons en propre. Or « rien n’est plus commun que la commune poussière où nous sommes promis. » Le sens commun, fondant par là même, le sens du commun, provient de ce que nous sommes mortels. Chose que nous comprenons très bien, ne serait qu’en scrutant l’actualité : ce qui organise nos vies depuis un an et demi réside précisément dans ce commun souci de nos vies fragiles et exposées à un virus mortel. La pandémie de la Covid-19 nous a fait sentir qu’un commun sort nous liait, à savoir notre commune finitude. Plût au ciel que celle-ci nous aide également à sortir de la catastrophe écologique dans laquelle nous nous trouvons, en comprenant que notre vie commune est menacée, non pas simplement pour nous autres humains, mais également pour les vivants non-humains. Seule la création d’un nouveau sens commun, loin du nihilisme marchand des États survivalistes hantés par leurs intérêts privés, pourra nous sauver d’une disparition prématurée de la Terre. Un tel sauvetage n’aura lieu que pour autant que nous comprenons, qu’au-delà de nos identités particulières (culturelles, nationales, etc.), le sens du monde est le sens de notre vie commune. Nous partageons en cela un même sort : celui de notre commune fin que nous pouvons communément éviter.
Une pensée de la communauté
Toute vie fait corps avec la vie commune, tout vie s’incarne en elle, et plus et mieux, lui donne consistance, et tout son sens.
Au reste, ce corps politique, ou ce corps de socialité, s’ancre dans le corps de chacun. Le thème du corps a fait irruption dans la philosophie de Nancy à la faveur d’un événement biographique. En effet, le philosophe strasbourgeois a subi une greffe du cœur en 1992 qui marquera profondément sa pensée, et dont il tirera un livre célèbre, L’Intrus (librement adapté par Claire Denis au cinéma). Ce corps, que la philosophie a largement mésestimé dans son Histoire, en l’identifiant à une prison pour l’âme, à une chose condamnable parce que désirante et siège de toutes les tentations, fut ainsi réévalué par Nancy, en raison même de ce qu’une existence est toujours incarnée. Toute vie est étendue dans un corps. Et c’est ainsi que la communauté n’est pas simplement un concept abstrait, mais la manière dont les corps vivent ensemble, et se partagent en partageant un même horizon qui est celui de créer du commun, du sens communément partagé, c’est-à-dire du ‘‘vivre-ensemble’’, comme l’on dirait aujourd’hui. On pourrait ainsi dire que la communauté prend corps dans le sens qu’elle invente. On sait bien, par exemple, que la plus petite des communautés, c’est-à-dire le couple, réinvente continument le sens de son amour, de sa vie partagée. Il en va de même pour le reste du commun des mortels. Toute vie fait corps avec la vie commune, tout vie s’incarne en elle, et plus et mieux, lui donne consistance, et tout son sens.
Voilà en quoi Nancy répond donc au nihilisme : sortir de la dévaluation de toutes les valeurs, sortir du non-sens, et de l’immonde, ne se peut que depuis l’invention d’un commun, d’un autre monde que celui de l’économie capitaliste où toute chose n’a de valeur que pour autant qu’elle peut être dévaluée ou bradée (on appelle ça : la bourse, le marketing, les soldes ou le Black Friday), et où l’individu est tenu pour rien (les Gilets jaunes n’étaient-ils pas, en ce sens, l’image d’un commun qui cherchait à partager un autre sens que le non-sens du capitalisme, et cela partout, sur les avenues, les ronds-points?).
Une philosophie du contact
Loin d’être un commun désaffecté, ou décharné, la communauté telle que pensée par Nancy était peut-être la communauté du « dérèglement des sens » (Rimbaud), celle du tact et du contact. Il n’est pas de trop de le rappeler à une époque où le « sans contact » a contaminé toutes nos existences : puritanisme des sites de rencontres où la séduction se fait à distance et par écrans interposés (qu’on songe à Tinder) ; société hygiénique où le gel hydroalcoolique, le check poing contre poing, les gestes barrières, remplaceront bientôt les embrassades de la franche camaraderie ; et où l’économie, elle-même, nous fait désormais cracher notre argent par des paiements « sans contact ». Bien loin de tout cela, donc, Nancy était certainement, selon les mots de Derrida dans un livre qui lui consacra, et intitulé Le toucher, Jean-Luc Nancy, « le plus grand penseur du toucher depuis Aristote », c’est-à-dire aussi le plus grand penseur du contact, du tact, de la franchise et de la droiture des relations humaines, là où l’existence prend toute la couleur de son sens lorsqu’elle est « touchée », comme on dit, émue, électrisée par les rencontres qu’elle fait. Par-là, l’existence est toujours déjà « expeausée » (Nancy, Corpus) à de l’autre ; jamais recroquevillée sur elle-même, jamais claquemurée dans une identité par trop destructrice lorsqu’elle se fait revendication « identitaire ». Par-là, encore, autre mot sublime de Jean-Luc Nancy, l’existence est tout entièrement « sexistence » : vie sexuée, c’est-à-dire destinée à être touchée (passion amoureuse, joie amicale, plaisir esthétique, enthousiasme politique, etc.), de quelle que manière que ce soit, par (de) l’autre (l’aimé(e), l’ami(e), le ou la camarade, une œuvre ou un(e) artiste, voire une découverte scientifique).
Au « rien ne vaut plus rien », ou au « c’était mieux avant », Nancy aura ainsi toujours opposé la joie d’une vie commune, créative et récréative (cf. La création du monde ou la mondialisation), inventrice de sens luttant contre le non-sens de l’époque, remplaçant l’absence de Dieu par la présence de nos vies partagées, substituant la jouissance consumériste par le désir d’être ensemble, et le plaisir d’éprouver une vie où la différence est une non-indifférence à l’autre, une mise-en-commun, et où, partant, tout ce qui nous sépare nous laisse simplement nous exclamer, à la manière de Paul Celan, ce poète que Nancy aimait : « nous nous séparons enlacés ».
Valentin Husson