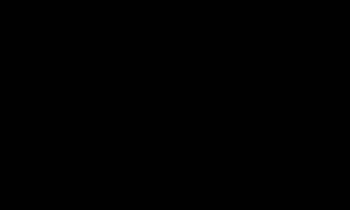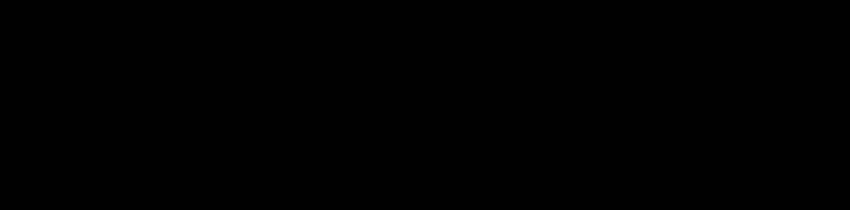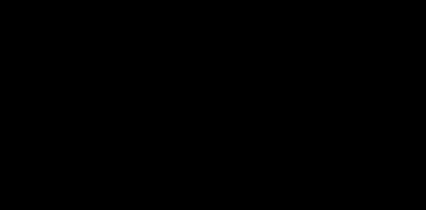Payal Kapadia collationne avec ardeur les souvenirs tour à tour triviaux et militants des quelques années qu’elle a passées dans le campus universitaire du Film and Television Institute of India, près de Bombay. La mosaïque d’images saisies par elle et par d’autres dénonce l’ultra-nationalisme hindou et salue le courage de la révolte étudiante. Portrait d’une jeunesse en feu dans un noir et blanc granuleux, Toute une nuit sans savoir brûle de révolte en même temps qu’il l’anesthésie.

Une note d’intention magnifique fait-elle un bon documentaire et vice-versa ? Le spectateur confronté à cette question passera tout un film sans savoir.
Lettres d’une inconnue
Payal Kapadia emprunte les chemins d’un certain classicisme littéraire qui dépasse les frontières nationales et linguistiques. Le rapport au vrai s’y établit sur une double fiction : celle de l’œuvre trouvée d’une part puisque les images, sur le mode du found footage, auraient été découvertes par hasard dans la chambre d’une étudiante ; celle du roman épistolaire monodique d’autre part, puisque la voix off qui unit les séquences est celle d’une jeune femme délaissée par son amant, à qui elle envoie des lettres demeurant sans réponse. Au spectateur d’imaginer que l’étudiante et l’amante ne font qu’une. Le dispositif évoque, depuis le point de vue français, les fiévreuses Lettres portugaises (1669) autant que les romans reposant sur un supposé manuscrit trouvé (des Lettres persanes à La Vie de Marianne). La rencontre d’une mécanique littéraire – huilée par des siècles de faux-semblants entre fiction et vérité – avec la génération spontanée d’images de révolte capturées par les étudiants de l’école de cinéma de Payal Kapadia promet beaucoup, et ce d’autant qu’elle semble induire une réécriture diariste. Néanmoins, double promesse vaut parfois double bind.
Cauchemar en sourdine
Payal Kapadia mêle deux lignes vocales
Payal Kapadia mêle deux lignes vocales, l’une monodique, l’autre polyphonique, l’une romanesque et fictive, l’autre politique et collective. Les deux lignes pourraient se superposer, en un montage faux-vrai particulièrement adapté à la forme du documentaire, et ce d’autant mieux qu’elles font entendre les accents d’une colère commune. La voix féminine narre un amour qui fut blessé pour des raisons de hiérarchie sociale dans une société de caste ; les étudiants révoltés, filmés par des regards distincts – autant d’images récupérées et tissées par le montage – dénoncent les inégalités scolaires et politiques induites par un système inique. Pourtant, la voix de l’amour recouvre a posteriori des images qui furent saisies dans les à-coups bouillonnants de l’émeute. D’où le sentiment, accentué par la post-synchronisation, d’une colère fiévreuse autant qu’étouffée, d’une révolte mise sous cloche par le montage autant que par la répression policière.
Dans l’ensemble, le propos brûlant du film achoppe sur le désir d’y insérer de la fiction pour en unifier le propos. La fausse écriture épistolaire dans une visée documentaire, procédé dans lequel excelle Chris Marker, mobilise bien souvent une certaine forme de distance décalée pour mieux s’écrire, par exemple par le biais de l’humour ou du collage disparate ; distance impossible ici au vu de la violence et de l’actualité des images montrées. Nul propos romanesque ne peut se greffer sur un plan aussi glaçant que celui du parcage d’étudiants par la police dans une salle de classe. La bigarrure des images – celles de la cinéaste, celles des amis, celles des caméras de surveillance dans des espaces publics – est lissée par l’étalonnage : une certaine équivalence unit donc l’ensemble de ces réminiscences tissées, atténuant leur rugosité, et écartant en partie la question de la difficile construction d’une mémoire collective. À l’apparente esthétique du patchwork est volontairement préférée celle de la couture invisible.
Semences ou débris[1]
Œuvre d’abord individuelle puis collective, film lyrique quoiqu’assourdi par le travail sonore, Toute une nuit sans savoir allie les paradoxes. Le premier plan qui révèle une jeunesse dansant au rythme des néons instaure un rapport fait de transe et d’énergie vitaliste au domaine politique : la nostalgie pour ce présent, perçu en tant qu’il est train de devenir passé, sourd alors. C’est peut-être de là que naît la disjonction : souffrance politique et paradoxal regret composent les notes en dents de scie d’un documentaire dont il n’est pas évident de suivre les lignes de force mais dont il est impossible d’ignorer l’âpre mélodie.
- Toute une nuit sans savoir, un film documentaire de Payal Kapadia, en salles le 13 avril 2022
[1] « Trois éléments partageaient donc la vie qui s’offrait alors aux jeunes gens : derrière eux un passé à jamais détruit […] ; devant eux l’aurore d’un immense horizon […] ; et entre ces deux mondes… quelque chose de semblable à l’Océan qui sépare le vieux continent de la jeune Amérique […] ; le siècle présent, en un mot, qui sépare le passé de l’avenir, qui n’est ni l’un ni l’autre et qui ressemble à tous deux à la fois, et où l’on ne sait, à chaque pas qu’on fait, si l’on marche sur une semence ou sur un débris » (Alfred de Musset, LaConfession d’un enfant du siècle, 1836).