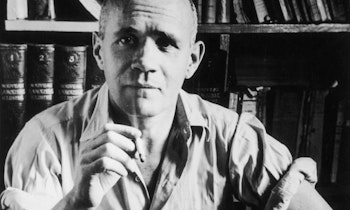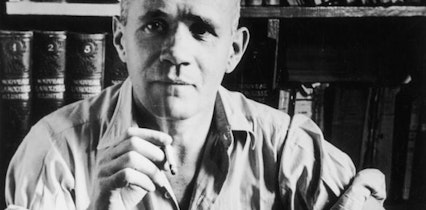Après Hécube pleurant la destruction de Marioupol sur les rives de la mer Noire, nous poursuivons notre rubrique « Pastiches » en publiant une réécriture d’André Malraux. L’auteur de L’Intemporel revient cette semaine d’entre les morts pour offrir aux vivants quelques fragments d’un roman inachevé qui marquent son grand retour à la fiction après les grandioses épopées métaphysiques qu’il a consacrées à l’art.
« L’homme est la seule créature qui sache l’indifférence des constellations à son égard », laissa tomber le vieux Mykhailo, entre deux bouffées qu’il tirait sur une longue pipe de bois sale.
Dans la grange désormais silencieuse, il n’y avait plus que ces deux hommes, Mykhailo et le jeune Nikolaï, l’un assis sur un vieux banc et le dos appuyé contre le mur, l’autre allongé sur le sol, bras croisés sous la tête. Au dehors, c’était la guerre ; au-dessus d’eux, c’était la nuit. Dans l’obscurité, Nikolaï distinguait à peine les volutes de fumée qui s’échappaient de la pipe de Mykailo, et qui montaient comme en titubant jusqu’aux poutres pourries du toit.
« C’est pourquoi l’homme se réfugie dans l’amour, reprit le vieil homme.
– Vous ne croyez pas en l’amour ? demanda Nikolaï.
– Je pense que l’amour est une conjuration. Lorsqu’il aime, et lorsqu’il est aimé, l’homme peut croire alors qu’il est un enjeu dans l’univers. Il conjure ainsi la dérive silencieuse des nébuleuses. »

La mort d’un homme, oui, d’un seul, peut-être, avait fait tomber sur le monde des ténèbres à la mesure de ce drame ; mais la nuit désormais ne descend plus sur le temple, et n’en déchire plus le voile, quand meurent tant d’hommes dont la seule espérance est une angoisse trompée.
[…]
On n’entendait plus, au loin, que le grondement monotone des colonnes de chars qui traversaient la plaine en direction du front. Ils vont sur une route toujours la même bordée d’arbres toujours les mêmes, et la terre du Donbass toujours aussi noire sous leurs chenilles. Au-dessus de ce morne convoi, le ciel gris ressemblait à une fermeture effroyable. La lumière diffuse semblait n’avoir plus assez de force pour colorer les choses et les hommes. La terre aussi était grise, et les arbres, et les herbes malingres qui frémissaient dans la brise permanente. Il n’y avait plus d’ombres non plus ; le monde était comme diminué d’une dimension. La profondeur des êtres s’était enfuie avec le soleil. Celui-là, on ne le devinait plus, parfois, quelques minutes seulement, vers midi, lorsqu’il parvenait à percer de quelques rayons cette couche de nuages épaisse, chaque jour renouvelée, et qui faisait peser sur les hommes son immense fardeau d’infini.
Nikolaï termina de refaire le double nœud de sa chaussure gauche, et se redressa. Son fusil Vepr était encore là où il l’avait déposé un instant avant, appuyé contre le tronc d’un arbre mort. Il le considéra durant quelques secondes avec une sorte d’étonnement absurde, comme s’il avait été bien plus naturel qu’il disparût pendant qu’il laçait sa chaussure. Peut-être l’avait-il surtout secrètement espéré. Au reste, son dernier chargeur était vide depuis longtemps. Simplement, personne, depuis deux ou trois jours, n’avait songé à lui fournir de nouvelles munitions. Nikolaï pour sa part s’était bien gardé d’aller en demander. De toute façon, dès que, pour eux, les combats recommenceraient, ils auraient tous droit immédiatement à leurs rations de munitions. C’était à chaque fois pareil. Les moyens de se battre leur tombaient du ciel toutes les fois qu’une offensive était imminente – qu’elle fût la leur, ou celle des Russes d’en face, dont il venait d’apprendre qu’ils avaient donné l’assaut à Sievierodonetsk et Lyssytchansk.
« Il paraît qu’on va avoir encore des armes américaines », avait annoncé le caporal Demchuk, le matin même. Nikolaï n’avait que faire de la provenance des fusils qu’en quelques jours il avait dû apprendre à manier ; mais tout de même, il ne parvenait pas bien à comprendre pourquoi tant de puissances étrangères se penchaient soudain sur le destin de son pays. Des armes américaines pour flinguer du soldat russe… Tant mieux. Tant pis. Il ne pouvait cependant se défaire du sentiment d’être engagé dans la pâle copie, la pure reproduction, d’un événement dont la version originale s’était jouée sans lui – bien avant sa naissance. Comment savoir si tous nos actes ne sont pas simplement la répétition de ceux qui nous ont précédés ? Nikolaï, depuis le début de la guerre, n’avait pas eu l’impression au fond de prendre une seule véritable initiative. Aucun acte posé par lui ne lui semblait être le sien ; aucun ne lui appartenait en propre.
Pourtant on ne l’avait pas forcé, on ne l’avait pas obligé : il s’était engagé. D’abord, il avait mis sa femme et sa fille dans un train pour l’ouest ; et lorsqu’il avait été certain qu’elles étaient en sécurité, il était allé dans la direction opposée, et il avait trouvé un centre de recrutement, où on lui avait donné des armes, où on lui avait appris à s’en servir pour tuer des hommes. Pas seulement des Russes, d’ailleurs. On l’avait prévenu que des Ukrainiens aussi, il allait en trouver parfois au bout de son fusil. Des pro-russes. Des traîtres. Mais comment distinguer ? Le caporal Demchuk lui avait dit que prendre le temps de distinguer, c’était donner à l’ennemi le temps de nous tuer. Nikolaï sentait en lui trembler l’angoisse de payer du prix de sa propre humanité la vie des hommes que, en combattant, il espérait sauver. Le silence qui était autour de lui, dans cette plaine immense et comme infestée de ciel blanc, entra en lui. À cette minute, il était seul au monde – et alors il n’y avait plus de monde, puisqu’il n’y avait plus que lui, et l’universelle conspiration silencieuse des choses. Il se vit étranger à tout, et comme pressé contre son centre creux, contre cet azur qui était en lui et qui était son humanité, par la présence opaque des plantes, des pierres, de la terre, dont l’indifférence assourdissante lui était soudain un étourdissement indescriptible.
[…]
Au loin, le ululement sinistre d’une sirène se fit entendre. La sourde hostilité des choses en fut dissipée, et Nikolaï s’empara de son fusil. Il reprit sa marche sur le sentier de terre sèche et sale, en direction du hameau où sa section s’était établie pour la nuit. Quelque chose passa en vrombissant au-dessus de sa tête. C’était un drone, qui s’en allait dans l’air poussiéreux vers une mission indéterminée, dérisoire et vaine. Ils avaient remplacé les oiseaux. Sans doute même eût-il était plus exact de dire qu’ils les avaient chassés. Leurs bourdonnements désormais étaient les seuls bruits que l’on entendait sous les frondaisons, lorsqu’ils n’étaient pas étouffés par le vacarme d’une escadrille qui traversait le ciel, dans un sens ou dans un autre, aviation russe ou bien aviation ukrainienne. Il ne servait de rien, dans le premier cas, de se mettre à couvert. On regardait passer, impuissants, les engins ennemis qui peut-être s’apprêtaient à bombarder une ville voisine ou lointaine. Alors, on entendait la colonne de chars d’assaut qui s’immobilisait un instant, mais jamais les avions ne perdaient leur temps au-dessus des campagnes : ils allaient aux grands peuplements, et ils déversaient là-bas leurs cataractes d’enfer.
Toutes les fois qu’il voyait ainsi voler des avions russes au-dessus de lui, Nikolaï sentait monter en lui le sentiment de l’insignifiance fatale de son engagement, de son pauvre petit engagement personnel. Que peut donc un homme pour un autre ? En sauverait-il au moins un seul, lui ? Et même, aurait-il un jour besoin d’être sauvé lui-même ? Irait-il jusqu’à la découverte de cette situation où sa vie, soudain, serait suspendue à l’héroïsme d’un frère humain, qui se trouvera peut-être là, et qui peut-être l’arrachera une fois au néant ? Elles sont rares, elles sont si rares, les heures où l’homme éprouve le besoin d’une autre présence humaine – non pas ce besoin qui est désir d’une autre chair, pour ne pas sentir couler hors de soi comme une sueur d’angoisse la sensation de sa tiède solitude, mais ce besoin violent, féroce, d’une main qui vienne vous arracher à l’enfer, vous tirer hors de l’abîme, et vous faire ainsi le don d’un peu de vie supplémentaire, d’une vie qu’alors vous lui devez, et qui devient une dette non pas envers un dieu mystérieux mais envers un semblable, un autre homme, qui ne vaut pas mieux que vous, mais qui, en vous soustrayant au néant, a ouvert une brèche entre vos deux exils, un passage par lequel vous vous êtes rejoints pour un éternel instant de communion fraternelle.

– André, Malraux, Ces chaînes qu’on abat…, coll. « Blanche », Gallimard, Paris, 234 p., 25 €.