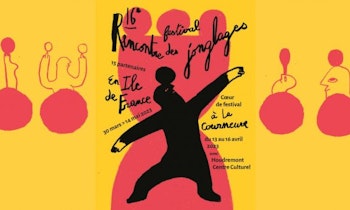Le CDN de Sartrouville accueillait cette année deux propositions du Festival Impatience, un rendez-vous annuel qui veut mettre en lumière les créateur·rices de la scène théâtrale émergente. Les 8 et 9 décembre, nous pouvions assister aux deux spectacles Seuil, de la compagnie Les Grandes Marées, et J’aurais mieux fait d’utiliser une hache, du Collectif Mind The Gap. Dans des registres radicalement différents, ces propositions font toutes les deux état d’un questionnement fort autour de la violence et de son pouvoir de fascination, sa répétition et sa présence insidieuse dans tout ce qui construit notre réel.
SEUIL
Être un garçon ne suffit pas : on doit devenir un homme.
Au milieu d’un dispositif bifrontal installant une partie du public directement sur la scène, une longue rangée de tables d’école s’étire d’un bout à l’autre du plateau. À la fois salle de classe, chambre de dortoir et pièce d’interrogatoire, cet espace rappelle la longueur des années de collège et ce sentiment de ne jamais en voir le bout. Noa, interprété par le comédien Baptiste Dupuy, est un garçon de 14 ans qui passe ses jours et ses nuits à subir la violence insidieuse et quotidienne du harcèlement scolaire. Dans la chambre 109, une microsociété mafieuse où « le collège ne décide de rien », être un garçon ne suffit pas : on doit devenir un homme. Pour atteindre ce stade, Noa doit se confronter à une série d’épreuves humiliantes et cruelles, avant d’en arriver au fameux passage du seuil : pour ne plus être victime il faut devenir agresseur, car dans l’échelle de la violence il n’y a pas d’entre-deux.
Créer un autre souvenir de soi
On s’invective et se coupe la parole pour toujours s’assurer que l’on domine.
Le texte de Marilyn Mattei s’inspire d’une série d’agressions sexuelles entre adolescents, un fait divers rapporté à l’autrice lors d’une résidence d’écriture dans un collège. Ce « jeu » ne semblait pas poser problème aux jeunes garçons, qui n’avaient pas conscience de la violence de leurs actes. Car dans les années collège et lycée, longues transitions vers l’âge adulte, ce qui importe avant tout c’est le fait de « vivre un jour comme un lion, plutôt que cent jours comme une chèvre ». C’est le regard des autres et l’endroit où l’on se situe, socialement d’une part mais aussi physiquement (dans quel lit du dortoir, à quelle table de la cantine ou dans quel espace de la cour du collège a-t-on le « droit » de s’installer ?). Le personnage de Noa est imbibé de cette angoisse et de cette urgence, et se laisse traverser par les rites de passage imposés. Dans Seuil, Marilyn Mattei utilise une langue étrange et pourtant familière, où les « je » et les « tu » disparaissent souvent : les phrases sont nettes, acérées et affirmatives, et invoquent une certaine universalité. Les deux comédien·nes, Baptiste Dupuy et Camille Soulerin, interprètent avec force ces dialogues coups de poing, où l’on s’invective et se coupe la parole pour toujours s’assurer que l’on domine.
Ce sont les rapports de force qui jalonnent toute la pièce, et qui se matérialisent avec habileté dans les corps des interprètes. La comédienne Camille Soulerin incarne une galerie de personnages hétéroclites avec beaucoup d’aisance : aidée de simples indices de costume, elle se fond successivement dans les démarches et les discours de ces hommes, femmes, garçons et filles qui gravitent autour de Noa et qui situent le curseur de la violence quotidienne qu’il subit. Baptiste Dupuy n’interprète quant à lui que le personnage de Noa, mais se révèle lui aussi caméléon : saisissant de justesse, il transmet l’évolution – non linéaire, puisque le spectacle se construit sur de nombreux flash-back – de son personnage à toutes les étapes, emporte tous les rires avec son imitation clownesque de Robert De Niro, mais nous met aussi au bord des larmes lorsque son corps se libère par la danse. C’est une très belle performance de comédien que d’interpréter un jeune personnage qui ne sait lui-même pas quel rôle il doit jouer.
Parler de tous les autres
Ce sentiment d’universalité se traduit également dans la mise en scène de Pierre Cuq, par la présence astucieuse d’un pantin en mousse qui est à la fois l’un et tous les autres : on comprend d’abord qu’il s’agit d’un simulacre utilisé par les internes de la chambre 109 pour partir fureter la nuit en donnant l’illusion de rester dans leurs lits. Mais ce petit personnage inanimé revêt également une dimension totémique : il nous est présenté comme le moyen de se rappeler d’Eliot, ancien interne, dont la disparition ne nous est pas expliquée. Ce pantin devient aussi marionnette, manipulée avec une impressionnante précision par le comédien, qui s’entraîne avec elle (ou lui ?) à son premier baiser. Il s’agit enfin également du mannequin utilisé par la policière pour représenter Matteo, l’ami de Noa disparu après avoir été la victime finale du passage du seuil dans la forêt.
Ce théâtre est un relais qui fait entendre la violence de l’adolescence au-delà de l’espace médiatique.
Cette brutale scène finale, dont la violence plane au-dessus de nous pendant toute la durée du spectacle, s’accompagne d’enregistrements de voix d’autres comédien·nes, qui prennent l’ascendant sur celles des interprètes au plateau. Ces éléments sonores n’atténuent pas la violence de la scène, au contraire. Elle se livre à nous sous forme de récit. Comme dans la tragédie grecque, c’est la voix d’une messagère qui vient rapporter la fin de l’histoire, comme un rappel du rôle du théâtre dans la transmission du réel, même le plus cruel. La compagnie Les Grandes Marées réussit avec Seuil son objectif de faire du théâtre un relais, qui fait entendre la violence de l’adolescence au-delà de l’espace médiatique.
- Seuil, texte de Marilyn Mattei et mise en scène de Pierre Cuq (cie Les Grandes Marées), avec Baptiste Dupuy et Camille Soulerin.

J’AURAIS MIEUX FAIT D’UTILISER UNE HACHE
Sur le grand plateau du théâtre de Sartrouville, le collectif Mind The Gap met le bazar : il y a des câbles, des outils, des échelles, des micros, des barils de faux sang, des haches suspendues au plafond… Et même une cuisine entière, avec son frigo, ses carottes, ses casseroles, sa bouteille d’huile d’olive, sa planche et son couteau. Tous ces accessoires sont pourtant méthodiquement organisés et utilisés au cours du spectacle : dans une première partie, les cinq interprètes nous proposent une fiction bruitée et chuchotée, mettant en scène un campement de scouts dans la forêt. Chaque bruit y est produit et enregistré par un élément différent du plateau dans une semi-pénombre, allant des outils aux corps des comédien·nes, nous plongeant avec relief dans cet imaginaire inquiétant de la forêt et des histoires que l’on y raconte. À ce premier univers répond celui du slasher movie dans une deuxième partie, une autre manière d’envisager l’horreur. Le Collectif Mind The Gap reprend les codes de ce genre cinématographique à part, en recréant une scène typique de « meurtre dans la cuisine », qui se répète en boucle pour mieux identifier avec humour tous les mécanismes de cette violence qui repousse et fascine.
L’espièglerie du réel
Thomas Cabel, Julia De Reyke, Solenn Louër, Anthony Lozano et Coline Pilet, tous·tes formé·es au Conservatoire d’art dramatique d’Orléans, nous livrent avec J’aurais mieux fait d’utiliser une hache un spectacle imaginaire et inédit, qui se présente comme une interrogation autour de la violence et l’horreur, et de ce qu’elles disent de nous. Le plateau est leur laboratoire, où chaque accessoire a son importance et où la mécanique est bien huilée. Malgré la semi-pénombre qui enveloppe la première partie, on sait que ce que l’on voit n’est pas ce que l’on entend : les murmures de la forêt sont des papiers qu’on froisse, les bruits de pas sont des biscuits qu’on mastique, la pluie un parasol qu’on arrose au-dessus d’un micro, etc.
Transportés dans une forêt imaginaire, on est bien saisis par le petit frisson des souvenirs inquiets de l’enfance.
Tout est d’une très grande précision, et l’on prend un certain plaisir à recevoir et analyser chaque son et chaque image, pour essayer de comprendre ce qui se présente à notre perception. Le spectacle se construit avec une grande ingéniosité, en interrogeant tous les aspects de ce qui s’avance comme le « réel » : on est d’abord transportés dans une forêt auditive et imaginaire, mais bien saisis par le petit frisson des souvenirs inquiets de notre enfance. Le réel se décortique également dans cette mécanique de répétition qui agence toute la deuxième partie mais sans jamais s’essouffler. Le bruitage est toujours présent : c’est maintenant le tranchage des oranges qui figure les multiples coups de couteau reçus par la victime dans sa cuisine. Cela s’accompagne d’interférences visuelles et sonores, qui déroutent de plus en plus la perception et réussissent à nous plonger dans un certain saisissement, même si l’on finit par connaître la scène par cœur.
Les interprètes apparaissent comme des yokaï, ces créatures japonaises surnaturelles et malicieuses.
Les interprètes apparaissent ici comme des yokaï, ces créatures japonaises surnaturelles et malicieuses qui influencent la vie quotidienne des êtres humains, en leur jouant parfois de mauvais tours. Entre chaque scène, les comédien·nes réagencent le plateau dans le noir afin de préparer la variation suivante, mais en altérant des éléments : les accessoires se déplacent, les comédien·nes changent de rôle, le tueur ne retrouve plus son masque… Toutes ces anomalies qui, de manière presque scientifique, enlèvent ou ajoutent des éléments à la scène de référence nous poussent à nous demander à chaque fois : et là, ça me fait peur ?
D’où vient la menace ?
Cet hommage au cinéma et à la fabrique de l’horreur dans la culture populaire se dévoile de manière littérale à travers une scène désopilante de fausse émission de radio, mettant en scène deux cinéphiles débattant autour de ces mêmes sujets. Cette scène parodique permet de prendre de la distance face à la sur-analyse dans laquelle on se loge parfois au cinéma comme au théâtre, oubliant un peu le réel. Mais cela permet aussi de poser les jalons d’un plus large décryptage sociologique et métaphorique de la représentation de l’horreur, comme une menace venant non plus de l’extérieur mais, depuis l’apparition du slasher movie, venant de ce qui est nous est familier.
Les rôles s’inversent et, dans une vengeance tranchante, la victime reprend le pouvoir.
L’héroïne de cette allitération théâtrale, interprétée par Solenn Louër, semble au départ complètement dominée par ces meurtres répétés dont elle est victime. Quel que soit le scénario, elle n’échappe pas à la mort finale, même lorsque le tueur est occupé à faire autre chose. J’aurais mieux fait d’utiliser une hache nous invite ici à réfléchir au statut de victime et au fait que l’on ne peut pas s’en détacher, si l’on respecte les carcans habituels des fictions de ce type. Pourtant, ce personnage finit par s’émanciper de sa propre fatalité : les rôles s’inversent et, dans une vengeance tranchante, la victime reprend le pouvoir.
D’où vient la menace aujourd’hui ? Qu’est-ce qui nous fait vraiment peur ?
Ce spectacle ouvre la possibilité de de changer le scénario : on dépasse aujourd’hui la fascination et la répulsion pour ce type de violence dont on reconnaît les codes que l’on a vus des centaines de fois, même si on les reçoit à la fois avec humour et tendresse, comme le fait le Collectif Mind The Gap. La question se pose alors : d’où vient la menace aujourd’hui ? Qu’est-ce qui nous fait vraiment peur ? Le spectacle se termine sur une image captivante et déroutante, celle d’un plateau vide où seul un nuage de fumée évolue, et avance lentement et dangereusement vers nous. C’est peut-être ça, l’horreur : ce qui n’est pas vraiment visible mais ce dont on commence à sentir les effets. Ce qui fait vraiment peur aujourd’hui, ce n’est plus la violence des serial killers et des armes blanches, mais celle qui se sait sous-jacente, impalpable, systémique, diffuse et insaisissable.
Les spectacles Seuilet J’aurais mieux fait d’utiliser une hache utilisent intelligemment tous les deux des détours fictionnels et humoristiques pour interroger avec un grand sérieux le magnétisme de la violence et son omniprésence dans nos vies. Dans un cas comme dans l’autre, on envisage sa dimension répétitive et la nécessité de penser autrement, de changer la fin des histoires. Réinventer les représentations et les discours de la violence, auxquels nous nous sommes habitué·es pour ne plus avoir à la regarder en face, c’est le pari que se fixent ces deux compagnies qui font ainsi de la création émergente un vrai lieu de redéfinition du réel.
- J’aurais mieux fait d’utiliser une hache, création collective de Thomas Cabel, Julia de Reyke, Solenn Louër, Anthony Lozano et Coline Pilet (Collectif Mind The Gap).
Crédit photo : (c) Alban von Wassenhove