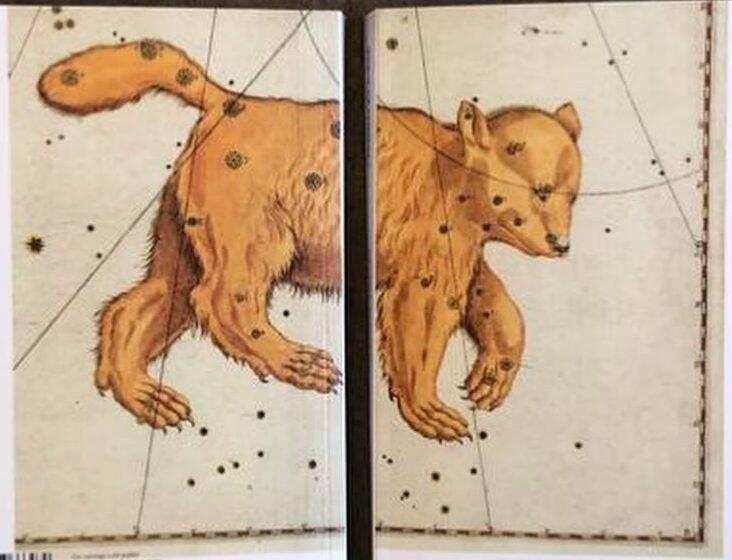Dans son essai paru en novembre aux éditions de L’Extrême contemporain et intitulé 7 femmes en scène : émancipation d’actrices, Juliette Riedler œuvre à une généalogie féminine de l’émancipation par l’interprétation scénique. En plus de réfléchir la question de l’histoire de la pensée par l’art du jeu, elle ouvre des perspectives riches sur les enjeux d’émancipation comme geste de création, comme témoignage d’une espace du commun et du devenir. Elle revient, dans cet entretien, sur les 7 figures de sa généalogie, proposition pleine de joie et d’ouverture. En scène avec Sappho, Sarah Bernhardt, Yvette Guillbert, Colette, Zouc, Isadora Duncan, Angelica Liddell.
Rodolphe Perez : Tu proposes une généalogie de figures féminines qui, par l’interprétation et la scène, accomplissent un geste d’émancipation. Comment as-tu défini ce corpus ? À quel moment de ton travail s’est-il délimité ?
Juliette Riedler : Tout est plus ou moins parti de Zouc, d’une réflexion sur la figure de l’actrice. Le corpus s’est étoffé avec les filles de Belle Époque disons, dans le cadre du partenariat avec ma directrice de recherches, et ensuite ça s’est orchestré avec les différentes vagues des féminismes modernes, puisque l’enjeu était de fonder en droit cet art de l’interprète qui n’existe pas en le mettant en regard avec les mouvements d’émancipation féminine. De dire qu’à partir du moment où l’on prend conscience d’une classe sexuelle, d’une infériorité à cet endroit-là, il y a une puissance qui est identifiée à son art. Ce point a émergé naturellement pour les six interprètes. J’ai aussi procédé à des choix amoureux. Elles sont venues à moi par des expériences personnelles. Si Zouc m’a rapidement habitée par une expérience de création autour de son travail, les autres sont arrivées de manière plus universitaire. Sauf Angélica Liddell dont je connaissais un peu le travail.
Pour une généalogie de l’interprétation
Rodolphe Perez : Y a-t-il des figures que tu as évacuées au fil de ton travail ?
Juliette Riedler : Il y en avait beaucoup au départ, trop. J’ai appris à beaucoup aimé l’histoire du théâtre, parce que ça permet de construire ce qui est apparu pour moi dans le travail comme une histoire non seulement de l’art mais aussi des femmes. Il y avait tout un matrimoine à penser, une généalogie autour de cela. Je dis généalogie car c’était vraiment pour moi un acte de possibilité d’écriture. Et, oui des figures ont été écartées, comme Loïe Fuller, parce que la prédominance de la dimension technique, m’éloignait de certaines perspectives. La vraie raison aussi, c’est que je me suis rendu compte que j’avais une femme pour chaque scène : le théâtre, la danse, le chant, le mime, le solo féminin, la performance et la dimension rituel archaïque avec Saphho. Elle c’est la 7e, et le chiffre 7 m’a aussi arrêtée. Je préfère le chiffre impaire, il y a du poids dans l’impaire. Sappho est arrivée par un détour un peu mystérieux mais avec une puissance et une insistance bouleversantes. J’ai eu du mal à savoir comment en parler, comment la placer, à ne pas en faire un point d’origine parce qu’ancienne, mais de faire en sorte qu’elle arrive et revienne, cycliquement, comme une étoile. Elle a été pour moi matricielle dans le sens où elle est la poétesse tout comme Homère serait le poète, qu’elle s’exprimait dans une forme poétique, le mélos, distincte de l’épos, et qu’elle n’a pas été retenue parce que Aristote, qui a fait long feu comme on sait, lui, parlait des formes narratives, que le mélos n’est pas une forme narrative. Et puisqu’on a construit cette naissance de la démocratie et du théâtre, fantasme absolu de co-naissance de l’un comme de l’autre au Ve siècle, siècle classique, et qu’on a parlé d’Aristote qui lui parle d’Homère, l’identification à la sexualité a joué à plein, les textes de Sappho ont été brûlés, etc. tout cela a poussé plus ou moins à sa disparition de la scène de la recherche, et de la théâtralogie. Elle est évidemment présente comme figure tutélaire du lesbianisme, elle est présente dans les études antiques et encore étudiée par des chercheurs comme Claude Calame, lequel s’intéresse beaucoup à la question du genre et à la performativité du genre, notamment à l’ethnopoétique du genre, lequel se performe dans une forme rituelle poétique telle que l’était le mélos pour Sappho. Ces différents éléments chargent tellement sa figure, avec si peu de traces pourtant… Je voulais lui laisser de la place, elle a donc pris la 7e. Et puis, ces quatre moments historiques sont importants dans la mesure où beaucoup de choses ont émergé de la recherche féministe. Beaucoup de chercheuses sont en études gréco-latines, se disent des choses fortes de la construction d’un geste de femme qui enrichit notre mémoire et nos possibles, sans rien n’enlever de ce qui existe déjà à ce sujet. Je la trouvais donc assez importante. Et enfin, mais ça rejoint une certaine forme de verticalité, se sont des chants de mariage mais aussi de mort, et cela remet de la transcendance dans l’acte artistique, dont je trouve parfois les études féministes trop privées. C’est souvent plutôt une revendication horizontale et immédiate, pour moi il y a vraiment besoin de s’adosser, non pas à une colonne comme figure paternelle mais dans un nuage rêveur.
Rodolphe Perez : Alors, puisqu’il s’agit aussi d’histoire des représentations, assignant la représentation exclusivement à l’épos, par la narration, Aristote n’aurait-il pas aussi sapé la possibilité d’une mimesis du mélos ?
Juliette Riedler : Oui, absolument. Disons que l’épos a vraiment pour imaginaire général des héros masculins guerriers, qui font la guerre autour de la méditerranée. Comme on le sait aujourd’hui il en demeure quelque chose… Il y a des effets très réels en fait de ces récits. Et d’avoir privilégié ce récit là c’est aussi en effet se couper d’autres types de récits et donc d’espaces imaginaires qui font place au deuil, à la perte, à ce qui est identifié au féminin parce que de l’ordre de l’informe, de l’émotion, du sentiment, mais qui nous constitue comme êtres humains et vivants de manière essentielle. Des champs dans lesquels on ne va pas.

Rodolphe Perez : Sappho est présentée assez différemment des autres. Elle revient en filigrane, quand tu veux rappeler notamment que le geste se fonde sur la question de l’amour, de la mort et de la sensation. Tu mets aussi au jour la dimension réfléchie de l’ethos scénique de tes interprètes et tu ramènes toujours à leur dimension affective par le biais de Sappho, qui n’est pas un point d’origine historique dans ta réflexion mais apparaît comme un arrière-pays de ce que serait un rapport à l’affect.
Juliette Ridler : Absolument. Cette idée d’arrière-pays me plaît beaucoup, et me fait penser au recueil de Bonnefoy. On en parle, de ce texte, moi la première, comme une succession de figures, alors que tout à coup je vois comme un théâtre d’objets, au sens de la création d’une scène où elles seraient toutes. En tant que personne personnalisante et subjectivante aussi, puisque ça fait partie de l’écriture, et c’est sûr que Sappho, s’il fallait la représenter dans ce théâtre-là, elle aurait un statut peut-être différent.
Rodolphe Perez : Elle ancre quelque chose de cette généalogie dont tu parles et elle permet, même si tu ne pars pas dans une chronologie selon les siècles puisque ce n’est pas l’intérêt du propos, de montrer la puissance d’un arc interminable puisqu’ouvert.
Juliette Riedler : J’avais besoin de mettre un point lointain, en laissant des espaces vacants, parce que c’est une ouverture, une proposition que ce travail mené. C’est un arc fait de couleurs à nourrir, une invitation à entrer dedans, à discuter, à susciter des réflexions.
Rodolphe Perez : D’autant plus que ce n’est pas là une série de figures qu’on aurait pensée d’emblée en comparaison. Moi le premier, les connaissant toutes, je n’aurais jamais envisagé de les réfléchir et ensemble et à partir d’un tel prisme. Le fil conducteur de ta réflexion – ce prisme – est vraiment celui de l’émancipation par l’interprétation et de la rencontre d’une femme avec une scène. Et de dire ce qu’elle fait, en tant que sujet, de cette rencontre avec une scène. Une scène située historiquement, culturellement, génériquement. Comment situerais-tu, toi, la faille de cette histoire de l’interprétation ? Laquelle ne serait pas émancipée, pour poursuivre ta terminologie, de la question théâtrale.
Dès lors qu’il n’y a pas d’histoire, tout du moins qu’on fait croire aux élèves qu’il n’y a pas d’histoire, que c’est juste une personne face à toi qui a un savoir, s’opère un transfert beaucoup trop puissant
Juliette Riedler : Elle n’existe pas en tant que telle. Il y a une histoire du texte de théâtre, une histoire de la mise en scène, avec l’ouverture des chairs universitaires d’études théâtrales c’est-à-dire l’histoire du geste de la mise en scène, souvent identifiée à des hommes, sauf Ariane Mouchkine et Pina Bausch. L’autorité du spectacle rassemblé sous la figure masculine elle existe, l’autorité du texte existe, en revanche il y a des figures d’acteurs ou d’actrices qui marquent l’histoire mais dont on occulte la dimension de l’art de l’interprétation. Les différents travaux les présentant demeurent des monographies biographiques. Il y a des chercheuses qui déplorent notamment que l’art du jeu n’a pas d’histoire, et s’il y a une histoire à faire il faudrait qu’elle soit en regard avec l’art rhétorique, les formes esthétiques particulières non seulement à chaque scène (café-concert, opéra…), mais à chaque esthétique dans le temps. Il y a énormément de choses à dire mais c’est un art qui est très difficile à appréhender, à cause du manque de traces – lorsqu’il y en a elles sont éparses, ou mémorielles, dans les mémoires des unes et des autres. Il existe aussi les traités de l’art du jeu mais ce sont encore une fois des textes d’hommes, et ceux de Bernhardt, Guilbert ou Duncan par exemple, des splendeurs absolues, ne sont pas lus et pas réédités, pas considérés comme des outils. Ce n’est pas pour rien qu’aujourd’hui on voit des scandales éclater dans les formations d’interprètes. Dès lors qu’il n’y a pas d’histoire, tout du moins qu’on fait croire aux élèves qu’il n’y a pas d’histoire, que c’est juste une personne face à toi qui a un savoir, s’opère un transfert beaucoup trop puissant, pour les uns comme pour l’autre d’ailleurs. Il y a un problème à l’endroit d’une verticalité historique qui permet à chacun et à chacune de se référer à autre chose qu’à un moment présent. Je pense que même du point de vue de la santé d’un art et des personnes qui veulent l’exercer c’est très important. C’est pour ça aussi qu’on a eu du mal à considérer les jeux des acteurs et des actrices, surtout ces dernières, et qu’on les a renvoyés vers un corpus d’images. On a désubjectivé, désincarné des gestes. Chacune d’entre elles, pour marquer à ce point les mémoires, a dépensé une énergie folle.
Rodolphe Perez : Alors que tu précises – rappelles – justement, dans la dernière partie du texte, que la construction d’un rôle est profondément horizontale, parce que collective. C’est un des présupposés essentiels. Évidemment que la personne qui met en scène dirige une vision du texte mais la construction du personnage se fait dans l’altérité, sur une scène, par la mise en commun et en interaction, un croisement des lectures du texte. Et pourquoi est-ce que ça ne fait pas sens ?
Juliette Riedler : C’est une manière de critiquer la notion de génie. Et de parler de création collective à des moments où l’on n’employait évidemment pas ce terme mais pour rappeler l’importance de ce point. Et remettre la question de l’altérité au coeur de l’art. Construire une histoire du jeu n’est pour moi pas du tout antinomique d’une place laissée au présent de la création, au moment présent du geste. C’est désidentifier une sorte d’instant prégnant, du génie de la personne qui considère qu’on va créer un personnage, même Sarah Bernhardt en créant se réfère à des gestes qu’elle a vus, à la transmission de ses professeurs, hommes, qui projetaient des traditions mais aussi un imaginaire du rôle féminin. Sachant que les rôles féminins, tels qu’ils sont enseignés au conservatoire à cette époque-là sont peu nombreux. Il y a la jeune première, la princesse ingénue, la mère, la bonne, et parfois la sorcière.
Rodolphe Perez : Ce qui m’apparaît d’autant plus intéressant dans ce rapport à l’autorité en général dans l’interprétation, notamment chez Guilbert et chez Bernhardt, c’est leur manière de se départir l’autorité du texte. La seconde notamment en demandant une nouvelle traduction de Shakespeare, la première en reprenant des textes du répertoire classique, patrimonial. La bascule serait non plus de servir le texte, pour son autorité, mais d’asservir le texte à une vision de ce texte particulier, qui l’ouvre, et de fait, in fine, le sert à nouveau en élargissant le champ de son interprétation. Là on abolit l’individualité même de l’interprétation.

Juliette Riedler : Ce que j’ai eu envie de défendre c’est qu’il y a égalité entre les différents matériaux dans la création. Il y a égalité entre l’art de se costumer, l’art de jouer, le texte, l’art d’éclairer, ce qui constitue un moment spectaculaire dont le but est de transmettre à un public. Cette question de la transmission est forte chez Guilbert notamment. Dans un texte, elle adapte l’idée du support selon qu’elle donne son tour de chant dans cabarets du Chat noir ou bien sur les Grands Boulevards. Elle va ajouter des paragraphes du poème dans la zone Chat noir parce qu’elle sait que ça va faire le juteux et le chic de sa proposition et l’enlever sur les Boulevards parce qu’elle sait que le public ne va pas comprendre. Il y a une prise en compte du public dans la réception qui est admirable, et qui peut évidemment flirter avec la question de la complaisance mais qu’elle résout toujours je trouve – c’est en tout cas ce que j’ai voulu montrer – en choisissant des sujets très clivants. Elle donne la parole aux fœtus des personnes qui ont été avortées. Elle donne la parole à une femme battue par son mari. Les sujets qu’elle porte au jour sont des sujets extrêmement brûlants, et donc c’est tellement brûlant et vif qu’il lui importe absolument qu’ils soient reçus au bon endroit. Il y a cette adaptation du texte au public et oui elle le sert, mais pour servir le texte il faut se considérer comme le partenaire soi-même du texte. Du reste, elle était d’une érudition extrême : sur un poème de Jules Laforgue, « Ma petite compagne », elle va lire un conséquent corpus du poète pour vraiment comprendre ce qui se dit là, se joue là et comment elle peut s’en nourrir. Quelles sont les problématiques du poète, pour construire son personnage. De telle sorte qu’elle ne va pas réduire à une première lecture sa proposition scénique mais créer ses personnages en décalage. Le grand art de Guilbert se situe justement dans ce décalage qu’elle crée autour de figures souvent grimées. Elle fait rire mais en interrogeant la vanité de ce rire face à son sujet : de quoi ris-je ? Il y a un effet de tournoiement, on tourne autour d’un mystère, d’un vertige, qui renvoie les gens à des situations souvent vécues, tues parce qu’indicibles, parce qu’il n’y a pas le langage.
Rodolphe Perez : Sur la question de la transmission, elles ont en commun à mon sens la volonté d’un didactique qui se refuse à la fiction. Qui assume d’être dans une transmission. De fait, cela exclue la complaisance dans la mesure où l’adaptation au public est une adaptation qui cherche la réaction. Cela pose une nécessité : que le geste d’émancipation, dont elle prennent acte en interprétant, soit un geste de contamination. Bernhardt, quand elle décide d’assumer très clairement l’indécision érotique dans Lorenzaccio, et le jeu sur le corps de Colette, sur son saphisme ou pas, l’androgynie, et le mystère chez Guilbert… Il y a ce point commun d’une transmission de l’inconfort. Ce n’est pas une émancipation de soi, à soi, pour soi, mais une émancipation qui, ne se pensant pas pour choquer, semble s’ériger en contamination.
Juliette Riedler : En effet, l’émancipation, non seulement c’est un acte mais c’est aussi l’inverse d’une abstraction. C’est la transformation d’une énergie, donc du corps. C’est forcément en relation. On s’émancipe toujours de quelque chose, en débat, en combat, intime, collectif, artistique,… Il y a de la tension. On ne crée jamais tout seul mais en relation aux forces en présence. Un interprète avec son texte amorce un combat. Qu’est-ce que je comprends ? Comment le reçois-je ? Mais il ne s’agit pas d’un combat à servir ou pour dominer, c’est un combat qui vise un mariage, une association, une collaboration en vue de dire quelque chose. Je sais que la question du message est très controversée dans l’art. Il y a un endroit où c’est un problème dès lors que c’est politique, qu’il y a un asservissement de la personne à une idée préconçue, mais là ce qui m’est apparu c’est qu’il y a, chez Duncan par exemple, une profonde interrogation sur sa situation, le fait d’être femme dans un monde d’hommes, sur les différences d’expériences, qui n’est évidemment pas une différence d’essence, et des expériences qui ne sont pas reconnues, valorisées. Là une manière de dire, de faire partager.
Rodolphe Perez : Ce n’est pas militant. Si ça l’est, ça l’est parce que la personne dans son expérience se définit ainsi mais ça ne se pense ici que de manière épiphanique. Tu écris : « Jouer c’est l’acte de prendre ses distances avec la représentation que l’on se fait de soi et de l’autre. C’est fondamentalement mettre de l’espace dans les représentations, y mettre du jeu. » Défaire un signifiant d’un signifié qui serait arbitrairement sclérosant. Ce pour quoi le pouvoir du jeu, se rejouant à chaque fois, rejoue l’émancipation. Il re-propose une possibilité. Et ainsi tente de ne pas émerger comme un nouvel amalgame idéologique de signifiant-signifié qu’il faudrait réassigner. C’est vraiment, comme tu l’écris, mettre du jeu.

Rodolphe Perez : Finalement est-ce qu’il ne s’agit pas de l’expérience individuelle de réconciliation de l’épos en soi et du mélos en soi qui seraient invisibilisés ? Dans la mesure où l’aliénation peut être entendue comme une forme de guerre du monde sur soi, la représentation d’une guerre du monde sur soi qui nous assigne à quelque chose. Peut-être cela serait-il, alors, de revenir à l’intuition du mélos qui nous habite. Pour revenir à la parole féminine de Sappho, il y a comme une réconciliation qui se joue là, puis qui est mont(r)ée sur la scène, un peu de manière exemplaire. En disant au spectateur : le monde peut aussi être ça, je peux être Lorenzaccio, être Colette sans Willy, et transmettre à mes filles quelque chose d’autre comme Duncan. Une dimension exemplaire, qui n’est pas forcément vécue et pensée comme telle par elles mais qui, dans l’audace de la manifestation, s’impose comme l’étant.
Juliette Riedler : Absolument et la forme même du poème sapphique est une forme d’émancipation. Elle part d’un « je » éploré, désespéré par la douleur, qui fait appel à Aphrodite, la déesse de l’amour, parce que sans son secours il est impossible de s’en sortir, c’est un « je » à la frontière de la mort. Et dans le cadre du poème, la place est faite à la parole d’Aphrodite, qui intervient souvent par le rappel d’une loi non humaine, loi du cycle selon lequel tous les humains souffrent d’amour, globalement. Cette loi de la roue marque l’impossibilité d’y échapper. Par le rappel de cette loi portée par Aphrodite, le « je » du poète, remercie et retrouve un contact avec l’ici et maintenant, c’est-à-dire, quasiment toujours chez Sappho, la beauté, la lumière du soleil, l’odeur de l’herbe. L’émotion du présent et du vivant, et du présent et vivant végétal, non humain, qu’on appelle sous le mot « nature » mais qui relève du culturel chez elle. Un rappel à la sensation de la beauté, au présent, ces sensations qui sont des manières de se remplir d’autre chose et de se dire : j’ai laissé toute la place à la douleur mais je ne suis pas que ça. Se désidentifier de cette douleur-là. Oui, le poème de Sappho est quelque part un condensé de l’expérience d’émancipation. C’est ne pas nier ce qui nous constitue au début, nous constitue sans cesse d’ailleurs puisque le chant revient, mais considérer les étapes.
Rodolphe Perez : C’est un chemin de paix/deuil au sens de la psychanalytique, de deuil avec l’histoire personnelle. De ce qu’elle peut avoir de traumatisant. Et d’émancipation de ce que la douleur peut avoir aussi d’empêchement, que la scène permet de révéler.
Juliette Riedler : La loi, chez Sappho, c’est Aphrodite, une femme, la déesse de l’amour. Ce polythéisme a ceci d’intéressant qu’il offre un regard particulier : c’est elle, pas Diane chasseresse, pas Zeus tout puissant. Il n’y a pas papa en fait.
Pour une émancipation par la scène
Rodolphe Perez : Sur la question de la scène, tu indiques que ce qu’elles font également consiste aussi à créer des formes. Je trouve cet élément essentiel parce qu’il y a certes, la reprise du texte, l’imagination d’un ethos scénique qui évolue, mais aussi cette création d’un espace. Elles postulent que les espaces d’émancipation ne sont pas suffisants, ou pas les bons, pour accueillir le geste qu’elles entendent incarner.
Émanciper c’est enlever la main, mancipation, qui était sur soi, geste qui constitue de fait la création d’un espace.
Juliette Riedler : C’est vraiment un des points essentiels et qu’il me fallait réussir à montrer. Émanciper c’est enlever la main, mancipation, qui était sur soi, geste qui constitue de fait la création d’un espace. Donc il fallait montrer comment l’émancipation est consubstantielle à un acte de création authentique et subjectivisant. C’est l’une des thèses du livre, fondamentale pour moi, sachant que chacune parle de l’émancipation d’un point de vue particulier. Ce pour quoi aussi je voulais une pluralité d’interprètes et de points de vue, en réponse. En tout cas c’est toujours à partir de l’étude de spectacles que ça se joue : Zouc parL’Alboum, Liddell avec L’Année de Richard où elle interprète un homme en quête de pouvoir, qui n’a jamais résolu la blessure intime de s’être fait victimiser toute sa vie pour être laid et puise son énergie dans cette faille, cette blessure archaïque, une énergie de revanche et d’écrasement. Liddell montre que l’émancipation signifie aussi changer de corps. Sortir d’une certaine économie libidinale, majoritaire, parce que c’est celle qui gouverne le monde. Parce que le personne de Richard III qu’elle a construit est un mélange – elle le précise – de Tony Blair, Aznar, … ceux qui ont fait la guerre à l’Irak, des présidents ou chefs de gouvernement démocratiquement élus, la psyché collective. C’est nos corps collectifs majoritaires. L’enjeu me semble là être posé de manière suffisamment massive et dans toutes ses complexités.
Rodolphe Perez : Ce que cela manifeste serait aussi comment la vindicte individuelle se meut en force aliénante pour un collectif. Malgré tout, on tolère cela, le pouvoir de l’un sur le multiple, et donc l’aliénation du multiple par l’un mais on ne tolère pas, en miroir, l’émancipation du collectif par le geste émancipée de l’un. Alors que c’est précisément ce que tente de rééquilibrer ton texte, aussi. L’individualité, ou l’ethos scénique qui éclate sur scène et s’émancipe peut contaminer les autres et ouvrir un espace où chacun peut entrer. Ça c’est beaucoup moins tolérable car se situant davantage du côté du mélos. Sans doute est-ce là le sentimentalisme d’un idéal commun. Il y a un geste de communion qui s’opère, comme un des enjeux de la représentation, une rencontre a lieu.
Juliette Riedler : La perspective de la communion est épineuse mais par rapport à ce que tu dis, la question est bien celle de savoir comment on accorde à une actrice le pouvoir de nous modifier en profondeur. Cela fait entrer en jeu la manière dont chacun, dans le public, accepte de se laisser interroger par ce qu’il vient de vivre ; ça c’est le spectateur idéal, mais il n’y en a pas beaucoup et il n’y a pas beaucoup aujourd’hui de spectacles qui laissent la place de s’interroger, ou l’envie. Parce qu’il faut aussi créer un désir. Ce que j’ai aussi voulu mettre en évidence par ces spectacles : si j’ai montré qu’elles sont émancipées, dans quelle mesure est-ce qu’elles parviennent à être émancipatrices, leur geste émancipateur ? Comment faire pour, et comment ne pas se taire soi-même dans son propre désir de création ?
Rodolphe Perez : Tu éclaires à ce sujet un paradoxe dans la réception de l’interprète. On tolère de l’actrice ce qu’on veut confortablement y représenter. Il semble paradoxale de considérer un tel désir des actrices et un tel refus d’acceptation de leur présence, culturelle, théorique, émancipatrice, etc. En biaisant par le désir d’une autre représentation d’elles-mêmes, elles peuvent arriver à créer une ouverture, une certaine idée du détour.

Rodolphe Perez : Leur point commun, aux 6 interprètes, excluant Sappho, ne serait-il pas celui d’un refus de la fiction en assumant l’absence du quatrième mur ? Et dans l’humour, et dans l’agressivité, et dans le travestissement, etc. N’est-ce pas aussi là un biais par lequel elles obligent à avoir conscience qu’on regarde quelque chose qui nous empêche de ne pas réfléchir, au moins à l’ambivalence de ce qu’on regarde ?
Juliette Riedler : Elles sont toujours dans le jeu du regard, dans la réciprocité, disant au spectateur « tu me regardes, mais tu es aussi regardé par moi ». Réciprocité en acte et au moment même du spectacle, c’est assez fort dans leur geste en général : apprendre au spectateur qu’il n’est pas le seul à regarder. Ce regard-là invite à se regarder soi-même, pour le public. Et c’est aussi sans doute une voie pour le public d’accepter, puisqu’il y a du regard de part et d’autre, qu’il y a une subjectivité, elles ne sont pas pur objet, pure image. Elles affirment : je suis une personne qui donne une représentation que j’ai créée mais dont je ne suis pas dupe et j’espère que tu ne seras pas dupe non plus. Il y a des alliances entre la scène et la salle, qui dépendent de l’endroit où tu crées l’alliance.
Rodolphe Perez : Tu écris – et ça me semble rejoindre ce que tu dis dans la mesure où c’est vraiment l’histoire individuelle de l’interprète qui rencontre l’histoire culturelle de son sujet, qui rencontre l’histoire située de son spectateur : « Se former à l’art scénique c’est prendre connaissance de son histoire intime telle qu’elle nous a forgé un corps. La démarche d’émancipation ne consiste ni à refouler ses origines, ni à les brandir comme étendard mais d’en faire un geste d’art. Cela a partie liée à la construction, pour nos actrices, d’un ethos scénique. » C’est-à-dire qu’il y a toujours au moins deux personnes dans l’actrice sur scène, ce qui leur permet de sortir de leur propre présence pour regarder l’histoire qui se joue, et donc regarder la salle.

Juliette Riedler : Absolument oui.
Rodolphe Perez : Cela est d’ailleurs peut-être plus prégnant encore chez des femmes qui refusent l’assignation à des rôles topiques à ce moment précis de leur histoire et de leur histoire culturelle. Parce qu’elles savent qu’elles vont potentiellement être regardées selon les quatre rôles que tu as évoqués tout à l��’heure. Elles savent sans doute aussi qu’elles arrivent avec cet horizon d’attente-là du spectateur. Sans doute leurs détours offrent-ils un pouvoir plus grand de heurt.
Juliette Riedler : Oui, parce que non seulement elles vont biaiser mais surtout elles déplacent : j’ai choisi d’étudier des spectacles dans lesquels elles sortent des rôles patrimoniaux. Il y a un déplacement du point de vue de l’histoire culturelle, de l’histoire du jeu. Il y a un effet de dérangement pour le moins important.
Rodolphe Perez : D’autant qu’elles sortent de ces rôles patrimoniaux en les maîtrisant parfaitement. Notamment pour Bernhardt, Guilbert avec ses textes, … Elles affirment en même temps avoir une conscience historique et culturelle de ce qu’elles font.
Juliette Riedler: C’est extrêmement fort. Elles savent, notamment pour celles que tu cites, les effets de transparence et de profondeur historiques. Elles savent que quand elles apparaissent, elles apparaissent avec un feuilletage des rôles précédents. Quand Sarah Bernhardt joue Lorenzaccio en posant délicatement sa main sous son menton, en regardant par la fenêtre, elle sait très bien à quel imaginaire elle renvoie. Elle construit son personnage avec toute la puissance de féminité dont elle est chargée, en tant que femme mais aussi en tant qu’interprète de rôle comme la Dame aux camélias, etc. Elles sont dans un plaisir de la construction et du jeu avec le public incroyable. C’est là qu’est le plaisir de l’art. Le plaisir de désidentification, de conscientisation de son histoire, des regards permanents, une historisation permanente de son travail.
Rodolphe Perez : Ce qui matérialise aussi simultanément le rapport émancipé à leur propre corps puisque d’un corps a priori de désir ou assigné à des rôles singuliers, elles retournent quelque chose avec une malléabilité heureuse. Elles réaffirment la présence du corps et la liberté de ce corps.
Juliette Riedler : Je crois surtout qu’elles abattent la tristement fameuse frontière entre le corps et l’esprit. Elles la nient. Cette frontière sur laquelle s’est construit un rapport hiérarchique et néantisant, notamment entre les hommes et les femmes, les premiers du côté de l’esprit, les secondes du côté du corps, qui rejoue l’épos et le mélos entre une masse physique et belliqueuse, et le regard sur le plein et le vide. Cette frontière, elles la complexifient, et font de la conscience un espace éminemment physique, corporel et pas du tout un mental, comme une idée a priori, ou une élucubration. Toutes ces catégoriques abstraites qui font les guerres et occultent la complexité du vivant.
Rodolphe Perez : Tu écris ceci : « L’expérience de jeu est celle d’une sortie de soi pour donner sens et vie à quelque chose. » Par là tu n’évoques rien de métaphysique mais plutôt que le sur-ancrage du corps dans un jeu émancipé et libre, permet par l’outre-corps de représenter quelque chose de l’ordre d’un dépassement. L’ethos scénique sur-individualise la présence mais n’est pas un ethos égotiste. Elles se servent du jeu culturel de leur époque, de l’économie de leur époque pour donner à imaginer d’autres espaces mentaux.
Juliette Riedler : Oui, la sortie de soi à cet endroit est vraiment important car elle signale aussi la question de l’altérité. De ne pas être dans un regard complaisante sur soi : je me regarde faire pour m’assurer d’être conforme à l’image que je désire renvoyer. Ce qui est le pire. Il s’agit plutôt de dire : je sors de moi pour ajuster à la réaction du public. C’est ce que disent tous les acteurs. Un interprète sur une scène sent la salle et ajuste son jeu en fonction. C’est le développement d’une conscience qui est fondamentale de l’art de l’interprétation, cette distinction entre soi et l’autre, non pas une dissociation.
Rodolphe Perez : Dans la mesure où l’interprétation se construit conjointement à l’équipe, le rôle n’est jamais fini. Il se reconstruit aussi chaque soir par l’intuition de la salle. Et dans le débit, et dans la posture,… ce n’est jamais la répétition du même, mais plutôt mille plateaux, portés par des ramifications perpétuelles.
Juliette Riedler : C’est en cela qu’il me semble important de considérer le travail de l’interprétation et de ces femmes qui sont beaucoup plus que des interprètes, autrices de leurs propres partitions. Ce pour quoi il me semble important de le considérer dans l’art du théâtre. Qui œuvre à une histoire des interprétations, des positions des regards, de positionnements. La place que tu accordes à l’interprétation de l’autre.
Rodolphe Perez : Tu accordes, toi, une place importante à la Belle époque mais c’est précisément parce que quelque chose de fort s’y joue. Tu montres, par l’interprétation, que l’histoire se joue ainsi et s’éclaire de la sorte : l’interprétation dit aussi quelque chose des mentalités situées.

Rodolphe Perez : Chez Colette, on décèle comme une façon presque névrotique de toucher à tout, elle accumule les expériences et les présences, la scène comme l’écriture, et la pluralité de ces scènes aussi. Tout cela est associé à forme de légèreté qui jaillit de son ethos.
Juliette Riedler : Il y a un plaisir de la scène et du jeu. Ce qui m’a aussi intéressé chez elle c’est l’animalité, de la chatte au faune. Ce qu’on a glosé quant à sa littérature se retrouve aussi dans les invitations qui lui ont été faites. Le sens du goût aussi y est très développé. Elle ne perd jamais la conscience d’elle-même, l’œil qui frise : comme leçon d’émancipation c’est important, elle dézingue l’esprit de sérieux. A peine montée en scène en faune, divinisée par Rachilde, Montesquiou, ou d’autres, elle répond par un conte en affirmant n’être qu’un faune de Boulogne en carton et gadgets. Elle casse la puissance identificatoire et en est consciente très tôt dans sa carrière.
Rodolphe Perez : Elle joue l’épiphanie de l’émancipation sur la scène et ensuite déjoue l’assignation au rôle qui serait désémancip�é. Elle refuse le retour de la mancipation par la lecture externe de son rôle, là où l’on va gloser sur son geste émancipateur pour l’enfermer dans le discursif.
Juliette Riedler : Ce en quoi l’émancipation n’est jamais achevée puisqu’elle est confrontée à la pulsion de fixation.
Rodolphe Perez : Le non-sérieux – Nietzsche, dont tu parles aussi – répond au définitoire, par un éclat de rire. Et puisque tu ouvres ainsi à une généalogie, comme à une danse, pour filer ces réflexions, y aurait-il des lignes de fuite contemporaines à cette réflexion ? Quelles interprétations reconduiraient ces gestes ?
Juliette Riedler : J’aime beaucoup ce que fait Adèle Haenel. Elle cherche, est dans l’invention de sa trajectoire. Je pense qu’elle travaille énormément, très solide lectrice. Et elle bouge, dérange infiniment. Je trouve cela assez passionnant. Ça me réjouit de voir une interprète en réflexion entre son art et la société. Et on la voit à côté des femmes de ménage de l’Ibis, à côté de travailleuses des cheminots, ou sur scène dans des pièces exigeantes ou des partitions lesbiennes de Sciamma. Elle est à un endroit où elle construit une cohérence en mouvement. J’ai beaucoup aimé la trajectoire d’Adjani également. Ses quelques prises de paroles récentes m’ont beaucoup plu. Je suis bouleversée par la générosité que je sens chez elle, dans la scène politique comme dans la scène théâtrale. Je parle de ces deux-là parce qu’elles sont à un niveau de célébrité important, similaire aux interprètes de mon corpus mais il y a en beaucoup qui réfléchissent ces enjeux, construisent des trajectoires.
- Juliette Riedler, 7 femmes en scène : émancipations d’actrices, L’Extrême contemporain, 2022.