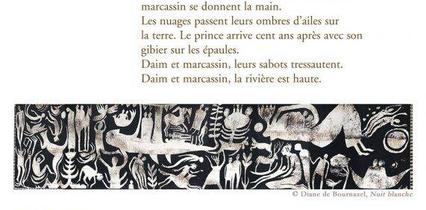Jeune réalisateur américano-portugais passé par les Beaux-Arts et dont les courts-métrages témoignent d’une inventivité visuelle et narrative, Gabriel Abrantes réalise Amelia’s Children, film d’épouvante pervers et amoral qui retrace une quête identitaire et familiale conditionnée par le tabou de l’inceste.

Quel film d’épouvante peut-on réaliser lorsque l’on est un cinéaste qui, jusqu’à présent, proposait des fictions reconnues dans le milieu de l’art contemporain ? Cette question amorce l’appréhension que l’on se fait de ce second long métrage qui retrace la recherche des origines familiales de Edward (Carloto Cota), trentenaire orphelin à qui la petite amie, Riley (Brigette Lundy-Paine), offre un appareil connecté capable d’analyser l’ADN. Le couple quittera alors la métropole new yorkaise pour rejoindre le Portugal et rencontrer la famille retrouvée. C’est en terrain connu que l’on pénètre dans ce qui ne rejette aucun poncifs du genre. Pour quitter la grande ville et pénétrer la campagne, la caméra prend de la hauteur pour suivre le véhicule des protagonistes, présence omnisciente qui veille sur le destin des personnages. Si ce type de plan rappelle d’innombrables films d’horreur, il se rapproche ici d’un geste kubrickien quand la voiture serpente les montagnes et traverse les tunnels. On imagine une majestueuse demeure isolée façon Shining (1980) et la folie comme contagion. En effet, la fiction va se déployer entre les murs d’une mystérieuse maison supplantée dans les hauteurs d’un village isolé. Des structures boisées aux vastes pièces, le décor prend des airs de Suspiria (Dario Argento, 1977). La contagion, quant à elle, ne se contente plus d’être psychique : elle sera consanguine. On retrouvera ainsi rapidement le goût du screamer et le sang pour tableau mais avec intelligence et mesure. Car si Abrantes reprend des codes reconnus pour leur efficacité, il en propose une actualisation contemporaine dans laquelle la prise de pouvoir des personnages féminins sur la naïveté de personnages masculins malmenés accompagne une perversité thématique assumée qui participe au relief du film.
Filiation empoisonnée
Ce que propose Abrantes, c’est une fresque familiale en forme de conte horrifique. Cette tendance rappelle le travail de certains réalisateurs tels que Ari Aster dont le film Hereditary (2018) semblait annoncer un sous-genre du film de névroses familiales. Ici, comme souvent, il va falloir se confronter au pire pour espérer renouer avec une famille décomposée. Et si les morceaux à recoller semblent présager le mauvais augure d’un miroir brisé, Edward espère y parvenir, prêt à retrouver la docilité d’un enfant soumis aux exigences d’une mère tyrannique. Le spectateur ne s’étonnera pas de la malléabilité du jeune homme. Le film ne cesse de le dépeindre comme un homme prudent mais naïf, sorte de gentil garçon au service de celles qui le gouverne. Incapable de choisir entre celle qu’il aime et celle qui l’a mis au monde : il s’adonnera aux désirs de l’une et l’autre, selon son degré de soumission et la progression de l’enchantement.
Le héros est accueilli par son frère jumeau, Manuel, doppelgänger interprété par le même comédien qui, pour se distinguer, arbore des cheveux mi-longs et une silhouette androgyne ponctuée d’une gestuelle lascive. Le spectateur est perturbé par ce dispositif qui permet de dédoubler l’acteur, ce qui participe au trouble d’une fiction dans laquelle le double constitue nécessairement une présence gênante et anxiogène. Ce jumeau campe l’idéal de l’hôte serviable tandis que le jeune couple s’extasie devant les merveilles offertes par le lieu. Riley remarque la présence d’une paire d’oiseaux nichés dans une cage. Elle lui demande s’ils sont frères, Manuel répondra qu’ils sont amoureux. La frontière est mince entre le lien filial et le lien charnel. Quelques temps après, Riley dessine les oiseaux sur sa tablette. Le geste parait innocent mais déjà elle transpose la réalité dans un cadre fictif et graphique. Riley projette les volatiles sous l’angle de son regard et de ses doigts agiles. Elle finira, plus tard, par s’imposer comme metteuse en scène du drame familial. En attendant, la fiction laisse échapper les indices d’un dérèglement ; la rencontre entre Edward et la mère se fait de nuit, dans l’entrebâillement d’une porte, gants noirs ornés de pierres précieuses. L’arrivée du fils est alors célébrée par l’émotion baroque d’une mère au visage monstrueux. Se laissant charmer par l’éclat d’une telle situation, Edward tombe dans les bras de celle qui cherchera toujours l’admiration de ses petits.
Narcisse au théâtre
La voracité de la mère apparaît progressivement comme le véritable enjeu de l’intrigue.
Le sortilège opère sur les garçons mais reste inefficace auprès de la jeune femme, beauté qui s’ignore aux cheveux courts et visage nu. La mère, elle, remarque le charme détenu par la compagne de son fils. Elle lui fait remarquer le potentiel sensuel de ses lèvres, après avoir déclaré que « le temps est une pute ». Cet attrait de la jeunesse supplante désormais la quête des origines. Davantage que le périple d’Edward, la voracité de la mère apparaît progressivement comme le véritable enjeu de l’intrigue. Ces protagonistes masculins ont l’air désincarnés, pantins au service d’un ordre supérieur, celui d’une matriarche sans âge ni vrai visage. Le personnage de la mère est joué par une jeune femme, Anabela Moreira, actrice grimée pour le rôle. Le choix des prothèses faciales ne laisse rien au hasard. Ce visage d’une laideur informe offre une peau à la texture onduleuse et une bouche qui dégouline d’une insatiable gourmandise. Armée de son masque, la mère déambule en tenue d’apparat, soucieuse de séduire et de consommer tous ceux qui l’entoure. Tous sauf Riley, l’autre femme, celle qui refuse de participer au jeu des retrouvailles. C’est elle qui découvre les rapports incestueux, elle encore qui s’arrête devant le tableau représentant la mère et son fils, peinture qui rappelle le Saturne dévorant un de ses fils de Goya. Elle comprendra très vite qu’ici, il faut tuer le père et manger le fils. Non seulement pour inverser les rapports de force, mais aussi parce que le seul moyen de rester Narcisse en son royaume, c’est d’avaler la jeunesse. Dès lors, la mère étendue dans une mare de sang retrouvera in fine le reflet de son visage.
La structure mythologique choisie par le cinéaste permet ainsi de dessiner les contours d’une histoire familiale pathogène. Le mythe conserve donc son caractère atemporel et universel, au service d’une compréhension des violences les plus insidieuses. Le genre horrifique quant à lui n’est pas le choix d’un décorum distrayant mais la nécessité d’un cadre qui contient ce qu’il y a de pire à raconter. Là où l’érotisme morbide devient l’unique promesse de beauté éternelle.
- Amelia’s Children, un film de Gabriel Abrantes, avec Brigette Lundy-Paine, Carloto Cotta. En salles le 31 janvier.