
Qu’est-ce qui amène un jour à l’écriture ? Et qu’est-ce qui nous y attache, par la suite ? Dans Le plus court chemin – cinquième roman d’Antoine Wauters paru aux éditions Verdier – se dessine l’itinéraire d’écriture et de rupture de celui qui écrit depuis la campagne wallonne depuis presque dix ans déjà. Sorte de vagabondage autant que quête originelle, ce plus court chemin se présente comme une véritable réflexion sur ce qui nous attache encore à l’acte d’écrire.
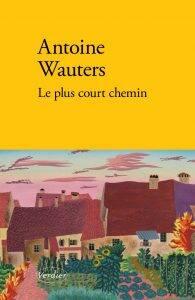
L’écriture est une recherche qui revient toujours à soi. Marcel Proust a passé sa vie à l’écrire et l’on sait désormais que s’il existe plusieurs chemins pour y arriver ou en partir, ils sont tous reliés au même lieu originel depuis lequel s’écrivent les souvenirs qui deviendront la matière des livres à venir. Si le chemin peut-être long pour certaines mains, c’est le plus court que décide d’emprunter Antoine Wauters dans ce roman éponyme. Ce nouveau livre se présente comme un puzzle éparse de tout ce qui ramène et rattache à l’écriture de soi, quand bien même on voudrait chercher à se décrotter du terreau de l’enfance.
Mots : ce qui arrache au monde qui n’est plus là
Rares sont celles et ceux qui vivent toute leur vie durant sur la terre de leurs aïeux. Quelques exceptions demeurent, bien entendu, mais elles sont souvent liées à certaines activités qu’on ne peut exercer ailleurs : on reprend l’exploitation familiale, l’entreprise modeste mais tenace qui porte le nom de son grand-père ou encore l’épicerie ou le restaurant que notre grand-mère tenait déjà il y a près d’un siècle. Pour autant, lorsque les conditions matérielles nous le permettent, l’âge adulte rime souvent avec un départ qui marque une rupture géographique ; c’est qu’on ne voudrait pas se réduire à répéter l’histoire de nos propres parents. C’est la ville alors (grande souvent), qui nous tend les bras et ce n’est qu’une dizaine d’années plus tard que l’on accepte vraiment d’où l’on viendra toujours : « J’ai vécu jusqu’à mes dix-huit ans dans un petit village d’Ardenne où mon imagination se trouve encore. Que je le veuille ou non, tout ce que j’écris vient de là. ».
Dès qu’il écrit les paysages de son enfance – l’Ardenne, en l’occurrence – , Antoine Wauters se place à hauteur d’enfant et décrit à partir des notes retrouvées les mots et les gestes de ceux qu’il a aimés. Plus qu’une lamentation mélancolique, ce livre se propose d’être la tentative d’une ventriloquie poétique entre les voix qu’il a connues (et pour certaines perdues), et celles qu’il incarne encore aujourd’hui : « Parler avec la voix d’un enfant qui ne reviendra plus, de la parole perdue. »
Mots : ce qui rattache aux terres de l’enfance
« Je suis parti. Jusqu’au jour où, plongé dans l’écriture d’un premier texte, je me suis aperçu que les voix lentes et spongieuses des gens du coin ne m’avaient pas quitté. Au milieu des fêtes bruxelloises où mon accent continuait d’être moqué, c’est à elles que je pensais. Et maintenant, enfoncé jusqu’au cou dans l’écriture, je continue de me les passer en boucle. Je les écris. Tout vient de là. »
Une fois la terre connue quittée pour rejoindre le tumulte et l’agitation des villes, on se croit débarrassé de tout ce qui nous ramènerait au connu originel. Il suffit pourtant d’un petit rien pour que la honte surgisse et nous mutile le visage d’une rougeur embarrassante : une consonne qui frappe un peu trop fort sur le palais, une expression méconnue des nouvelles personnes que l’on côtoie, un vocabulaire oublié qui ressurgit dans notre bouche et nous sommes démasqués : on n’est pas né ici, notre place est ailleurs.
« C’était l’époque où les mots ne m’avaient pas encore décrotté, où je ne savais ni lire ni écrire mais où je sentais que, d’une certaine façon, j’étais sous leur emprise. Quelque chose de ce goût-là. » A la lecture de ce roman, il est difficile de ne pas penser à divers transfuges de classes tels Nicolas Mathieu, Didier Eribon, Annie Ernaux ou encore Marie-Hélène Lafon. Depuis quelques années, une nouvelle expression commence à s’imposer dans l’usage tant son acception paraît plus fine et plus juste avec les figures que l’on invoque ici : nomade de classe. Pour ceux-là, il ne serait plus question d’un changement ou d’une traversée irréversible (on quitterait une classe comme on quitterait un pays où on ne reviendrait plus jamais) mais ce serait davantage une forme de mouvement qui se fixerait tantôt proche du présent construit, tantôt proche du passé reconstruit ou déconstruit : je suis celui qui reconnaît le périmètre qu’il habite ; je sais d’où je viens et où je reviens, parfois.
Il n’est donc pas question pour Antoine Wauters de renier absolument tout ce qu’il a connu enfant mais plutôt de s’en emparer comme d’une trouvaille qui mérite toute son attention : « Quand on montait dans leurs greniers, c’était un passé tellement éloigné de nous, un passé qu’on comprenait si peu, si mal (« massette », « rouet », « baratte »), un passé qu’on ne pouvait tellement pas nommer, qu’on avait l’impression de se trouver dans le futur ou au coeur d’un continent nouveau. »
Mots : ce qui manque (parfois) dans nos silences
En vieillissant, Antoine Wauters s’accepte comme L’enfant des ravines (titre éponyme d’un roman paru en 2019). Il a collecté voire collectionné les mots écrits par des mains qui lui sont proches et qu’il ne peut désormais plus (re)tenir. L’écriture serait alors ce qui permet la réunion des morts et des vivants de la même manière qu’elle permet au passé de (re)joindre le présent : « J’écris pour rester nombreux.»
L’écriture serait alors ce qui permet la réunion des morts et des vivants de la même manière qu’elle permet au passé de (re)joindre le présent : « J’écris pour rester nombreux.»
D’une certaine manière, l’acte d’écrire apparaît comme la seule et unique possibilité d’incarnation de ce qui se perd comme de ceux qui se perdent (ici, dans les fanges de l’oubli comme dans les creux des mémoires maladroites). La mémoire est ce qui va habiter ce « grand lieu vide sans personne » qu’est devenu le corps de l’écrivain.
« Je repense à avant, ma vie avant les morts. Ces heures ont existé et elles n’existent plus. ». L’écriture est l’expérience de la naissance autant que celle de la mort imminente ; on écrit pour faire naître quelque chose qui mourra au moment où sera apposé le point final et il incombera alors à chaque personne qui lira le livre achevé de réanimer tout ce qui s’est fixé dans l’écriture et qui appelle un mouvement de sursaut ou un appel d’air, selon ce qu’on voudra y voir. Si « [a]u fond de tout est le silence », il ne suffit alors peut-être que d’ouvrir le livre qui donne accès au plus court chemin pour invoquer et profiter de « [c]e besoin inouï de rêver en silence. »
- Le plus court chemin, Antoine Wauters, Verdier, 2023
Crédit photo : Antoine Wauters © Lorraine Wauters

















