Anna Ayanoglou est en voyage au cœur de son œuvre, une quête intime et poétique où chaque vers questionne ce que signifie réellement « appartenir ». Loin d’être une évidence, l’appartenance devient une lutte, réflexive et existentielle, entre le poids des racines et l’envie de s’en affranchir. À travers une écriture fine et habitée, elle nous fait ressentir la tension entre le corps qui souffre et l’esprit qui cherche un refuge : comment se sentir chez soi ? Entre la Grèce, terre d’origine, et la mémoire familiale, s’esquisse un voyage intérieur marqué par la douleur, la perte, mais aussi la résilience. Appartenir résonne comme une exploration poétique de ce besoin fondamental d’enracinement, jamais vraiment apaisé.
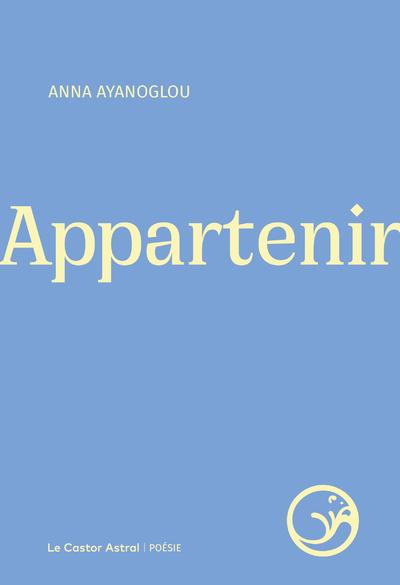
Cette tension est exacerbée par l’idée que le corps, en étant source de douleur, devient un obstacle à l’appartenance, à la fluidité de l’être dans le monde. À travers la matérialité de cette douleur physique, Ayanoglou peint une allégorie de l’altérité, de l’isolement, et de la quête impossible de réconciliation avec soi-même. Dès le début de l’œuvre, la boule et le nœud sont des symboles omniprésents qui incarnent la douleur existentielle et physique de l’autrice, exprimant une lutte intérieure intense. Ayanoglou décrit ce sentiment par : « Une boule — non : un nœud cristallisé, diamant noir insécable greffé à mon diaphragme. » Ce nœud traduit un malaise profond, une sensation d’étouffement qui fait écho à l’impossibilité de se défaire des entraves émotionnelles et identitaires. Le nœud représente la pression inextricable des attentes familiales, des traumatismes non résolus, et des questions d’appartenance. Ce poids s’illustre également dans le souffle toujours « incapable de satisfaire, d’arriver à son terme » : la respiration elle-même demeure entravée. Le nœud devient ainsi la métaphore centrale de l’ouvrage, soulignant l’impossibilité de trouver la paix intérieure, tant que ce fardeau persiste. Cette boule et ce nœud traduisent un conflit intérieur constant, où l’âme est étranglée par le corps.
La maison de l’enfance : un territoire volé
Si le corps est une première barrière à l’appartenance, la perte de la maison familiale en est une autre, tout aussi concrète et douloureuse. La maison de l’enfance, un lieu censé incarner les racines et la stabilité, devient un espace de dépossession. « Avec la maison de l’enfance, de toutes les vacances accaparée deux ans plus tôt — mais non, ta tante a juste racheté les parts. » Cette citation révèle la brutalité avec laquelle des souvenirs, des racines, et même une partie de l’identité, peuvent être effacés par des décisions pragmatiques. Ici, le territoire de l’enfance n’est plus qu’un bien matériel, dérobé dans une transaction froide. Car la maison, en tant qu’ancre émotionnelle, s’efface pour laisser place à un exil intérieur, un vide où même le retour au lieu des souvenirs devient impossible. Ayanoglou montre que l’appartenance n’est jamais seulement culturelle ou familiale, mais profondément liée aux espaces que l’on habite, qui définissent et structurent nos souvenirs et nos identités.
Appartenir est une œuvre qui explore la complexité de l’appartenance à travers les prismes du corps, de la famille et de la création artistique.
La Grèce : un seuil entre l’héritage et l’étrangeté
Dans ce contexte de perte matérielle, la Grèce, pays du père, se présente comme ...

















