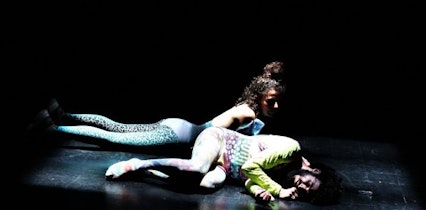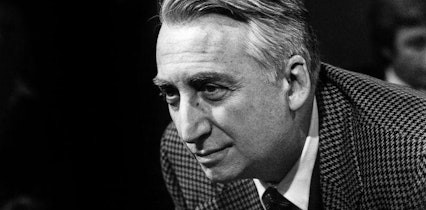-« Alors Obélix l’Helvétie, c’est comment ? » interroge Panoramix, le druide du village gaulois, « Plat » lui répond Obélix qui s’est endormi au moment de la traversée des montagnes de Suisse.
L’intrigue principale du roman de Fabrice Pataut intitulé Reconquêtes est le récit de Dorothy Cunningham qui possède un terrain qui a la forme des Etats-Unis, pays par ailleurs très en relief, un peu comme la Suisse… A l’instar d’Obélix je répondrais volontiers, à qui me demande mon avis sur cet ouvrage qu’il est « plat » ou peut-être, tout comme Obélix, me suis-je endormie pendant la traversée romanesque.
Ce roman évoque tous les sujets convenus sans oser s’engouffrer dans une voie déterminée
« Elle saisissait l’ampleur de ce qu’ils devaient tous à l’Amérique ; aurait pourtant préférée que Koons avançât enfin sa main sur sa cuisse ». Cette citation est tout à fait révélatrice du roman en général, mêlant apologie de l’Amérique et histoire d’amour convenue, comme celle de Karen et Don en « relation libre », puisque Karen en femme libérée a de nombreux amants, dont un certain Duke un imbécile heureux mais viril, quoi de plus symbolique que ce couple pour incarner la liberté qui souffle aux Etats-Unis ? Mais heureusement, l’amour n’a pas disparu de ce pays paradisiaque puisqu’à la fin de l’ouvrage Rachel et Dexter, homme mystérieux qui porte lourdement le deuil de son fils, perdu dans un accident de voiture (quelle mort plus emblématique de l’Amérique que celle d’un jeune homme dans un accident de voiture, on le confondrait presque avec le James Dean de la Fureur de Vivre.) regardent ensemble «la nuit profonde s’éteindre, glisser sans bruit de l’autre côté de la terre, les étoiles s’effacer et le soleil couronné d’or se lever pour eux au bout du jardin Cunningham. » Tout est bien qui finit bien ! et on en pleurerait presque.
So ?
L’apologie de l’Amérique est présente à même l’écriture de Pataut qui ne cesse d’user d’expression de la langue anglaise, qui symbolise, pour tout lecteur lambda, l’attitude américaine et ses « so ? » un peu insolent et un peu nonchalant, on imagine volontiers les personnages mâcher du chewing-gum en posant leur question. Cette retranscription de l’américain semblant vouloir donner (Mais l’auteur y arrive-t-il vraiment ?) une certaine allure et une certaine étoffe aux personnages, dont l’un, en bon américain qui se respecte, défend contre vents et marées l’importance cinématographique du film de Griffith, Naissance d’une Nation, tout en concédant timidement qu’il s’agit d’un film raciste, d’ailleurs il a une amie noire.
Mais l’apogée de l’idée convenue est peut-être le fait que le personnage qui détient, lui aussi un jardin qui a la forme d’un pays : l’Alaska, et qu’il souhaite vendre à Dorothy Cunningham (qui elle, a un terrain qui a la forme des Etats-Unis) est un homme d’origine russe prénommé Vladimir ! Personnage qui n’a de russe que le nom puisqu’il a grandi aux Etats-Unis bien qu’il soit né en Russie, personnage parfaitement assimilé donc (encore une belle image de l’Amérique impérialiste)
L’image de cette marchandisation et ces accords concernant des terrains n’est pas sans nous faire penser au conflit de la guerre froide, mais le symbole est un peu lourd.
On n’oubliera pas non plus que Rachel (jeune femme juive…évidemment) a une grand-mère qui lit François le Champi mais Fabrice Pataut voudra bien m’excuser, je préfère de loin la grand-mère du narrateur proustien.
- Reconquêtes, Francois Pataut, Pierre Guillaume de Roux, 2011