Dans Vivre pour les caméras, Constance Vilanova va à l’encontre de toutes nos réticences. Oui, la téléréalité est un sujet sérieux, avec des conséquences sérieuses sur la société et qui mérite une enquête approfondie. Tout en ajoutant : s’en tenir à quelques poncifs, sur sa vulgarité ou sa vacuité, n’est pas à la hauteur de cet objet culturel plus grand que nature. En effet, il faut aller plus loin, en comprendre les rouages, mesurer les motivations des candidats… et découvrir comment notre propre rapport à la téléréalité, qu’on la regarde ou non, modèle les dérives du genre.
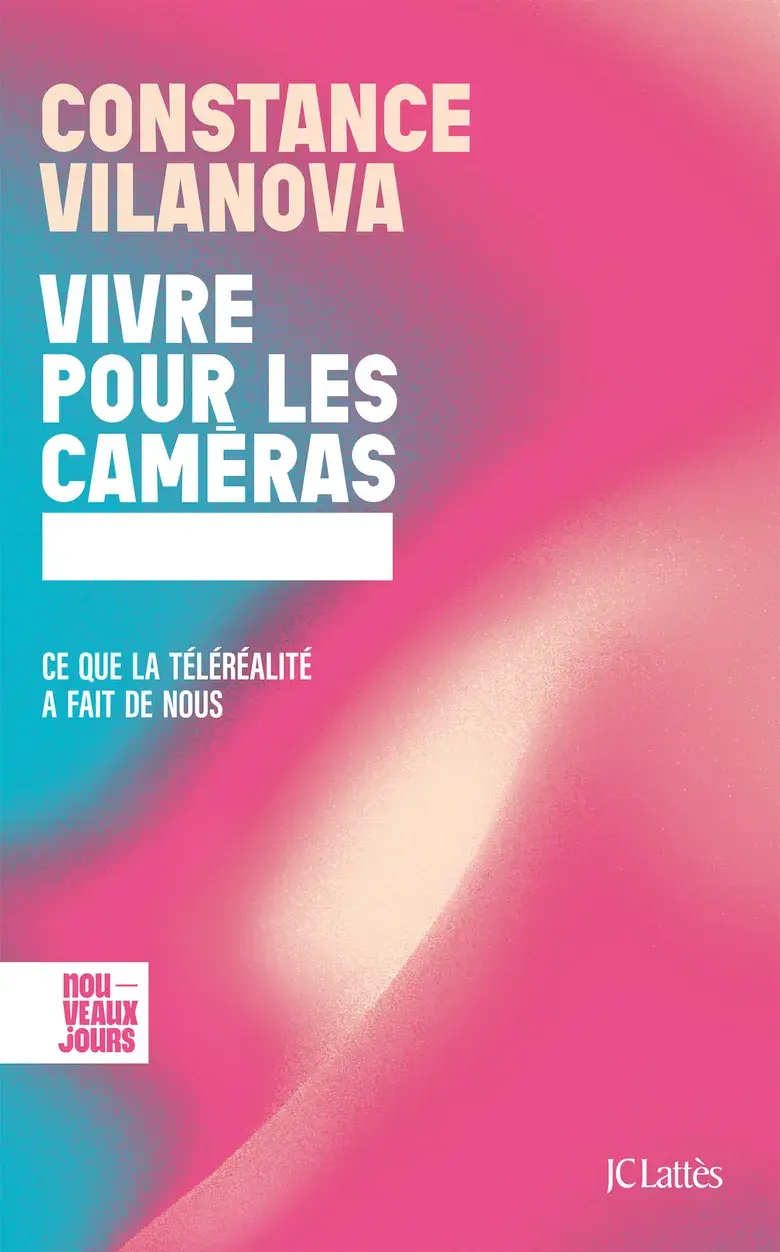
En 2015, Netflix décide de co-produire et de diffuser une émission de téléréalité japonaise, Terrace House, pour mon plus grand bonheur. Six inconnus, trois hommes et trois femmes célibataires, d’horizons et de caractères très différents, devaient apprendre à vivre en colocation, tout en continuant leurs véritables occupations à côté : mannequin, sportifs, illustrateurs… Cette émission était un contrepoint parfait à la téléréalité française qui me repoussait par sa vulgarité et sa bêtise. À l’inverse, les intrigues y étaient feutrées, les conversations calmes et argumentées, et puis les participants, qui ne délaissaient pas leur travail pour s’enfermer dans une maison, pouvaient repartir à tout moment, après quelques épisodes. Le maximum d’intimité auquel on avait accès était un baiser furtif ou des mains se tenant tendrement. Certes de la téléréalité, mais pas d’enfermement, pas de clash, pas d’activités absurdes pour occuper des participants oisifs : un voyeurisme sous contrôle. Et petit à petit, les participants sont devenus mes colocataires à moi, jusqu’en 2020, en pleine pandémie du COVID.
En effet, au mois de mai, le programme s’arrête brutalement : l’une des participantes de l’époque, Hana Kimura, catcheuse professionnelle aux cheveux roses, s’est suicidée à la suite d’une campagne de cyberharcèlement. La personnalité de la jeune femme, trop excentrique et loin des codes de la féminité japonaise, lui aurait valu un tel acharnement qu’elle n’y a pas résisté. C’est un choc immense pour les fans de l’émission. Je me retrouve, comme bien d’autres, à faire le deuil d’une colocataire que je n’ai jamais rencontrée, tout en me rendant compte que j’avais assisté, malgré moi et en détails, aux derniers mois d’une femme fragile, morte dans des circonstances tragiques. Et je réalise que le programme que je regardais sans trop de honte parce que « pas comme les autres », a recréé malgré tout un écosystème que je souhaitais éviter. Et pourquoi reste-t-il cette impression d’avoir participé, malgré moi et à toute petite échelle, à ce crime ?
Même en choisissant de ne pas la regarder ou de la mépriser, la téléréalité nous modèle, tout comme nous la modelons.
Dans Vivre pour les caméras, Constance Vilanova documente ce que j’ai vaguement pressenti sans pouvoir le formuler : même en ayant un œil critique ou ironique, même en choisissant de ne pas la regarder ou de la mépriser, la téléréalité nous modèle, tout comme nous la modelons. Dans son enquête, qui est autant introspective que journalistique, elle raconte l’histoire du genre, en se concentrant principalement sur la téléréalité d’enfermement ou de rencontre amoureuse, celle qui provoque régulièrement le débat dans l’actualité ou lors de nos apéritifs. On se rend rapidement compte qu’autour de nous, tout le monde a un avis sur la téléréalité, mais personne n’est réellement informé, et la journaliste a à cœur de remettre à plat ce qu’on pourrait prendre comme acquis.
La téléréalité, nous dit-elle, est un système qui va exploiter notre mépris de classe. Elle va choisir les personnes certes, les plus as...

















