
Khalid Zekri est professeur à l’Université de Meknès et président de l’Association culturelle Tafkir. Il a également été professeur invité aux Universités de Aachen, Leipzig et Mannheim. Sa formation de comparatiste est à la jonction de la littérature et des sciences sociales. Il revient pour Zone Critique sur le concept de “modernités arabes”, et nous entretient de l’importance de la littérature en temps de crise sanitaire. L’entretien a été réalisé par l’écrivain et chercheur Outhman Boutisane.
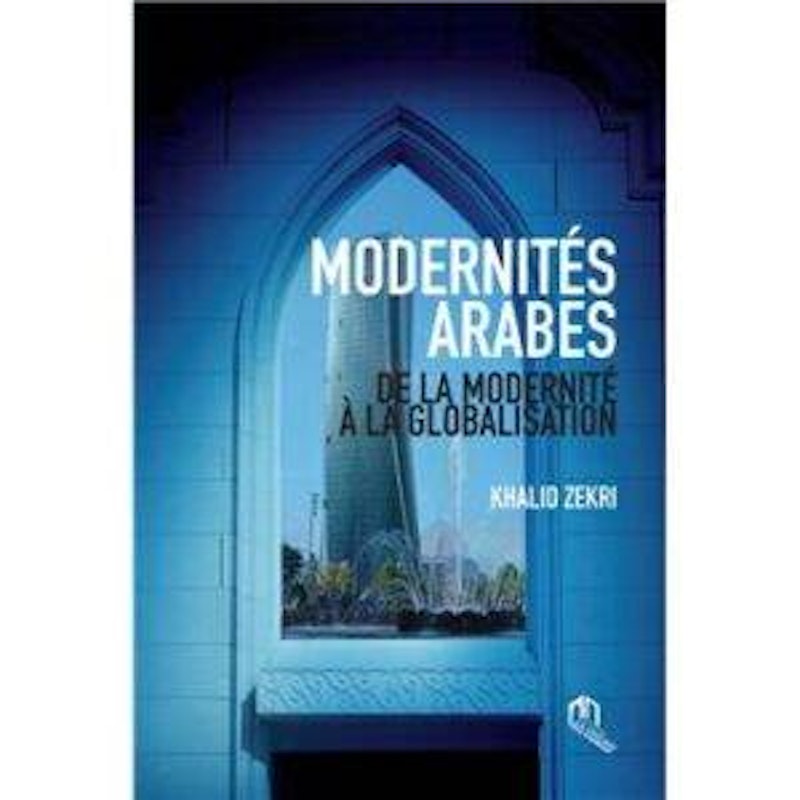
K.Z: L’idée du livre m’est venue à partir d’un constat assez visible : nous vivons dans cette vaste géographie hétérogène du monde arabe, allant de l’Orient arabe au Maghreb. Il y a par ailleurs des transformations et des ruptures par rapport à notre héritage culturel que nous n’arrivons pas à nommer car elles sont à la fois un prolongement « déformé » de notre passé et une adaptation « tronquée » de la culture moderne occidentale. Ces deux termes mis entre guillemets ne sont pas utilisés dans un sens négatif parce que le mouvement de l’histoire est fait de transformations et de ruptures inévitables.
O.B: Pourriez-vous préciser cette idée de “modernités arabes” ?
K.Z: Cette modernité est au pluriel parce qu’elle trouve ses sources dans différentes cultures, entre autres occidentale et euro-asiatique. Il suffit de changer de paradigme en évitant de penser notre réalité en fonction, d’une part, de son adéquation ou inadéquation avec notre héritage culturel (la recherche de cette adéquation avec le passé prend le nom d’authenticité chez les conservateurs ou les réactionnaires) et, d’autre part, avec la modernité occidentale qui nous a été transmise dans un contexte de conquêtes coloniales. La Turquie, sur le plan de l’imaginaire, occupe une place non négligeable dans cette modernité plurielle, notamment à travers les valeurs véhiculées par les séries télévisées et les films. J’ai désigné cette modernité aux multiples ramifications par l’expression de « modernité disjonctive » (hadatha Infikakiya) parce qu’elle est le résultat des transformations successives de notre patrimoine culturel et en même temps une adaptation (très problématique) des valeurs que la modernité occidentale a diffusées par différents mécanismes hégémoniques.
O.B: Peut-on parler encore de la modernité après l’échec du printemps arabe ?
K.Z: Une révolte n’est pas une révolution et les deux ne sont pas nécessairement en lien avec la modernité. Les révoltes et les révolutions (qui peuvent prendre différents noms selon les époques) ont toujours existé dans l’histoire de l’humanité pour différentes raisons. Le propre de l’événement révolutionnaire est de rompre avec le cours des choses en créant de nouvelles possibilités politiques. Ce qui n’est pas vraiment le cas du printemps arabe. La formule médiatico-politique « printemps arabe » ne va pas sans rappeler « le printemps des peuples » qui a embrasé l’Europe en 1848 et le très court « printemps de Prague » qui a pris fin (la même année où il s’est déclenché) avec l’intervention des forces du Pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie au mois d’août 1968. Même le nom par lequel on a désigné la volonté d’émancipation dans le monde arabe n’est que la simple reprise d’une désignation européenne. Nous sommes dépossédés de la capacité même de nommer les choses. Il s’agit là aussi d’un effet de mimétisme qui caractérise notre rapport au monde occidental.
O.B: Quelles sont les spécificités de cette modernité ?
K.Z: Les individus dans les sociétés arabes sont de plus en plus en quête de leur autonomie (notion qui peut avoir des effets pervers sur la solidarité sociale), mais ils sont souvent confrontés à la pression communautaire. Différents secteurs de la vie économique et administrative sont rationalisés, mais également traversés par des attitudes et des décisions irrationnelles. La cause est souvent liée à la priorité accordée à la préservation obsessionnelle du pouvoir entre les mains de ceux qui le détiennent. Le champ politique est ainsi soumis à des lois hétéronomes qui sont extérieures à la société elle-même. Cette modernité disjonctive se caractérise, d’une part, par l’ambivalence qui marque le lien des cultures post-coloniales arabes au monde occidental. Il y a à la fois une attirance et une répulsion à l’égard de la culture occidentale. D’autre part, cette modernité est caractérisée par un mimétisme qui nous empêche souvent de trouver les problématiques propres à nos sociétés. Nous pensons souvent par procuration dans différents domaines. Nos réformes, par exemples, sont nécessaires, mais elles restent de pâles et lointaines copies des réformes imposées par les puissances occidentales.
O.B: Comment expliquez-vous la crise de la culture dans le monde arabe aujourd’hui ?
K.Z: Ce n’est pas facile de répondre à cette question en quelques phrases. La génération de Abdallah Laroui, Mohamed Abd Al-Jabri, Hicham Djaït et Adonis (entre autres intellectuels) a donné des éléments de réponse à cette question, mais aujourd’hui les réponses sont à chercher à l’échelle globale. Nous ne pouvons plus faire uniquement des histoires locales sans connexion avec l’histoire globale. Les réformes (par ailleurs mal menées) que nos gouvernants nous imposent pour que nos sociétés « évoluent » et se « modernisent » sont liées aux prêts consentis par les banques et les organisations financières mondiales. Le désir de préserver le pouvoir à tout prix empêche les régimes politiques arabes de constituer un véritable espace public susceptible de faire émerger un débat libre et contradictoire. A cela s’ajoute le fait qu’on n’accorde ni une liberté de réflexion et d’action ni un budget suffisant à la recherche scientifique et à l’enseignement. La fonction mobilisatrice de l’espace public (au sens politique du terme) est constamment sinon combattue, du moins contrariée par l’Etat dans les sociétés arabes. On compare souvent le semblant de liberté qui existe aujourd’hui avec la répression massive qui régnait entre les années 60 et 80. La chute des régimes communistes a introduit un changement dans cette situation et les gens ont commencé à s’exprimer plus qu’avant. Cela leur a donné l’illusion que des temps libres allaient s’ouvrir devant eux. En fait la fin de la guerre froide était aussi synonyme de la fin de la protection dont bénéficiaient les dictateurs qui étaient au service d’un bloc ou de l’autre. L’autoritarisme étatique dans la gestion des sociétés arabes a eu des conséquences désastreuses sur la culture et l’économie.
O.B: L’écriture est-elle pour vous un domaine de recherche où vous exercez votre métier, ou un refuge symbolique dans lequel vous exercez votre liberté de penser?
K.Z: Pour moi, l’écriture n’est pas un refuge et ne saurait l’être. Dans le cas de l’essai ou des travaux académiques, l’écriture est un lieu de réflexion et d’analyse qui nous permet d’avancer un peu dans la compréhension de notre monde ambiant et de faire des propositions aux lecteurs potentiels. Il est évident que c’est une chance d’exercer un métier qui nous permet de consacrer une partie de notre temps à l’écriture et la réflexion. C’est vrai que l’écriture donne également un sentiment de liberté qui reste toujours relative. Prendre l’écriture comme simple lieu de refuge est une manière de se dédouaner du devoir de résistance contre les injustices sociales et les abus de pouvoir.
O.B: Croyez-vous au pouvoir de l’écriture?
Mais dans les sociétés où la population est majoritairement analphabète (ou illettrée, au sens sociolinguistique du terme), le pouvoir de l’écriture ne disparaît pas, mais il reste peu efficace. C’est le pouvoir de la parole qui, le plus souvent, prend une plus grande place.
K.Z: Ce pouvoir peut, en effet, exister dans des sociétés où la lecture est un acte social, donc accessible à un grand nombre. Elle peut même concurrencer le pouvoir des dominants, surtout quand elle échappe à leur emprise. Mais dans les sociétés où la population est majoritairement analphabète (ou illettrée, au sens sociolinguistique du terme), le pouvoir de l’écriture ne disparaît pas, mais il reste peu efficace. C’est le pouvoir de la parole qui, le plus souvent, prend une plus grande place.
O.B: Quel rapport entretenez-vous avec la littérature?
K.Z: Un rapport de lecteur, d’enseignant et de chercheur universitaire. Mais il faut bien dire que les lectures que j’ai faites de manière spontanée et « naïve », sans obligation professionnelle, m’ont beaucoup marqué. C’est une expérience strictement émotionnelle.
O.B: Qu’est-ce qu’un texte littéraire pour vous ?
K.Z: C’est une autre question à laquelle il n’est pas facile de répondre puisqu’on risque de tomber dans une définition normative ; ce qui est le contraire même d’un texte littéraire. Mais je peux avancer prudemment que dans un texte littéraire, il y a un certain sens de la composition, une construction vivante et crédible des personnages, le sens de la langue en tant que lieu de création et la capacité de créer une atmosphère singulière. Un texte littéraire ne se réduit pas à un simple mimétisme ou reproduction de formules toutes faites… Il ne se réduit pas non plus à une pure structure formelle et stylistique. Il véhicule des valeurs, des émotions, une multiplicité d’expériences et de formes de vie.
O.B: En ces temps de confinement pour lutter contre le Covid-19, comment la littérature peut-elle traduire la crise sanitaire?
K.Z: Il y a déjà des films qui ont été fait ou qui sont en train d’être faits sur cette pandémie. « Netflix » diffuse en ce moment une série télévisée sur ce sujet. Les écrivains s’y sont mis, dans l’urgence, en publiant des textes dans la presse. Ce n’est pas nouveau. Il y a une vaste littérature mondiale sur les épidémies et les pandémies virales qui ont traversé l’histoire de l’humanité. Alessandro Manzoni, Bram Stoker, Edgar Poe, Mary Shelley, Jack London, Albert Camus, José Saramago, Dean Koontz, Drago Jancar sont des auteurs qui ont écrit sur ces fléaux. Il y a à peu près quatre ans, l’écrivain sud-africain Deon Meyer a écrit un roman prémonitoire sur le Coronavirus dont la traduction française a été publiée aux éditions du Seuil sous le titre L’Année du Lion. Les auteurs dont j’ai parlé évoquent, dans leurs textes, la condition humaine durant les crises épidémiques. Cette littérature est un vrai laboratoire pour sonder la fragilité, l’imprévisibilité et les conséquences qui résultent de l’angoisse de l’homme durant une crise sanitaire.
O.B: En tant qu’un intellectuel, comment passez-vous votre confinement ?
K.Z: Je comprends bien que ce confinement soit contraignant et même néfaste pour certaines personnes, notamment les plus précarisées. En ce qui me concerne, le confinement m’a permis de m’éloigner de l’agitation et de travailler dans des conditions sereines. Mes enfants étant maintenant de jeunes adules autonomes, je suis moins impliqué dans certaines obligations quotidiennes les concernant. Je passe donc mon temps entre la lecture, l’écriture, la musique, les films et des discussions parfois banales (il nous faut une dose de banalité dans la vie) et parfois passionnantes. J’ai également remarqué que dans mon confinement j’avais perdu un peu la notion de temps ; comme tout le monde, je suppose.
O.B: Un mot pour le lecteur ?
K.Z: Cher lecteur, les livres et la vie ne s’opposent pas. Ils se complètent. Regardons vers le passé non pas pour lui-même, mais pour mieux vivre notre présent et nous projeter vers l’avenir qui est encore plus important.
Bibliographie
- Incipit et clausules dans les romans de Rachid Mimouni (2004)
- Fictions du réel (2006)
- Repenser le Maghreb et l’Europe (2010)
- Lire les villes marocaines (2011)
- Études postcoloniales : théories, art, littérature (2011)
- Récits du corps au Maroc et au Japon (2013)
- Littératures du Maghreb et d’Afrique subsaharienne (2016)
- Modernités arabes. De la modernité à la globalisation, 2018 (Prix du Livre du Maroc en Sciences sociales 2019)
- Hybridations et tensions narratives au Maghreb et en Afrique subsaharienne (2020).
Entretien réalisé par Outhman Boutisane (écrivain et chercheur)

















