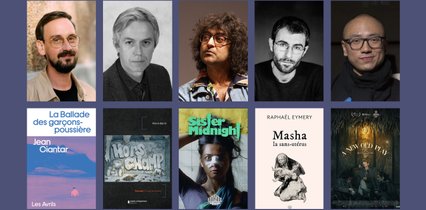Le personnage du marginal habite la littérature américaine du XXe et du XXIe siècle. Comment définir cette figure ? Quelles relations entretient-elle avec les valeurs de la société américaine ? En quoi la marginalité peut-elle se définir comme une forme d’aventure ? Trois auteurs peuvent nous aider à penser ces questions : John Fante, Charles Bukowski, Mark Safranko.
Dans le Los Angeles des années 30, Arturo Bandini, un jeune immigré italien gouailleur et sans le sou, rêve de devenir écrivain dans sa chambre miteuse de l’Alta Loma, un hôtel crasseux de la colline de Bunker Hill. Fou des femmes et de littérature, il erre dans la ville, souvent seul, tombe amoureux d’une serveuse, Camilla, et mange des oranges du matin au soir parce qu’il n’a pas d’argent. Trente-trois ans après la parution de Demande à la poussière de John Fante, Charles Bukowski publie ses Contes de la folie ordinaire : dans ces nouvelles, des ivrognes errent sans but de bars crasseux en journaux underground, à la recherche de sexe et d’alcool. En 2005, enfin, paraît aux Etats-Unis Hating Olivia, Putain d’Olivia en français, qui narre la passion destructrice entre Olivia et Max Zajack, looser magnifique qui rêve lui aussi de gloire littéraire, quand il n’est pas astrologue, manœuvre en usine, musicien ou journaliste.
Qu’ont en commun ces trois romans ? Des personnages, d’abord : anti-héros instables à l’estime personnelle vacillante, loups des steppes modernes qui clament haut et fort leur anticonformisme, écrivains désargentés qui rêvent d’être un jour reconnus par la société, Arturo Bandini et Max Zajack sont comme deux frères siamois que relie un même goût pour la vie aventureuse, la recherche d’intensité, l’errance, la marginalité, la solitude.
Mais là ne s’arrête pas la comparaison : une étrange filiation rassemble ces trois auteurs américains que l’on a associé au mouvement du « dirty realism », ce courant littéraire des années 1970 et 1980, qui décrit l’existence ordinaire des dépossédés, de l’autre Amérique, des marginaux et des caravanes, avec une écriture minimaliste. Pour Max Zajack, en effet, John Fante et Charles Bukowski sont comme des pères en écriture(Notons d’ailleurs que c’est Dan Fante, le fils de John, lui aussi écrivain, qui a écrit la préface à l’édition française de Putain d’Olivia). Charles Bukowski, quant à lui, raconte dans un texte qui sert de préface à la traduction française de Demande à la poussière, sa « rencontre » avec les romans de John Fante : jeune homme, déjà un peu ivrogne et affamé de lecture, « Buko » passait ses journées à lire dans la bibliothèque municipale de Los Angeles. Mais tous les livres qui lui tombaient dans les mains l’ennuyaient à mourir, hormis quelques philosophes allemands et écrivains russes d’avant la Révolution. Et puis, un jour, le futur écrivain sortit un livre, au hasard d’un rayon, « et c’était ça » : Ask the dust de John Fante, un livre « qui avait changé l’écriture et allait toute sa vie l’influencer dans son travail.
« Pourquoi est-ce que personne ne criait ? »
Qu’est-ce qui a donc tant marqué Charles Bukowski à sa première lecture de Demande à la poussière ? L’écriture, d’abord : chez John Fante, en effet, « chaque ligne (a) sa propre énergie et (est) suivie d’une semblable et la vraie substance de chaque ligne (donne) sa forme à la page, une sensation de quelque chose sculpté dans le texte. ». Son traducteur français, Brice Matthieussent, parle quant à lui d’un phrasé « nerveux, rapide, direct » : les phrases sont courtes, le vocabulaire est simple et familier, les « adjectifs excessifs » sont prohibés. Le récit, écrit au présent, avance à grandes enjambées ; les sensations, les émotions d’Arturo se succèdent sans ordre, naissent et disparaissent sans prévenir, au rythme de ses marches dans les rues de Los Angeles. L’écriture est comme un magma bouillonnant où se mêlent les désirs et les impressions fugitives d’un jeune homme en colère ; les propositions coordonnées se succèdent à vive allure, traduisant le flux désordonné des énoncés qui traversent Arturo, mimant le rythme haletant d’un homme qui monologue de manière ininterrompue : « Je croise le portier du Biltmore et aussitôt c’est la haine, immédiatement, lui avec ses passements jaunes et son mètre quatre-vingts et toute cette dignité à la manque ; et voilà qu’une automobile noire s’approche du trottoir et qu’un homme en descend. L’air riche, le type. Et puis une femme descend à sa suite, et elle est belle, du renard argenté comme fourrure, une vraie chanson qui passe là sur le trottoir et disparaît à travers la porte battante et c’est là que je me dis oh boy, dis donc, si seulement tu pouvais t’offrir ça, rien qu’un tout petit peu, rien qu’une journée et une nuit. Un rêve qu’elle était, un rêve que je faisais en marchant, et son parfum était encore dans l’air humide du matin. ». Le récit commence à peine, le lecteur n’a pas eu le temps de reprendre son haleine, que le voilà déjà plongé dans l’intériorité volcanique de Bandini, déambulant le long d’Olive Street, fuyant les notes d’hôtel impayées qui s’entassent dans sa chambre ; les objets visuels, le portier, la femme, l’automobile, défilent sans ordre, comme autant de petites touches impressionnistes, d’images en mouvement, qui restituent l’atmosphère du Los Angeles des années 30, où le luxe coudoie la misère.
L’écriture est donc d’abord un moule dont la vocation est de dire avec le plus de simplicité possible l’expérience humaine, de se rapprocher au plus près de ce que John Fante nomme lui-même « la moëlle de la vie ». Le style n’est pas tant une question d’ordre esthétique, qu’une question d’ordre existentielle : l’écriture doit donner à voir, par son rythme et sa syntaxe propre, quelque chose de l’intériorité des personnages. Si dans Demande à la Poussière, chaque phrase a sa propre énergie, c’est que l’énergie même du personnage d’Arturo Bandini, cette« énergie folle, (cette) énergie du désespoir qui se transforme parfois en ironie cynique » (Brice Matthieussent) infuse chaque ligne de ce roman : chaque phrase, en effet, sculpte le portrait intérieur d’un jeune garçon ivre d’ambitions mais dévoré par sa peur des femmes, torturé par ses désirs et sa haine de lui-même, et repoussé aux marges d’une société qu’il rêve ardemment de conquérir. Toute l’énergie fantasque et extravagante de Bandini est comme restituée par le langage oralisé, le lexique populaire, et le rythme rapide des phrases. En ouvrant Demande à la poussière, le lecteur a le sentiment intime de le voir apparaître devant lui, en chair et en os, lui parler au comptoir du Columbia, ou dans les rues bondées de Spring Street, avec sa gouaille inimitable.
L’énergie du style, cette écriture qui donne forme à la « moëlle de la vie », s’oppose ici, chez nos trois auteurs, à l’académisme littéraire : pour Max Zajack, en effet, « le pire destin serait de finir en Joyce Carol Oates confortablement installée dans une tour d’ivoire peinarde, à gribouiller page sur page de mots desséchés, privés de tout lien avec quoique ce soit d’organique, de vivant ». Charles Bukowski fait le même constat, dans sa préface à Demande à la poussière : « (…) rien de ce que je ne lisais n’avait de rapport avec moi ou avec les rues ou les gens autour de moi. C’était comme si tout le monde jouait aux charades et que ceux qui n’avaient rien à dire fussent reconnus comme de grands écrivains (…) Pourquoi est-ce que personne ne disait rien ? Pourquoi est-ce que personne ne criait ? ». L’écriture de John Fante, de Charles Bukowski et à leur suite de Mark Safranko est donc une écriture qui naît d’un refus : celui d’une littérature académique, sophistiquée, voire précieuse, coupée de l’existence réelle, mais légitimée par l’institution. À cette littérature s’opposerait donc une écriture qui donnerait à voir la réalité des médiocres et des marginaux, une écriture qui entendrait restituer la substance même de l’expérience humaine. Or, cette perspective littéraire ne serait possible, selon nos trois auteurs, qu’à partir du moment où l’écrivain lui-même se place en dehors du système, dans une position de marginalité.
Le romantisme de la vie d’artiste
Arturo Bandini, Max Zajack et les personnages des Contes de la folie ordinaire de Charles Bukowski exhibent une posture d’opposition radicale à l’égard d’une société jugée conventionnelle et aliénante. À cette aliénation s’oppose la liberté romantique de l’écrivain, qui refuse de se plier aux règles d’un jeu qu’il dénonce par son comportement déviant : son alcoolisme, ses frasques sexuelles, ses extravagances. John Fante comme Mark Safranko mettent ainsi en scène des anti-héros en quête d’une liberté authentique que les contraintes de la vie professionnelle ne peuvent pas leur apporter.
C’est ainsi avec le sourire qu’Arturo Bandini, dans les premières pages de La route de Los Angeles, quitte successivement ses emplois de terrassier, de plongeur, de débardeur de camion. Le sentiment de liberté est là, palpable, dans cette décision soudaine de tout quitter, et de laisser derrière soi un patron de restaurant « planté là à se gratter la tête au milieu des ordures et des assiettes sales ». Le ciel est bleu, les oiseaux chantent, et soudainement Max Zajack décide de quitter la firme pour laquelle il travaillait jusqu’alors. L’aventure et la liberté n’attendent pas, elles sont d’ailleurs l’apanage des grands écrivains, ces héros de la marginalité, qui ont toujours su préférer leur propre liberté au confort standardisé d’une vie salariée : « je songeais à des personnes remarquables qui avaient quitté leur boulot régulier sur un coup de tête en se jurant de vivre une vie nouvelle – Sherwood Anderson qui avait plaqué l’usine, le cercle, la Chambre de commerce, sa femme et ses gosses (…), Henry Miller qui après s’être mis avec sa deuxième femme, avait dit à ses supérieurs de chez Western Union de se le mettre là où je pense (…) ».
On peut trouver cette opposition entre la société et l’écrivain, le travail et la liberté, schématique et adolescente ; il est vrai également que l’univers entrepreneurial est décrit de façon caricaturale et ridicule chez Mark Safranko, notamment lorsque celui-ci compare son personnage, coincé dans le bureau exigu d’une grande entreprise, à un anarchiste poseur de bombes : « Je devins hargneux. Tout ce que je disais dans le petit bureau était destiné à faire chier ou à provoquer (…) Je me rangeais résolument du côté des terroristes qui posaient des bombes dans les locaux des grosses firmes ». Les travailleurs sont ainsi décrits, dans cet extrait, comme des moutons qui se rendent à l’abattoir du Grand Capital, pour reprendre la métaphore de Mark Safranko, que l’on peut à raison juger grossière et convenue.
Néanmoins, à y regarder de plus près, le rapport à la société d’Arturo Bandini et de Max Zajack est plus ambivalent qu’il n’y paraît. D’un côté, il ne faut pas pactiser avec elle, car elle incarne l’antithèse des valeurs que l’écrivain représente. Mais d’un autre côté, Arturo Bandini comme Max Zajack ne cessent de rêver de gloire et de conquête sociale. L’unique ambition d’Arturo Bandini est de devenir un jour un grand écrivain, de pouvoir être regardé comme tel par ceux qui méprisent cette pauvreté qu’il hérite de sa famille, cette pauvreté d’immigré italien dont il a honte et qu’il veut fuir : « Parce que c’est bien ça ce que tu penses, n’est-ce pas, que tu es né pauvre, fils de paysans misérables, en cavale pour fuir cette pauvreté, fuir ta ville natale dans le Colorado parce que tu ne voulais plus être pauvre, et c’est pour cette raison que tu écumes les bas-fonds de Los Angeles, parce que tu es pauvre et que tu espères qu’en écrivant un livre tu deviendras riche. »
La haine d’Arturo Bandini pour les riches, pour les WASP (White Anglo-Saxon Protestant) qui vivent dans leurs luxueuses résidences, sa colère contre la société vient d’abord de ce que celle-ci le rejette, le laisse vivoter dans sa chambre miteuse, n’a pas encore reconnu son génie. C’est une colère sauvage et anarchiste, qui naît d’un désir frustré, et qui explose de manière chaotique et imprévisible sur tous les objets qu’il rencontre (les femmes, les « métèques », les riches, les pauvres, les immigrés, etc…) jusqu’à se retourner in fine contre lui : « C’est pour ça que tu écris, et c’est pour ça qu’il serait nettement préférable que tu crèves. ». La révolte d’Arturo est donc d’abord une révolte contre sa propre condition : c’est la révolte d’un jeune homme dans laquelle se mêle confusément le refus d’une vie conformiste, et le désir de richesse et de revanche sociale : « (…) mais j’ai vu des maisons à Bel-Air avec des pelouses qui vous rafraîchissent rien que de les regarder, et des pisc...