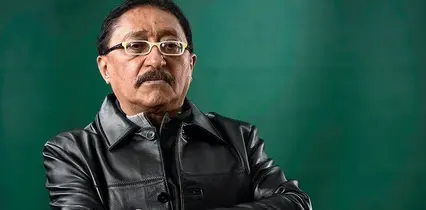Les philosophes médiévaux, de langue arabe ou latine, partageaient une même obsession, celle de la pensée et de sa définition. À la suite d’Aristote et d’Alexandre d’Aphrodise, Avicenne, Al-Ghazali, Ibn Bajja, Ibn Tufayl, Averroès, puis Albert Le Grand, saint Bonaventure ou encore Thomas d’Aquin ont tous brûlé de livrer enfin les secrets de la faculté humaine par excellence, d’en approcher le mystère. Or, la modernité européenne ignore largement leurs interrogations et leur héritage intellectuel. Mais, selon Jean-Baptiste Brenet, ce qui a été « gelé par l’oubli » possède l’avantage de pouvoir à nouveau être neuf. En effet, les thèses portées par ces auteurs sont déroutantes, et donc intéressantes, pour qui n’y est pas habitué. Ainsi, le philosophe, professeur à l’université Paris I-Sorbonne et spécialiste de la pensée arabe médiévale, défend cet héritage dans son livre Que veut dire penser ? Arabes et latins , paru le 9 mars 2022 aux éditions Payot & Rivages.
Un parcours sensible
Il tisse des liens entre différents termes arabes et latins, en fait apparaître les similitudes mais également les dissemblances. Il élabore ainsi son livre comme un parcours lexical et poétique, plutôt que comme un exposé didactique.
Que veut donc dire « penser » ? Si cette question a tourmenté de nombreux esprits, la réponse ne peut être évidente. En effet, la pensée est plurielle, équivoque. Nous employons le verbe « penser », qui est devenu central dans nos vocabulaires alors que le vocable latin « pensare » était peu usité, pour désigner différents types d’activités psychiques. Comme l’écrit Aristote de l’intellect, la pensée est une main, un instrument servant à manipuler d’autres instruments. Comment donc cerner la pensée ? Jean-Baptiste Brenet décide de procéder par rapprochements. Il tisse des liens entre différents termes arabes et latins, en fait apparaître les similitudes mais également les dissemblances. Il élabore ainsi son livre comme un parcours lexical et poétique, plutôt que comme un exposé didactique. Son cheminement, qui n’évite pas les détours, permet de figurer la pensée dans sa complexité et sa multiplicité. Par une écriture imaginative – qui rend la lecture agréable – il donne ainsi à penser la pensée. Il la rapproche par exemple d’autres facultés, telles que le goût ou le toucher. Il propose, comme dans le chapitre « Penser comme on voit dans la nuit », de l’appréhender à partir d’expériences limites, presque animales, qui en révèlent les traits saillants. Il la compare également à des attributs corporels – un visage, une bouche, une langue. Sous sa plume, au fil des images, la pensée acquiert donc une dimension corporelle, charnelle.
Il ne s’agit pas seulement pour le philosophe de figurer la pensée à travers des images et métaphores, mais également de montrer qu’elle est profondément liée à l’expérience que nous faisons du monde. Ainsi, les comparaisons sensibles et animales n’ont pas pour seule vocation d’être poétiques. Elles nous révèlent en effet des aspects fondamentaux de notre activité psychique. Par la pensée, nous relions les choses matérielles que nous voyons, sentons, touchons, appréhendons, à des concepts. Mais ces choses ne sont pas abolies dans le concept ; elles restent en nous sous la forme d’images (phantasmata en latin). La pensée humaine, bien qu’immatérielle, conserve donc toujours son lien avec le réel sensible. Elle naît et se déploie à partir de notre rencontre avec le monde : « Nous avons pensé tandis que nous sentions parce que nécessairement, nous pensons d’abord ce que tout corps, n’importe quel corps, en tant que nous y sommes sensibles, offre de commun à tout étant. La pensée ne fut pas une chance, une trouvaille, elle s’est présentée dans la rencontre même des choses au bout de nos doigts. »
Qui pense en nous ?
La pensée humaine devient ainsi le lieu de la réception d’une intelligence qui nous transcende, d’une intelligence céleste ou divine, l’occasion d’une communion avec l’éternité et l’intelligible pur.
Penser n’est pas pour autant sentir. En effet, le penseur dégage une certaine signification du réel (maʿnâ en arabe ou intentio en latin). Il l’estime, l’associe à des concepts universels (comme le tout ou la partie), appelés les « intelligibles » dans la pensée médiévale. Ces intelligibles sont communs à tous, transversaux. Il permettent de saisir l’essence des choses sensibles, ce qu’elles sont réellement, par-delà leur apparence singulière. La pensée nous donne ainsi accès à l’universalité. C’est cette universalité qui nous permet d’ailleurs de partager nos pensées : « La pensée commence par le commun qui se communique. » Pour Averroès, la pensée est d’ailleurs une réalité éternelle, unique pour tous les membres de l’espèce humaine. En effet, elle émane d’une réalité supérieure, un Intellect divin, qu’il nomme l’Intellect agent. La pensée humaine devient ainsi le lieu de la réception d’une intelligence qui nous transcende, d’une intelligence céleste ou divine, l’occasion d’une communion avec l’éternité et l’intelligible pur.
En pensant, nous restons pourtant des êtres de chair ; nous ne devenons pas nous-mêmes intelligibles ou éternels. Il faut plutôt, avec les philosophes arabes, considérer la pensée comme l’endroit d’une rencontre entre le matériel et l’immatériel, l’éternel et le précaire. La jonction est ainsi une notion centrale dans la philosophie arabe médiévale. La pensée nous relie à ce qui nous dépasse, mais également aux autres, puisque son unicité la rend partageable. C’est cette notion de jonction qui semble disparaître avec la modernité, qui considère uniquement la pensée comme un phénomène interne au sujet, une activité purement intérieure. Or, pour les philosophes médiévaux, la pensée ne nous appartient pas. Au contraire, nous sommes possédés par elle. Mais, il ne s’agit pas d’une possession négative ou dégradante. C’est en tant que nous sommes possédés par la pensée que nous pouvons nous joindre (ittasala en arabe) à l’univers : « Il faut quitter une vision de la pensée qui réduit son centre d’opérations aux dimensions d’un corps. On l’a vu, on l’a dit. La pensée n’est pas l’affaire exclusive d’un individu, d’une tête, d’un cerveau, ce n’est pas un phénomène – tempête ou tâche d’huile – sous un crâne. Toute pensée s’inscrit dans un cadre large, celui du cosmos entier. » Certains penseurs européens, comme Ernest Renan au XIXème siècle, reprochent d’ailleurs à la philosophie arabe médiévale un manque de considération pour l’individualité. Il s’agirait d’une philosophie de Dieu, du Tout, du Cosmos, qui laisserait de côté les singularités. Pourtant, chez Averroès, si la pensée est unique, les chemins pour l’atteindre sont multiples. Ainsi, la pensée circule, d’individu en individu, de peuple en peuple, voyage : « Le penseur n’est pas un pôle, si le pôle est fixe, il n’est pas la suture d’une plaie, il est une synapse, il est une méditerranée ».
Cette conception de la pensée n’est plus valorisée aujourd’hui. Pourtant, elle continue d’imprégner certains imaginaires. Jean-Baptiste Brenet cite divers auteurs modernes, comme Teilhard de Chardin, Pasolini ou Marguerite Duras, qui sont, peut être inconsciemment, les héritiers des médiévaux. Proust écrit par exemple dans À l’ombre des jeunes filles en fleur : « Car mon intelligence devait être une, et peut être même n’en existe-t-il qu’une seule dont tout le monde est co-locataire, une intelligence sur laquelle chacun, du fond de son corps particulier, porte ses regards, comme au théâtre, où si chacun a sa place, en revanche, il n’y a qu’une seule scène ». Cette intuition sans passeur, qui se transmet presque à l’insu de ceux qui la reçoivent, est peut-être la preuve la plus éclatante, que, effectivement, quelque chose ou quelqu’un pense en nous.