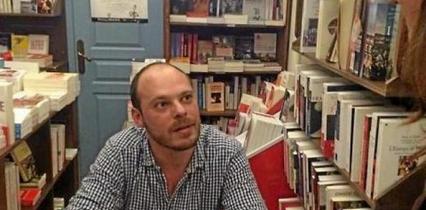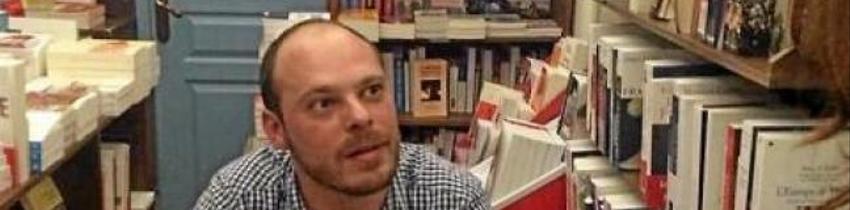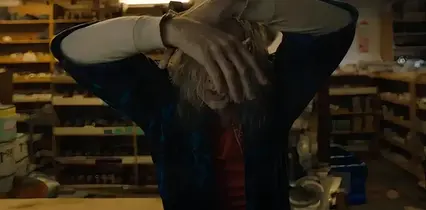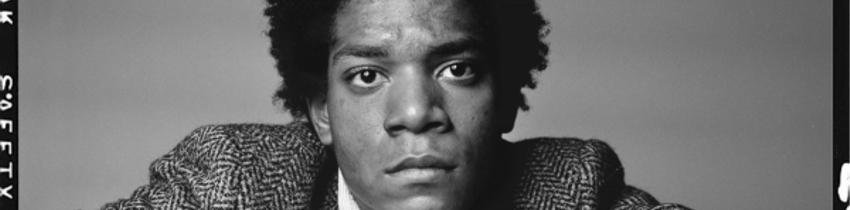Léo Dekowski égraine les fragments d’une journée de vingt-quatre heures dans un premier recueil de poésie extravagant. Poésie facile, qui présente une conscience du monde dans sa plus grande nudité (le poète prépare en ce moment une thèse dirigée par Jean-François Puff intitulée « L’idée de facilité dans la poésie française du XXe siècle »), La Journée du moelleux est pourtant le lieu d’une grande inventivité formelle.

Au départ était le mot : « ouverture des yeux / me manque le moelleux ». La journée du jeune poète commence sous le signe du manque. Empruntant le terme à Dominique Fourcade, le « moelleux » est un « mot-pivot » ou un « angle » qui déclenchera une série d’opérations poétiques, un motif qui fera l’objet de répétitions et de variations, à l’image d’un thème musical. Le terme n’a pourtant rien d’arbitraire : dès l’épigraphe le poète annonce qu’il s’agit de son « mot préféré », imitant en reprenant la fameuse question que Bernard Pivot posait à ses invités dans Le bouillon de culture. De Fourcade à Pivot, la ligne est claire : le poète mêlera l’exigence poétique à la culture populaire, la NBA à Matisse, Haribo à Mallarmé. C’est donc le mot qui donnera au monde sa forme, qui comblera un manque et en épuisera tous recoins, jusqu’à l’infraordinaire : « au moelleux vécu je veux relier le moindre de tes sens par l’extraction de poèmes ».
“La Journée du moelleux […] prouve qu’on peut faire sérieusement de la poésie sans esprit de sérieux.”
D’où vient la manie du moelleux ? De la perte d’un certain rapport au monde propre à l’enfance. Le poète l’annonce dès le matin : « bébé boit aux mamelles de maman et sommeille en landau […] / hommes ni femmes jamais plus ne vivront dans milieu si moelleux ». S’il est simple, trivial, s’il traduit une relation première au monde, c’est parce que le moelleux est à la fois le symbole d’un sentiment d’empêchement face à l’existence et l’outil même qui permet de le dépasser : « c’est sans doute ça qui me fait peur dans la philosophie la perte de / la naïveté originelle je sais nietzsche a mis l’enfant / au terme du processus métamorphique vers la surhumanité j’aime bien nietzsche ». Pas de tentative de retour vers l’origine, ou de hantise devant cet état inatteignable. Si c’était le cas, la parole se teinterait d’hermétisme, et c’est précisément ce que le poète tente d’éviter : « il faut quitter le moelleux-mère / et entrer dans le moelleux vers ».
À la doxa structuraliste (déjà veillotte pour beaucoup), aux vieux penseurs qui martèlent la marotte de la notion d’arbitraire entre le signifiant et le signifié, Dekowski préfère le cratylisme d’Édouard Kreitman ou le compromis mallarméen : « la poésie est là pour rémunérer le défaut des langues / chamallarmeow ». Derr...