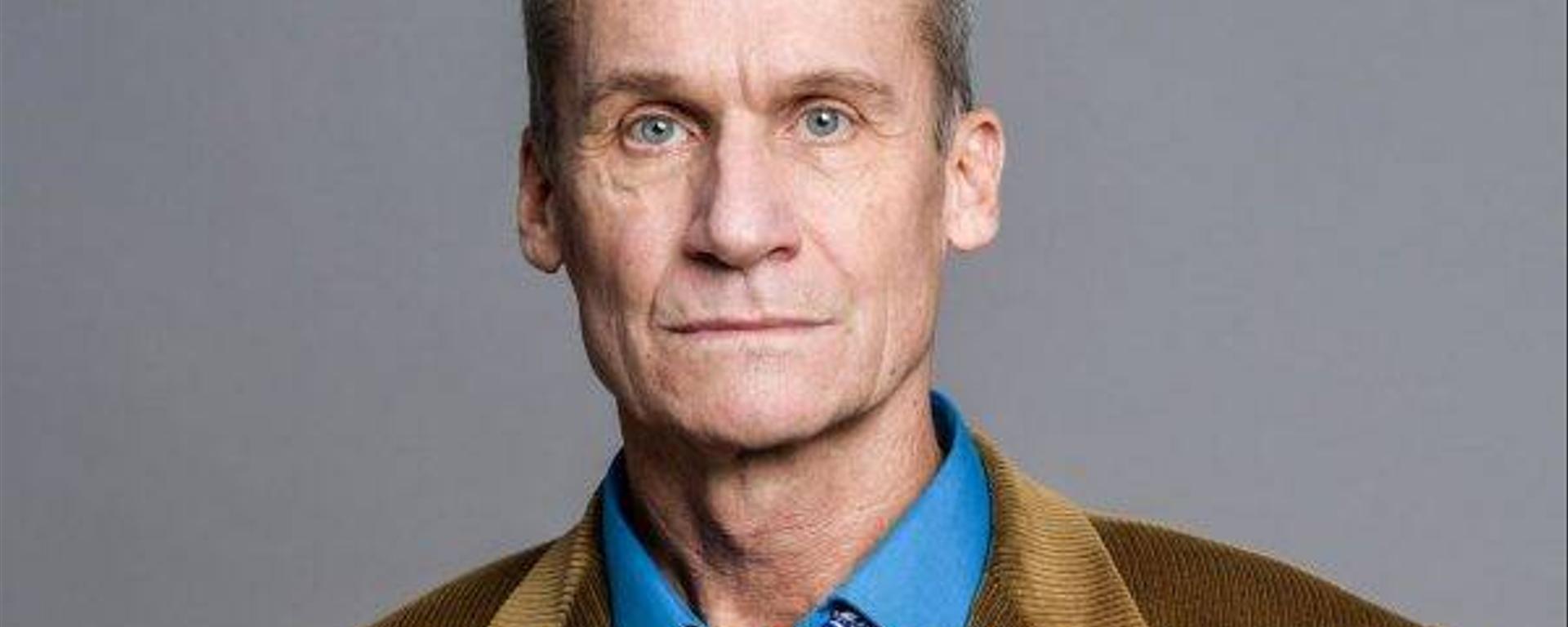Dans son dernier roman, L’ami arménien, paru aux Éditions Grasset, Andreï Makine réveille le souvenir d’une amitié aussi fugace qu’essentielle. Maniant une langue précise, un brin désuète, presque hussarde, ce court récit retrace cinq semaines d’une adolescence dont le temps se serait mystérieusement dilaté. Une sobre souvenance, malheureusement galvaudée dans les dernières pages, où les commentaires convenus d’un académicien alourdissent les enseignements de l’ami et de l’apologue.
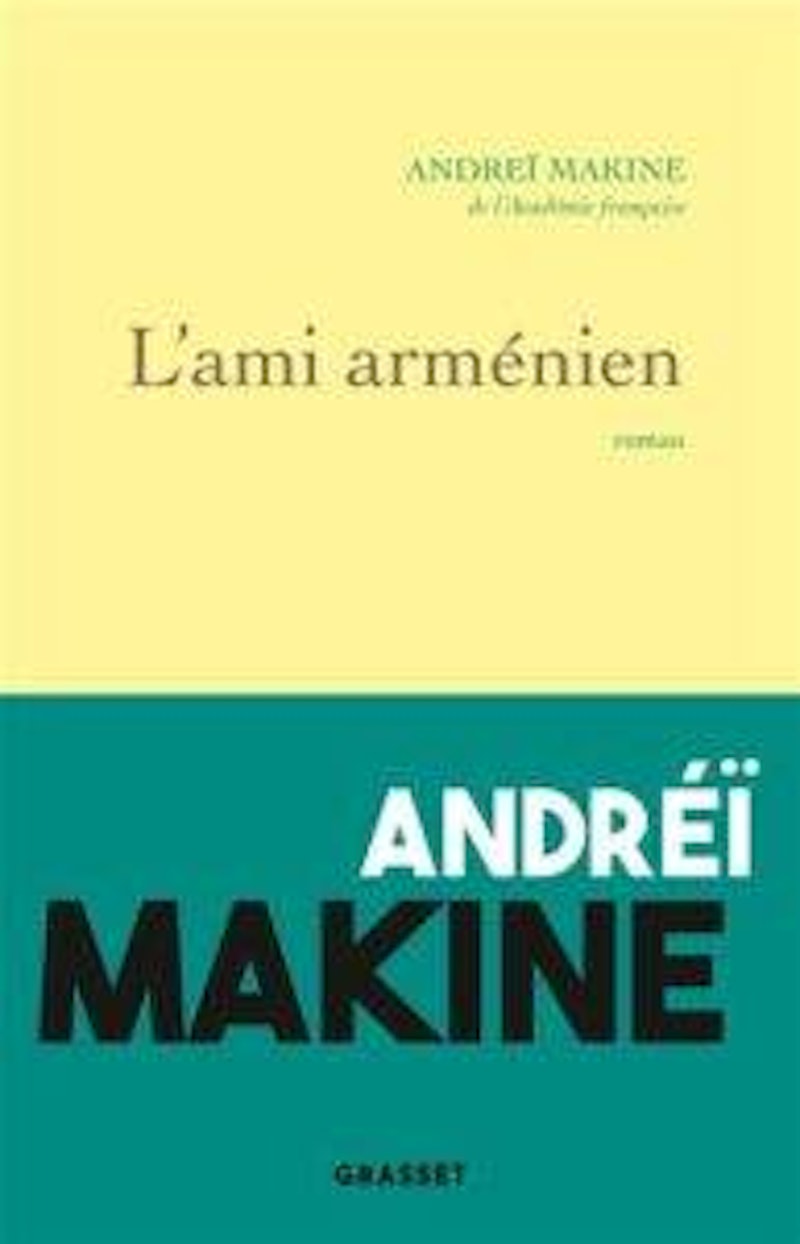
Rapidement intrigué par la « langue extraordinairement sonore », la mélancolie et le peu avec lequel ces exilés parviennent à créer un petit « royaume d’Arménie », le jeune orphelin découvre à l’école de son ami un nouvel usage du monde. Regarder avec « ses grands yeux foncés qui reflétaient un univers où (les garçons de l’école) n’existaient pas, où leur agressivité de jeunes mâles en compétition perdait tout son prestige guerrier ». Sentir que « le ciel commence à partir d’ici, et même plus bas, tout près de la terre – en fait sous nos semelles ! » Se découvrir « capable d’être un dieu pour notre prochain » en écartant de lui un danger. Les deux compères détournent ainsi un couple d’amoureux d’une dangereuse rencontre en les effrayant par leurs cris sauvages ; à l’aube d’un siècle sanglant, aucune voix divine ne s’était levée au secours des Arméniens.
« Qui parle beaucoup apprend peu »
École de contemplation et d’intériorité, le silence semble avoir donné au narrateur de Makine la langue dense et précise de son récit.
Entre terriens pourtant, le silence est une vertu cardinale. Témoin de paroles et de scènes mystérieuses, témoin intime mais ignorant de souffrances présentes et passées, le narrateur apprend à ne pas discuter ni demander de vaines explications. « Heureusement, remarque-t-il à l’aube de sa chronique , je me retins de le contredire et grâce à notre bref silence, ces minutes allaient demeurer intactes dans ma mémoire, à l’abri des finasseries verbales de l’érudition. » Plus tard dans le récit, deux photos silencieuses et quelques paroles blanches retraceront la destruction de deux familles bourgeoises de cette lointaine Arménie, révélant l’horreur avec bien plus de force que tous les décomptes macabres.
École de contemplation et d’intériorité, le silence semble avoir donné au narrateur de Makine la langue dense et précise de son récit. Les courtes semaines de leur compagnonnage constituent dans sa mémoire « toute une époque, comme toujours quand les rencontres exceptionnelles et les émotions intensément neuves dilatent le temps par la vérité et par la puissance de ce que nous ressentons ». De même les courts chapitres de son témoignage dessinent-ils tout un monde, comme toujours quand des mots choisis court-circuitent l’inutile prolixité. C’est ainsi que la mention de quelques objets suffit à restituer l’atmosphère singulière de la petite colonie :
« Chamiram réapparut, un plateau dans les mains : trois petites tasses et ce que je pris pour un élégant vase d’argent. En fait, une cafetière dont je reconnus, déjà avec un sursaut d’émotion, la patine – ce reflet argenté et noir, la gamme qu’abusivement, peut être, je rattachais désormais au « royaume d’Arménie » : la chevelure cendrée de Chamiram, la résille de son flacon de parfum, les moirures mates des châles, ce récipient délicatement ouvragé d’arabesques qui laissait échapper des volutes torréfiées… »
Plaisir de mots précis et sonores dans cet « univers où chaque objet espérait recevoir un autre nom. » Concision d’une parole prête à se taire pour écouter. Telle est peut être la principale leçon du petit « royaume d’Arménie » : écoute mon fils, et tend l’oreille, celui « qui parle beaucoup apprend peu. »
« Nous méritons toutes nos rencontres »
Cinquante ans plus tard, le narrateur revient sur les lieux et les découvre fatalement soumis à l’enlaidissement marchant du monde en marche. Abandonnant la belle discipline de silence à laquelle il s’était tenu de « n’ajouter aucun mot à ce que nous avions vu », il alourdit son éloge de l’amitié et de l’errance d’un vain commentaire réactionnaire. Ne tenons cependant pas rigueur à notre auteur en habit vert pour cette facilité finale, car l’essentiel est ailleurs.
Comme le professait Mauriac : « Nous méritons toutes nos rencontres. Elles sont attachées à notre destinée et ont une signification qu’il nous appartient de déchiffrer. » Cinquante ans plus tard, le narrateur ressent l’approche de la fin. Placé dans la même impasse que son éphémère ami de jeunesse, il en retrouve l’immense proximité : « il me faudrait avoir vécu toute une vie avant de comprendre qu’au lieu de m’éloigner, je m’approchais de lui. »
Peuple né du silence et disparu avec lui, la petite troupe de Bout du diable, Vardan, Chamiran, Gulizar et Servan demeurent dans la mémoire des vivants qui les ont connus. Grâce à ce beau cénotaphe, ils vivront dans celle de leurs lecteurs émus.
- MAKINE, Andrei, L’ami arménien, Grasset, Paris, 2021