
Avec L’Apocalypse heureuse, premier texte autobiographique, paru aux éditions Arléa en 2022 dans la collection “La rencontre”, Stéphane Lambert remonte le fil de l’histoire personnelle, où se rencontrent la liquidation d’un traumatisme d’enfance et la recherche d’une paix avec soi-même, confronté à la mort du père. Un récit sensible du retour à soi, une confession qui mêle la surprise de se découvrir et les coïncidences de ce qui se joue dans l’ombre de nous-mêmes, dans cette intériorité émue et qui parfois nous échappe.
Cartographie des noeuds
Dans L’Apocalypse heureuse, Lambert affronte l’histoire de soi et le poids du silence, là même où sans doute avait-il cherché une manière de fuir, là même où lui-même se redécouvre, au hasard d’une visite sur l’ancien territoire de l’enfance. À l’occasion d’un rendez-vous – qui ouvre la possibilité du texte et du surgissement de la mémoire – l’auteur-narrateur débarque devant l’immeuble où a eu lieu le drame de l’enfance : « C’était mon ancien monde, l’image frelatée de mon ancien monde, le passé en avait été chassé par de nouvelles vies, d’autres enfances s’y consumaient, qui deviendrait un jour comme moi des regards posés sur ce qui a été vécu, enfoui derrière l’apparence imperturbable de ce qui se perpétue. » C’est que le lieu d’un rendez-vous médical devient celui d’une exploration de soi quand il se révèle être, aussi et avant tout, le territoire trop connu d’un silence interminé : « Sans surprise, l’immeuble du cabinet médical était celui de l’appartement de D., l’ami de mes parents qui avait abusé de moi. Le cœur battant malgré les admonestations que je m’étais faites dans la voiture, j’avais immédiatement regardé la liste des noms à côté des sonnettes. Naufragé des années écoulées, invraisemblablement le sien y figurait encore. Le passé pouvait-il à ce point être resté immobile, comme une vieille carcasse pourrissant au fond d’un fleuve à l’endroit même où elle avait échoué ? »
Se retrouver soi-même à l’état de l’enfant, sans l’être tout à fait, c’est vivre à nouveau ce qui nous troublait alors, tout en mesurant la distance et donc la culpabilité en jeu. L’écriture comme la rencontre du lieu – trace du lieu – témoignent d’un détour, qui irrigue la dimension analytique du texte.
L’enjeu est d’emblée posé. Lambert affronte le ressac d’un traumatisme jamais évacué, non pas par lui, qui aura cherché à sa manière à faire avec, mais parce qu’il porte l’invisibilisation au sein de la famille et aura vicié une partie des rapports aux parents – là où l’enjeu second, que pose la seconde partie du roman, devient naturellement la liquidation d’un conflit au père dont il faudra faire le deuil. L’arrivée dans le cabinet ouvre un prétexte à l’exploration du trouble de la mémoire, du trouble de l’enfant et des traces dont les ramifications ne manquent pas, une pudeur même de l’enfance surgit : « je le savais pourtant très bien, la gêne aurait dû être de l’autre côté, dans l’autre camp, ressentie par lui, à supposer que le hasard aille jusqu’à nous faire nous rencontrer. » Car se retrouver soi-même à l’état de l’enfant, sans l’être tout à fait, c’est vivre à nouveau ce qui nous troublait alors, tout en mesurant la distance et donc la culpabilité en jeu. L’écriture comme la rencontre du lieu – trace du lieu – témoignent d’un détour, qui irrigue la dimension analytique du texte : « Entrer dans une réalité vécue par une autre biais que celui de notre perception donne l’étrange sentiment que notre histoire se détache de nous pour devenir le support d’une interrogation où grouillent d’autres vies. Sur la photo, je regardais D. avec une fascination qui m’attachait à lui. » Car indéniable est l’attache à ce qui nous aura forgés, indéniable aussi est l’attache à ce qui aura propagé en nous ce que nous demeurons incapables de ne pas demeurer : « J’avais honte de ce que j’avais vécu. J’avais honte d’y avoir trouvé du plaisir. J’avais honte d’éprouver de la peine à l’idée que mon histoire avec D. s’arrête. Intérieurement je priais pour que jamais rien ne se sache. » Ainsi se mélangent les paroles de l’enfant encore là au creux d’une mémoire de soi – l’enfant à consoler – et la soif d’émancipation de l’adulte qui, confronté à la mémoire des lieux, acte la nécessité de se décharger de l’histoire : « Le silence a nourri le terreau de la faute pendant de trop longues années pour qu’on puisse l’arracher comme on arracherait de simples mauvaises herbes. »
Le texte de Lambert s’organise ainsi comme une recherche de cette décharge dans et par l’écriture, non pas comme la simple confession cathartique mais plutôt comme l’enquête de soi, une manière de dénouer, de défaire ce qui, précisément, s’était emmêlé : « Lorsque je relis ma vie – ce que je m’efforce de considérer comme ma vie – depuis ce moment de l’enfance où les choses ont dérapé, j’ai le très net sentiment que tout ce qui s’est passé depuis est le lent et laborieux dénouement de ce qui s’était emmêlé. Le temps donne la possibilité de tracer un itinéraire à travers le gâchis » Car relire sa vie c’est aussi relier, et ouvrir à une cartographie de soi où la recherche du sens et de la cohérence devient l’opportunité d’en finir avec les chemins involontaires – en conscience – et d’oeuvrer à sa propre issue.
« L’enfance est un couteau planté dans la gorge »
Car c’est dans cette étude des lieux que réside aussi la beauté du texte, les lieux comme porteurs de trace, les lieux où persistent les imprésences que ce qui a été, qui contamine interminablement le présent, et nous oppose toujours le passage du temps
Aussi, si le texte ouvre largement sur la pagaille des nœuds et des cartes pour en montrer le brouillon, ce n’est que pour mieux y remettre de l’ordre. Loin d’une logorrhée victimaire, Lambert distille ce qui surgit pour minutieusement ordonner le testament de l’enfant :« Il n’y a pas de scène initiale. Tout à coup on est plongé dans la vie. Avec pour seule certitude qu’il va falloir la quitter. Étrange présence malmenée par ce savoir oppressant. On ne sait pas ce qu’on cherche, on ne sait pas ce qu’on fuit, on est chargé de choses dont on ignore l’origine. » Le texte n’en finit plus d’interroger l’origine, pour mieux en saisir les traces et les marques, pour mieux en démonter les mécanismes et en saisir la systématicité – il dévoile l’inconscient de l’histoire elle-même, car il faut démasquer avant même d’affronter, il faut révéler avant même de dépasser : « C’était sans compter l’obstination de la nuit à me ramener dans ces lieux du passé autour desquels mon angoisse s’enroulait comme un serpent de l’âme. Mes errances m’entraînaient vers d’anciens mausolées où je ne cessais de me perdre. Malgré mes tentatives d’évasion je revenais inexorablement à l’origine de la décomposition. » Et enfin opposer au silence la vérité de la parole et plus encore celle de l’écriture : « Quand je repense au silence qui a suivi l’affaire du pédophile, je ne peux m’empêcher de constater comment le non-dit a contaminé chaque jour, chaque échange comme une mauvaise graine enfonçant toujours plus ses racines en chacun de nous, détruisant en profondeur les fondations de notre maison commune. » Car c’est dans cette étude des lieux que réside aussi la beauté du texte, les lieux comme porteurs de trace, les lieux où persistent les imprésences que ce qui a été, qui contamine interminablement le présent, et nous oppose toujours le passage du temps : « Les lieux engouffrent nos passés dans leurs silencieuses mémoires tandis que la nôtre continue de remuer sous la craquelure de nos peaux. Comment accepter que tout se défasse ? »
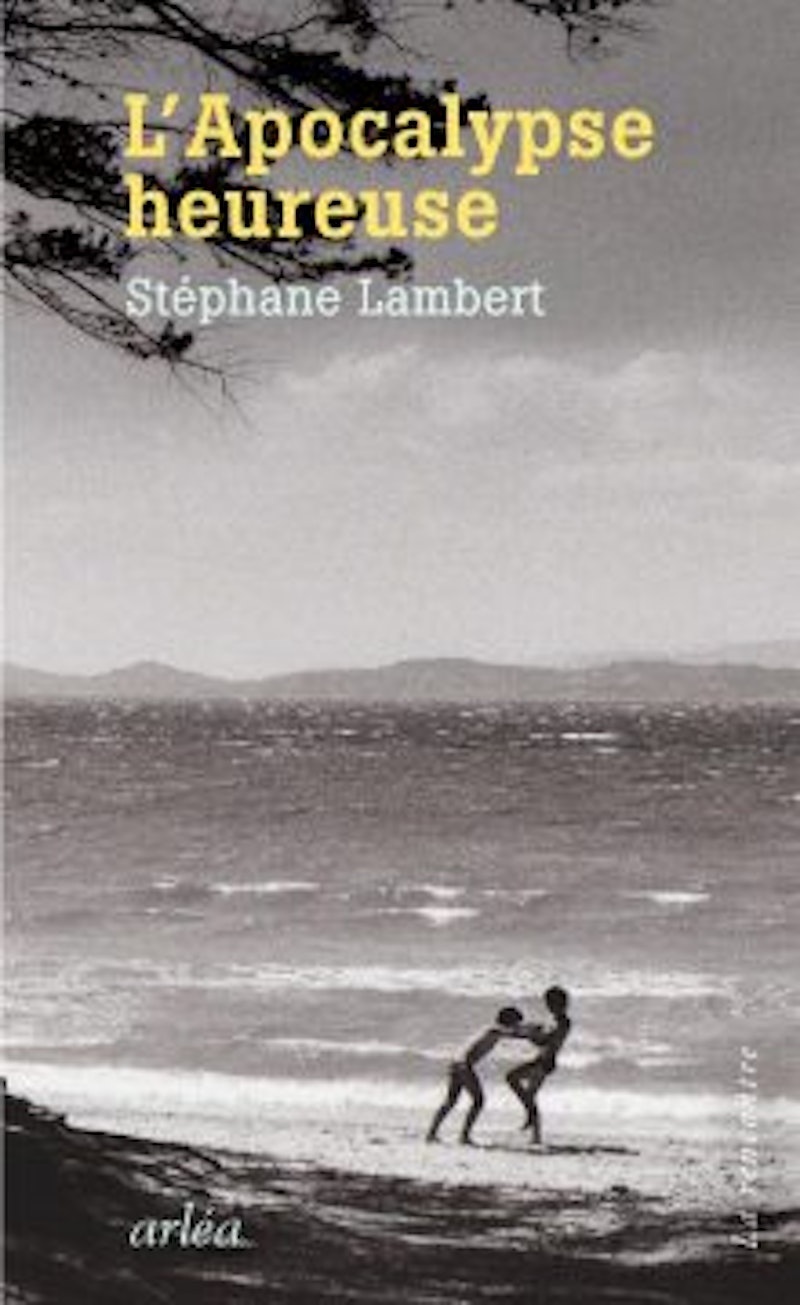
L’itinéraire de soi que retrace Lambert, porté par ce que les hasards nous forcent encore à affronter des traces essaimées de l’histoire personnelle ouvre enfin à la conquête d’une réconciliation avec l’enfance et à l’écriture : « Je commençais seulement à comprendre que j’avais écrit des livres pour me préserver. Là où je pensais avoir été incapable de me sauver, je n’avais fait que cela avec les moyens que j’avais eus à ma disposition. » Car le retour à soi est toujours une reconnaissance, et la découverte apaisée d’une coïncidence, enfin, de soi-même.
Bibliographie :
Lambert, Stéphane, L’Apocalypse heureuse, Arléa, collection “La rencontre”, 2022.

















