
Zone Critique poursuit sa série estivale, légère et intime : “Le jour où…”, le jour où la littérature nous a émus et bousculés, le jour où la rencontre avec un texte a fait de nous le lecteur ou la lectrice d’aujourd’hui.
Lorsque j’étais enfant, les livres avaient la voix de ma mère. Elle nous racontait des histoires qui venaient peupler notre imaginaire. J’ai pleuré pour la petite marchande d’allumettes, je me suis endormi avec Aurore, j’ai été capturé par trois brigands, ensorcelé par les contes étranges et inquiétants de Roald Dahl. Ces années filèrent comme un rêve. Lorsque je suis entré à l’école, on a appris à déchiffrer des signes et à tracer des lettres à l’aide d’une étrange souris verte nommée Ratus. Le monde s’est peu à peu rempli de sens et les inscriptions colorées au dos des paquets de céréales ont perdu de leur mystère.
Pourtant, c’est par l’image que ma vie de jeune lecteur a été bouleversée. En 2001, alors que le XXIe siècle commençait à se dessiner sur les ruines du World Trade Center, le premier volet du Seigneur des Anneaux sort au cinéma. L’heroïc fantasy est ainsi entré par effraction dans mon imaginaire. Les Nazgûls m’ont plus effrayé que les représentations grotesques du diable qui ornaient le fronton des églises et la disparition de Gandalf dans la mine de la Moria a probablement eu le même effet sur moi que la mort de Rubempré pour Wilde. À huit ans, les merveilles de la Terre du Milieu sont légion.
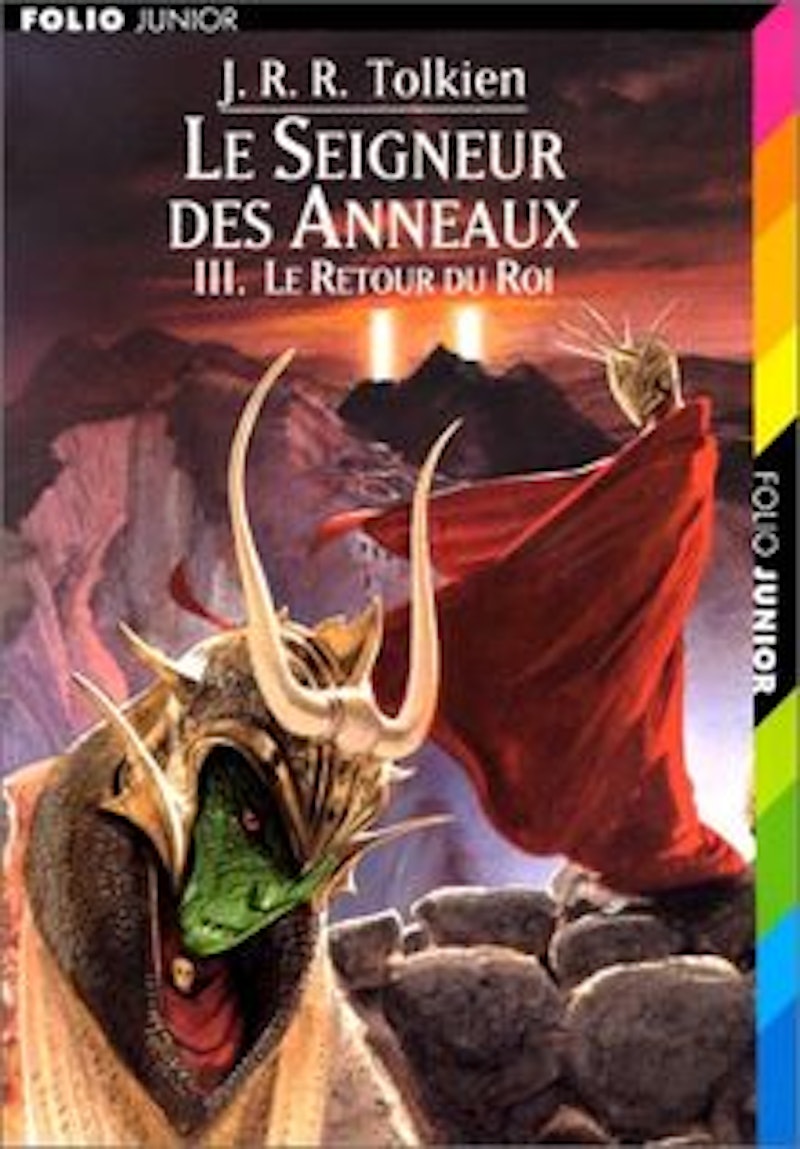
Cette lecture tient autant du péché d’orgueil que de l’aventure romanesque. Il fallait se familiariser avec la cascade des anthroponymes (Mithrandir, Gripoil, Ingold, Denethor…) mais surtout celle des toponymes (Amon Dîn, Eilenach, Nardol, Erelas, Min-Rimmon, Calenhad, Halifirien…) Ces noms, imprononçables pour la plupart, m’ont autant fait souffrir que rêver. J’ai également dû apprendre à m’adapter à la beauté ronflante des périphrases, à l’importance de la lignée pour qualifier un personnage ainsi qu’au vocabulaire qui me paraissait délicieusement désuet.
Pour venir à bout d’un tel livre, j’avais mis au point un plan de bataille. Au commencement, j’avais besoin d’encouragement. Il fallait qu’on assiste à cette lecture : le monde – c’est-à-dire ma famille – devait être témoin de mon excursion en Terre du Milieu. Je posais donc nonchalamment l’ouvrage sur la table de la cuisine pour recevoir les compliments amusés de ma mère, j’oubliais par mégarde l’ouvrage sur le rebord de la baignoire après une pause aquatique pour que l’une de mes sœurs me rapporte le livre aux pages gondolées avec un sourire d’admiration, je le lisais ostensiblement lors de réunions familiales en choisissant un endroit à la fois discret et visible.
Armé d’une lampe de poche et de mon courage, je m’aventurais laborieusement dans un monde en guerre fait de hautes murailles et de fiers étendards.
Pourtant, le cœur de la bataille ne se jouait pas durant la journée mais au creux des nuits. Armé d’une lampe de poche et de mon courage, je m’aventurais laborieusement dans un monde en guerre fait de hautes murailles et de fiers étendards. Sous la chaleur ouatée et étouffante de ma couette, j’ai vibré pour la défense de Minas Tirith dont la description labyrinthique a fait travailler mon imaginaire. Abruti par le sommeil, j’ai dû m’y reprendre à plusieurs fois pour comprendre le sens des chants de guerre qui innervent le livre. Pour être tout à fait honnête, j’ai un peu vacillé lorsqu’il a fallu entamer la deuxième partie de l’ouvrage consacrée aux aventures de Sam et Frodon, et j’ai été surpris par cette conclusion à tiroir qui s’achève par le nettoyage de la Comté. Je dois à ce livre des nuits enchantées, des rêves agités et des réveils cernés.
Mais, pour l’enfant que j’étais, le génie de Tolkien réside dans la richesse des appendices. Tous les lecteurs le savent : la fin d’un ouvrage dans lequel on s’est investi déclenche une forme de mal des profondeurs. Un sentiment de solitude nous envahit et nous n’aspirons qu’à retourner dans l’univers que nous venons de quitter. Or, les appendices constituent un palliatif radieux pour apaiser cette sensation de manque. On retrouve suffisamment de cartes, de chronologies et de généalogies pour se perdre des jours et des nuits encore.
Au moment où j’écris ces lignes, des centaines de milliers d’élèves passent l’épreuve orale du baccalauréat de français. Durant l’entretien, ils doivent présenter un livre qu’ils ont étudié durant l’année et réussir à convaincre l’examinateur qu’ils ont apprécié l’ouvrage. Pour remporter ce jeu de Poker menteur, je souhaite à tous les lycéens de trouver un livre susceptible de raccourcir leurs nuits.

















